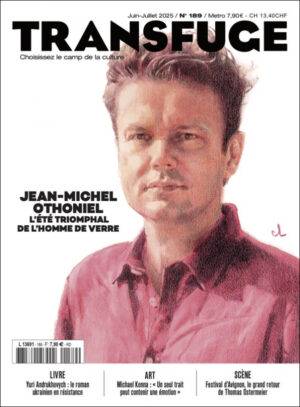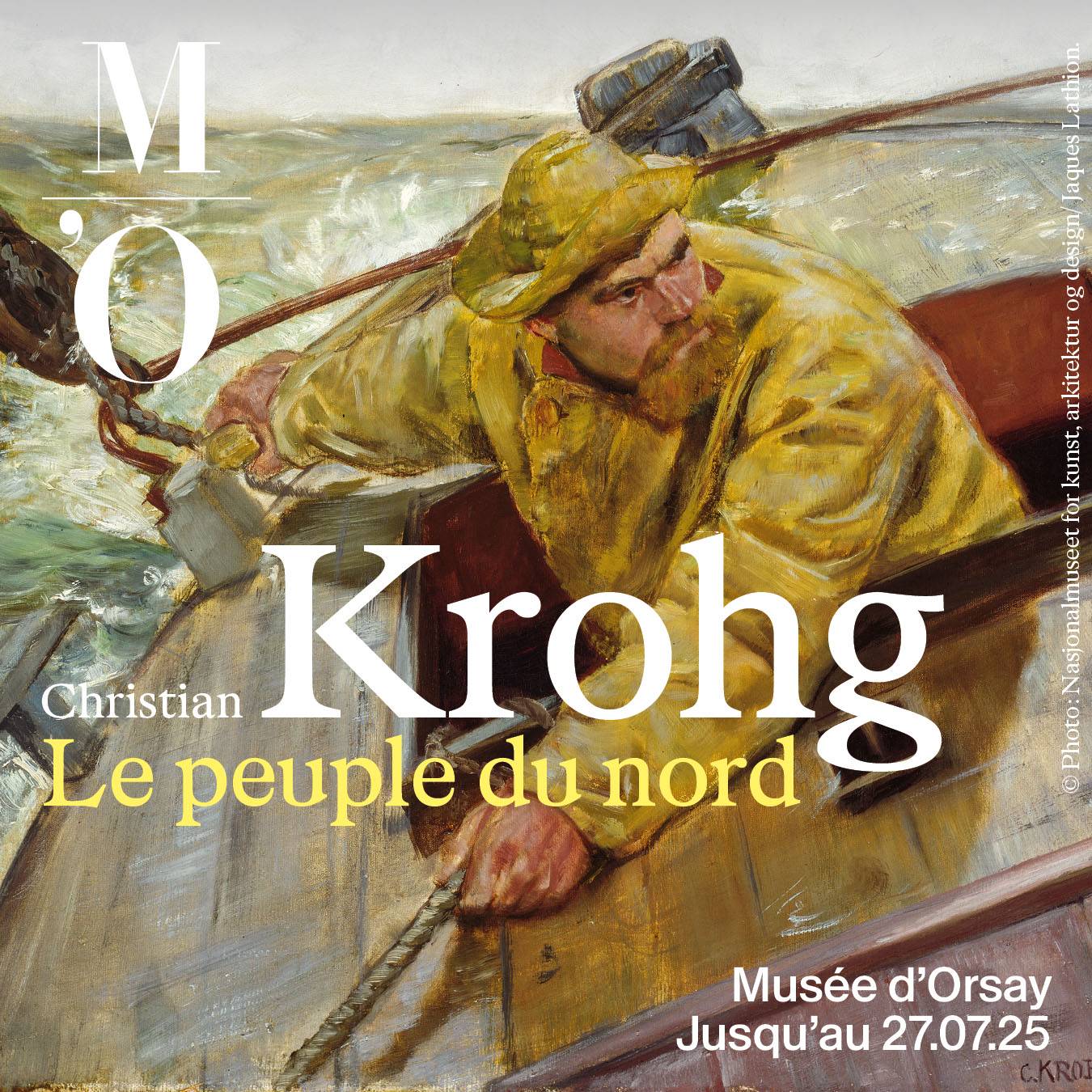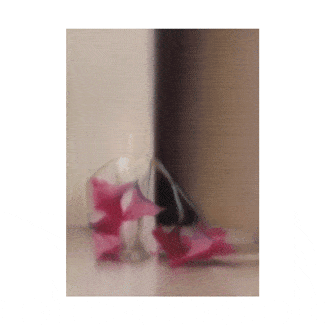La détonnante sicilienne présente en janvier à La Colline – Théâtre national, Re Chicchinella, dernier opus de sa trilogie consacrée au Conte des contes de Giambattista Basile. Tour d’horizon des influences de cette artiste iconoclaste.
Tadeusz Kantor
« J’ai eu la chance de le rencontrer et de voir l’un de ses derniers spectacles, Machine de l’amour et de la mort. J’avais tout juste vingt ans. Mes parents n’avaient pas spécialement d’intérêt pour l’art vivant. Toute la performance, Kantor était resté, sur scène, dos au public. C’était sa marque de fabrique, de vivre le spectacle au plus près de l’action. C’était d’une telle radicalité, d’une telle fulgurance que cela m’a profondément marquée. Je ne connaissais rien du théâtre de recherche et d’expérimentation. Avec lui, dont j’ai étudié l’œuvre, j’ai découvert un univers, une poésie, qui ont nourri mon parcours d’artiste durablement. »
Dostoïevski
« C’est une vraie référence littéraire. Dotstoïevski est le plus grand constructeur, ouvrier et maçon de la famille dans tout ce qu’elle a de plus contradictoire, de plus défaillant et de plus horrible. Il a l’art du mélodrame. À l’époque, ses œuvres étaient publiées en feuilleton dans les journaux. Il devait donc retenir l’intérêt des lecteurs et donc du peuple et de la masse. Dans ces récits, il y a donc des rebondissements, des drames, de la tragédie. C’est passionnant. Et le plus beau de ses romans est à mon sens, Les Frères Karamazov. Outre Dostoïevski, Albert Camus, Emmanuel Carrère, Elsa Morante ou Anna Maria Ortese font partie des auteurs qui nourrissent l’artiste que je suis aujourd’hui. »
Federico Fellini
« Si j’ai peu de références en théâtre, le cinéma m’a énormément influencée. Je me suis beaucoup inspirée du regard des cinéastes italiens sur le monde, leur manière baroque d’évoquer la misère, de parler du quotidien sans que le noir, le sordide l’emporte. Fellini est une référence pour tous les habitants de la péninsule. Il est le maître des affabulateurs visionnaires. Il y a chez lui un réalisme magique qui lui permet de transformer des histoires terribles et tragiques en fables contemporaines. Dans ma manière d’aborder la mort notamment et les aléas de la vie, il y a des résonances et des proximités. »
Vittorio De Sica
« Je suis proche du mouvement du néoréalisme italien qu’incarne parfaitement la figure de Vittorio De Sica. Il puise ses sujets dans la rue, il évoque la misère, la pauvreté, la famille dans ce qu’elle a de plus disparate et dysfonctionnelle. À travers son œil, sa caméra, il donne une universalité à ses histoires singulières. Ce que j’aime surtout chez lui, c’est son regard sur la société cru, lucide et visionnaire. Il ne cherche pas à dissimuler la vérité, mais au contraire de l’exposer à travers un prisme qui en déforme les contours. C’est cette poésie, cette contorsion du réel que je trouve tout aussi fascinante dans le cinéma d’Alice Rohrwacher. Tout comme eux, dans mon travail, je recherche des corps blessés, abîmés, des présences qui ne magnifient pas, mais au contraire qui montrent l’humain dans toute sa diversité, sa disgrâce. La poésie du quotidien se voit dans les blessures. »
La Sicile
« La Sicile, c’est ma terre, mon pays. C’est un élément essentiel de mon œuvre. Elle irrigue mon travail et habite mon processus créatif. C’est une manière de me réapproprier mon enfance, d’entendre ces voix lointaines des femmes de la maison, de me remémorer le bruit de la rue. La Sicile, c’est mon école maternelle, que je n’ai toujours pas quittée et où j’ai plaisir à revenir telle une mauvaise élève qui redoublerait chaque année pour réapprendre les bases de mon art. C’est comme un début perpétuel. J’y ai appris la gestuelle de la langue et j’y ai construit mon abécédaire d’artiste. C’est chez moi. »
Giambattista Basile
« Poète napolitain du XVIIe siècle, il a recueilli les fables que l’on racontait aux enfants et que l’on se transmettait de génération en génération dans la région de Naples, où il a vécu. Ce qui m’a plu dans son œuvre, dont je me suis inspirée pour trois de mes derniers spectacles, La scortecata, Pupo di zucchero et Re Chicchinella. C’est sa langue, celle de son village natal, Giugliano in Campania. C’est pas littéraire, c’est très oral, baroque autant que vulgaire. Il parle de la rue, il n’essaie pas d’édulcorer les contes, bien au contraire. Et pour moi c’est fondamental pour aider les filles et les garçons à appréhender le monde qui les entoure. Il n’y a pas de tabou chez l’enfant, c’est nous les adultes qui les créons. Basile l’avait bien compris. Les trois fables que j’ai adaptées et réécrites évoquent la mort, non comme une fin mais plutôt comme une transformation vers un autre état, vers un nouveau départ. C’est cette métamorphose des personnages et des choses qui m’intéressent dans son Conte des contes, connu aussi sous le nom de Pentamerone. C’est cela que j’ai voulu porter au plateau.»