Somnambulique ou sous haute tension, le subtil roman de Sarah Hall, L’atelier, explore entre autres la question de l’art et de la création.
Une fois refermé, résumer l’intrigue du nouveau livre de Sarah Hall s’avère une tâche bien ardue. L’Anglaise a toujours pris soin de surprendre ses lecteurs. On peut avancer que l’art et la création se trouvaient déjà au cœur du Michel-Ange électrique ou de Comment peindre un homme mort. C’est à nouveau le cas ici, mais encore une fois l’ensemble est plus complexe. La meilleure des choses consiste donc à se laisser porter et guider par la voix de la narratrice de L’Atelierqui assemble les unes aux autres différentes pièces de ses souvenirs, en mélangeant les époques, à mesure qu’elle sent la fin approcher. Edith Harkness a étudié aux Beaux-Arts dont elle est diplômée puis a peaufiné sa formation en immersion au Japon grâce à une bourse. Sculptrice renommée, elle réalise des pièces volumineuses généralement destinées à des espaces publics où ils provoquent les réactions les plus diverses. La dame travaille la matière de ses œuvres dans son atelier de Burntcoat, un ancien entrepôt utilitaire qu’elle a investi et remis en état, au bord d’une rivière dans une petite ville du Nord.
Depuis l’enfance, Edith a toujours dû affronter les tempêtes et les vents contraires. D’abord au contact de Naomi, une mère qui écrivait et donnait des cours pour améliorer l’ordinaire. Une mère ravagée par un vilain caillot dans le cerveau quand sa fille avait seulement dix ans. Après l’opération, le couple familial a volé en éclat. Son père a rapidement quitté leur maison au milieu de la lande et s’en est allé construire très loin une autre vie. La laissant avec une Naomi amochée mais faisant de son mieux pour s’accrocher. Edith ne cache pas qu’elle a développé une « forte tolérance à l’incertitude ». Un jour, il y eut la rencontre avec Halit. Un homme délicat dans ses gestes comme dans la cuisine qu’il élabore, doté de deux cultures et d’un passé douloureux. Leur liaison est d’abord une illumination, une intense communion des sens…
L’Atelier est un livre tour à tour vaporeux et somnambulique ou sous tension. Sarah Hall accorde une large place aux paysages, aux éléments. La musique que la romancière et nouvelliste deux fois nominée pour le Man Booker Prize y diffuse est parfois ambiante, parfois nettement plus cacophonique ou même traversée d’éclairs électriques. Elle s’accorde aux étapes de l’existence singulière d’une héroïne encore secouée par l’arrivée inopinée d’une pandémie mondiale, par les ravages d’un virus d’abord appelé le nova puis le AG3, entraînant confinement et couvre-feu dans un monde au bord du gouffre. « Peut-être faut-il toute une vie pour apprendre à vivre. Comment lui donner du sens ou la rendre tolérable, comment atteindre à un semblant de sagesse », s’interroge Edith en expliquant qu’elle a tâché de voir sous la surface des choses.
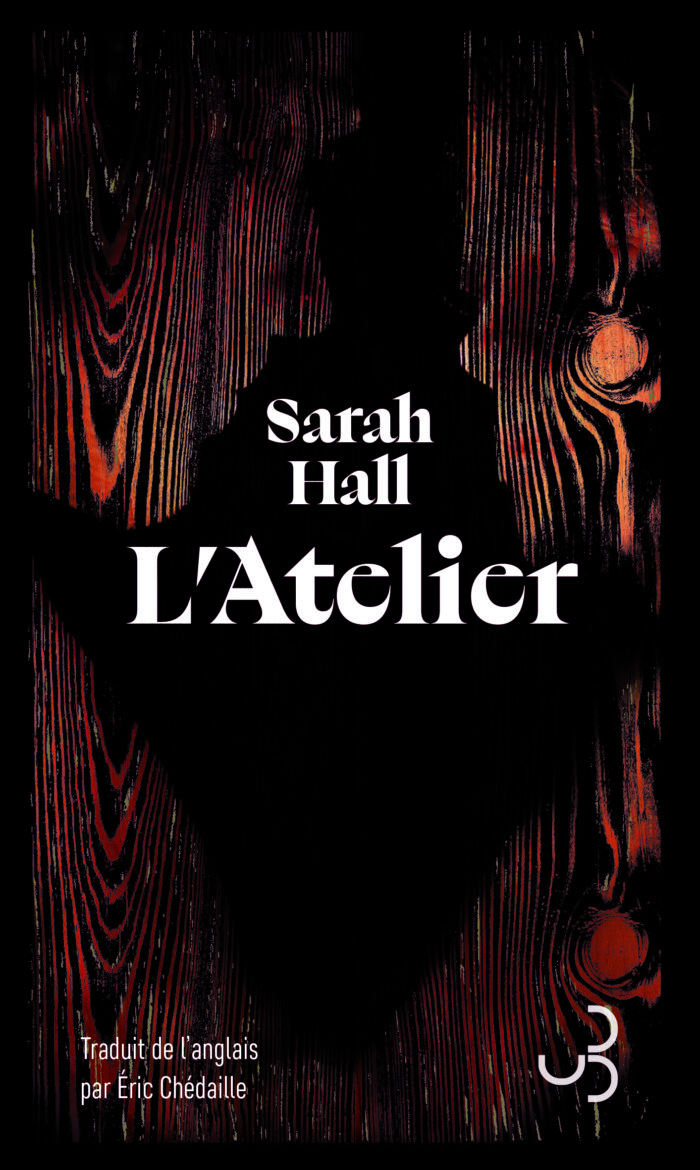
Sarah Hall, L’Atelier, traduit de l’anglais par Eric Chédaille, Christian Bourgois éditeur, 268p., 21 €








