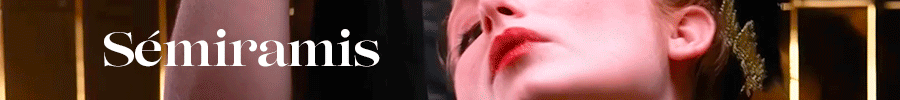Jerry Stahl
Jerry Stahl. Vous ne connaissez peut-être pas ce romancier américain. C’est un tort. Vous n’avez pas lu son Moi, Fatty ? C’est l’histoire, à l’ère du muet, du seul rival de Chaplin. Acteur comique obèse, Roscoe Arbuckle est une vedette jusqu’à son accusation pour viol et homicide de Virginia Rappe (quel nom !). Après ? la chute, la calomnie, les féministes (déjà là), l’alcool, la drogue, le ban. Malgré l’acquittement, le puritain Hays met son nom sur la liste noire. Résultat ? Plus aucun producteur ne le produit, Arbuckle sort des radars pour toujours. La mort subite. Toute ressemblance avec notre époque est fortuite ; Hollywood est déjà traversé par ce puritanisme assassin. Le roman de Stahl raconte ce Hollywood ; une merveille. En 2010 paraît Les mémoires des ténèbres, aux éditions 13e Note. Là, tout est vrai : c’est son histoire personnelle ; son succès à Hollywood, comme scénariste de Twin Peaks, des Experts ou encore du chef-d’oeuvre Bad Boys 2 de Michael Bay. Làs, comme Arbuckle, c’est ensuite la chute, trois divorces, des dépressions à répétition, l’héroïne. La vie à Hollywood, quoi ! Son dernier roman, Nein Nein Nein (Rivages) est dans une veine plus comique, tendance Groucho Marx, tendance bordel. Le narrateur est au plus mal, dépressif, sa femme l’a quitté, une hépatite, rien ne va plus. Une idée lui vient pour se changer les idées. Juif, il n’est jamais allé voir de près les camps de la mort, notamment le camp suprême : Auschwitz. Quoi de mieux qu’une petite visite guidée du côté des fours crématoires pour retrouver le moral ! Il décide de faire un voyage organisé en car. L’occasion pour Stahl d’une série hilarante de digressions, de réflexions, de situations grotesques et de questions absurdes. Amis très sérieux d’Annette Wieviorka, passez votre chemin ; vous risquez d’être fumasses. Comme le livre de Norman Mailer, Pourquoi sommes-nous au Vietnam ? où il n’évoque presque pas le Vietnam, Stahl passe son temps à éviter le sujet. Il préfère ne pas ; c’est plus fort que lui ; une vraie autruche. Et c’est la force du roman : un joyeux bordel de questions quasi talmudiques, se posent à Stahl : mais pourquoi la cafète d’Auschwitz ne propose pas de nourriture casher ? (complot polonais ?) ; quel travail ferait Monsieur Pipi, « jeune Kommandant », préposé à l’urinoir d’Auschwitz s’il n’y avait pas eu plus de deux millions de juifs gazés ici ? Une question l’autre : « Alors, ça fait quoi de vendre des tickets pipi à des touristes de l’holocauste du soir au matin ? Et qu’arrive-t-il aux fraudeurs ? N’y a-t-il pas-je ne sais pas, moi-un mini camp, quelque part au fond du jardin, où l’on interne les resquilleurs des WC pour hommes ? » Il est lancé : « Tant de questions m’assaillent ! Incarne-t-il la quatrième génération d’une dynastie de préposés aux latrines dans ce camp de la mort ? Son arrière-arrière-grand père occupait-il ce même siège pour aider le Reichsfürher-SS Himmler à pisser quand il rendait visite au Kommandant Höss ». Et une dernière : « Alors dites-moi, comment vous avez percé dans le milieu ? » Il y a aussi l’angoisse du narrateur, tout en autodérision, de ne pas être à la hauteur de l’évènement : « l’horreur d’être complètement indigne de l’horreur elle-même ? » L’horreur, quand il entend face aux fours crématoires : « Tu sais à quoi ça me fait penser ? On dirait un four à pizza. » Horreur au carré, quand lui-même finit par penser à un four à pizza. L’enfer : « Vous me voyez mortifié de l’avouer, mais c’est la vérité-je suis plutôt d’accord avec lui. Jusqu’ou peut-on aller dans la non grandiosité ? Je m’insupporte putain. » De l’autodérision à l’autoflagellation, il n’y a qu’un pas : « Le type m’a sorti du placard en révélant au grand jour la nature hyper beauf de mon cerveau. Il est en train de me foutre en l’air mon holocauste, le con. » On dirait du Ricky Gervais ! Aucun tabou. Et tout le roman est de cet acabit. Si vous aimez, foncez ; ce livre est pour vous. Mais chut : pas un mot à l’Amicale d’Annette Wieviorka, vous risqueriez de vous faire tirer les oreilles (à juste titre).
George Sanders
Quittons les pizzas et les fours crématoires. Direction Hollywood : les mémoires de George Sanders. Chez Séguier, une des plus belles collections du monde. Avec une préface parfaite d’Eric Neuhoff. Les cinéphiles savent : en second rôle, c’est un des plus grands. Vous qui êtes cultivé (comment ne pas l’être comme lecteur de Transfuge), vous l’avez sûrement vu dans Quatre hommes et une prière de Ford, Rebecca et Correspondant 17 de Hitch, Chasse à l’homme de Lang, Ève de Mankiewicz ou encore Scandale à Paris de Sirk. Il aurait pu faire mieux, ce dilettante d’Hollywood. Entre parenthèses, encore un qui devient star sans aimer le cinéma. Dans la même collection Séguier, on se souvient de Richard Burton, qui aime le théâtre mais pas le cinéma ; on se souvient d’Errol Flynn, qui préfére les filles à son travail d’acteur. Sanders aurait pu mieux réussir, mais le jour où le grand producteur Louis. B. Mayer lui propose un déjeuner pour le rendre célèbre, il lui fait faux bond. Il a mieux à faire : du bricolage. Ce bellâtre ne joue que des rôles d’aigrefins, de méchants ; beaucoup de nazis (il en avait marre à la fin). Mais c’est lui qui définit le mieux sa carrière : « Ma méchanceté était d’un genre nouveau. J’étais infect, mais jamais grossier. J’étais une sorte de canaille aristocratique. Si le scénario exigeait de moi de tuer ou d’estropier quelqu’un, je le faisais toujours de manière bien élevée et si j’ose dire, avec bon goût. Et je portais toujours une chemise immaculée. J’étais le type de traître qui déteste avoir une tache de sang sur ses vêtements ; pas tant parce que je redoutais d’être découvert que parce que j’aimais avoir l’air propre sur moi. » Il ajoute : « Si au cinéma je suis invariablement un fils de pute, dans la vie, je suis un gentil garçon, un si gentil garçon. » On a du mal à le croire.
Edito général
Rire avec ce dépressif de Jerry Stahl et avec ce fils de pute de George Sanders