Philippe Vilain est passé avec bonheur de l’autofiction au néoréalisme italien. Dans un roman juste et poignant, il met en scène une femme qui incarne la féminité napolitaine à son apogée dans les années 1950.
Naples, écrit Philippe Vilain, est « une mamma étouffante, qui enlace et ne laisse plus partir, qui protège et tue, expie et châtie, mais n’abandonne jamais les siens ». Autrement dit un piège. La panoplie qu’elle lègue à ses enfants est une gangue, une camisole, une malédiction. Si joyeux qu’ils soient, les Napolitains sont les otages d’un folklore délétère qu’orchestre une hydre abominable, la camorra. Cette mafia clanique, aux coutumes féodales, sévit en Campanie depuis deux siècles. C’est dans le contexte des années 1950, alors qu’on magnifie la Parthénopéenne à l’écran, que Vilain raconte le drame d’une victime de cette ville lumineuse, mais corrompue, bigote, pétrie de superstitions archaïques et hantée, depuis l’Antiquité, par le fatum.
Assunta Maresca, dite Pupetta (« petite poupée », comme celles avec lesquelles les fattucchiere, les sorcières napolitaines, exécutent une personne en effigie), s’amourache de Pasquale Simonetti, dit le Colosse, un camorriste en passe de devenir un mammasantissima, le parrain du quartier de Forcella. Fille d’un contrebandier de moindre envergure, elle s’est pourtant juré « de ne jamais vivre dans le qui-vive éreintant des jours, auprès d’un homme traqué ». Peu après leur mariage, Pasquale est assassiné par un rival. Enceinte, la jeune veuve venge son mari, essaie d’échapper aux représailles, mais finit par être arrêtée, jugée et incarcérée à la prison de Poggioreale. Pupetta éprouve « toute l’injustice du sort des femmes à travers le sien, ce sort réglé par la chance ou la malchance de faire un bon mariage, voire jusqu’à la condamnation du célibat, à l’infamie d’être mère-fille ». Vilain dépeint superbement la vie étroite de ces tristes recluses, madones ou matrones.
La réussite de ce livre tient à l’adéquation entre l’héroïne et la ville dont elle est issue. Naples s’y incarne dans une femme sublime en qui se reflète la noblesse de cette Babylone frénétique dont le romancier restitue jusqu’aux parfums. Il la décrit de l’intérieur avec une profonde connaissance de la « napolitanéité ». L’atmosphère néoréaliste, en noir et blanc, évoque L’Or de Naples, le film de Vittorio De Sica de 1954, mais sans la part de comédie qui rend si théâtrale cette cité de saltimbanques. Si la perception aiguë de la précarité de la vie s’y traduit par l’exubérance, la joie y alterne sans cesse avec le malheur. « Naples jouit de sa puissance tragique », écrit Vilain en soulignant ce contraste auquel contribue la proximité du Vésuve, toujours prêt à entrer en éruption.
« Libre et déterminée, fidèle et juste, sage et passionnelle », Pupetta joue son rôle de mater dolorosa à l’instar d’une Sophia Loren ou d’une Anna Magnani. Sacrifiée dans sa ville natale qui lui fait « l’effet d’une fiction maléfique », elle n’envisage plus d’échappatoire. Vilain pousse le réalisme jusqu’à se permettre des italianismes : « Elle ne voyait pas l’heure d’être jugée et de finir de purger sa peine. » Est-ce pour mieux rivaliser avec Malaparte, Brancati ou Moravia qui auraient tous pu signer ce grand roman ?
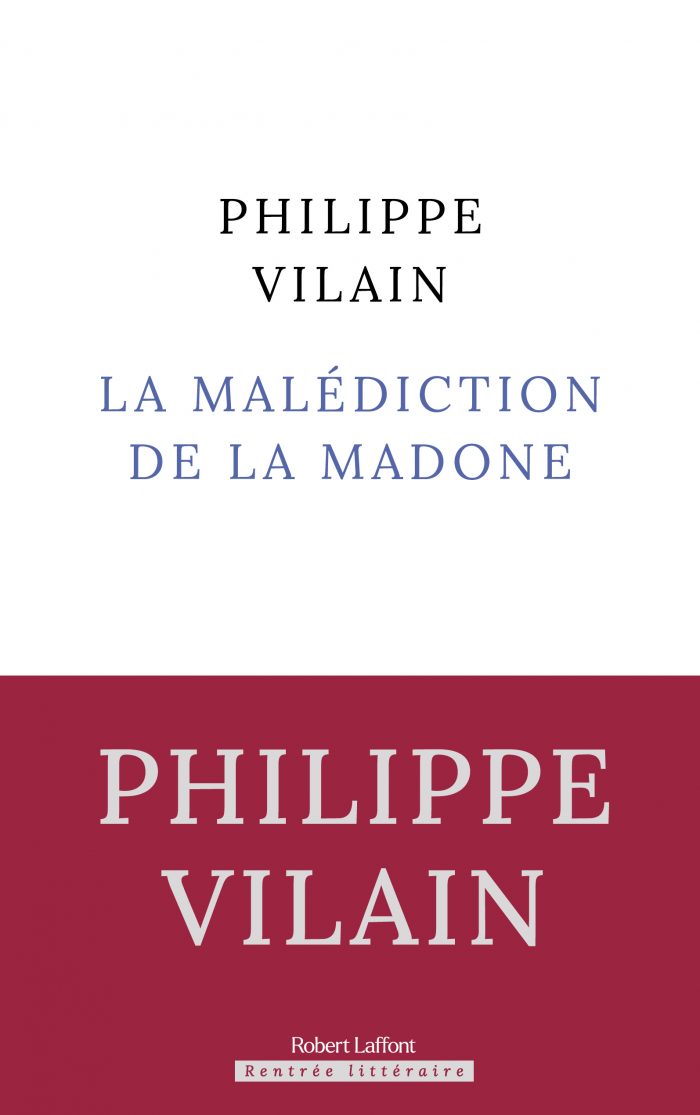
La Malédiction de la Madone, Philippe Vilain, éditions Robert Laffont. 184 p., 19 €










