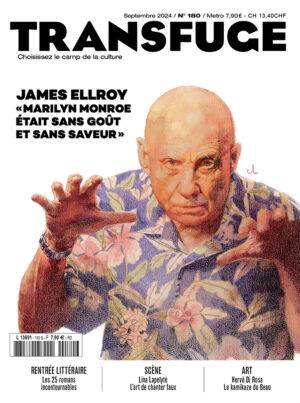LE LIVRE DE L’INTRANQUILLITE DU POETE portugais Fernando Pessoa est à classer parmi les grands livres du XXe siècle. C’est un livre qui a une histoire particulière. Il a été écrit entre 1913 et 1935, date de la mort du poète, et n’a été édité qu’en 1982 au Portugal aux éditions Atica, en France en 1988 aux éditions Bourgois. Le manuscrit original était enfermé dans une malle, fait de textes épars, de fragments, sans lien, sans plan préétabli. Précisons que Pessoa a très peu édité de son vivant. Ainsi, les textes que nous pouvons lire aujourd’hui chez Christian Bourgois, regroupés sous le titre du Livre de l’intranquillité, ont été organisés chronologiquement. Selon les pays, donc selon les éditeurs, les textes de ce livre ont été classés de différentes manières.
Ce livre de 525 pages s’ouvre par une citation de l’auteur, texte 12 : « Ce sont mes confessions, et si je ne dis rien, c’est que je n’ai rien à dire. » Amusante confession, effrayante autant que moderne, il reste 524 pages à lire. Mais là où Rousseau feignait de tout nous dire, sans masque, Pessoa nous prévient : ce livre ne va pas être un livre, pas d’histoire, pas de construction, pas de départ ni d’arrivée, pas d’événements.
Ce livre agace, a aussi son côté dépassé. Dans bien des fragments, on a affaire à une écriture psychologique. Pessoa analyse, comme les Romantiques dont il est héritier, ses sensations, et il explique, tout en introspection. Par exemple :
« Je ne me souviens pas de ma mère. J’avais un an lorsqu’elle est morte. Tout ce qu’il y a de dur et d’éparpillé dans ma sensibilité vient de cette absence de chaleur, et du regret inutile des baisers, dont je n’ai pas le souvenir. […] Ah ! c’est la nostalgie de cet autre que j’aurais pu être qui me désagrège et qui m’angoisse ! »
Avouons-le, aussi grand soit Pessoa, on dirait aujourd’hui de lui ou de son oeuvre : psychologie à deux balles.
A côté de cela, il est capable d’écrire des passages très modernes, équivalents littéraires d’une sitcom, proches d’une littérature de l’oralité. Lorsque, par exemple, quelques pages après, il se promène et écoute au passage la discussion des jeunes aux alentours : « Et c’est toujours la même succession des mêmes phrases : “Alors elle m’a dit” […] “Si ce n’est pas lui, alors c’est toi” […] “Tu l’as dit, parfaitement, tu l’as dit” (…) “Ma mère dit qu’elle ne veut pas”, […] “Qui, moi ?” […] “Si ça se trouve, c’était…” […] “Alors je me suis planté carrément devant le type, et je lui ai sorti en pleine figure-en pleine figure-hein, José !” » Le texte aurait pu être écrit hier.
On trouve par ailleurs de très beaux fragments chez Pessoa, ceux-là intemporels – religieux pourrions-nous dire – qui ont en leur centre le mystère de toute chose. Pour le poète, les hommes sont souvent synonymes de néant, de non-être comme il dit. Parfois, quand même, nous sommes un peu plus que du néant : « Nous ces végétaux de la vérité comme de la vie, poussière déposée au-dedans comme au-dehors des vitres, nous ces petits-enfants du Destin et ces fils adoptifs de Dieu, qui épousa la nuit éternelle, veuve du Chaos qui nous a tous engendrés. » Nous pensons savoir ce que nous faisons, diriger notre vie comme nous l’entendons alors que nous n’y entendons rien : « Et je constate, avec une stupeur métaphysique, à quel point mes actes les plus judicieux, mes idées les plus claires, mes projets les plus logiques, n’ont rien été d’autres, en fin de compte, qu’une ivresse congénitale, une folie naturelle, une ignorance totale. Je n’ai même pas joué un rôle : on l’a joué pour moi. Je n’ai pas non plus été acteur : je n’ai été que ses gestes. » Les hommes sont perdus, égarés, chez Pessoa.
Nous voulions depuis longtemps faire un dossier sur Fernando Pessoa, dont l’oeuvre est encore peu lue en France. Sur ce poète qui préféra vivre seul avec ses héteronymes, ses personnages, loin des hommes, dans la Rua dos Douradores qu’il n’aimait pas quitter.