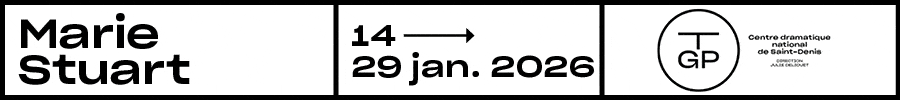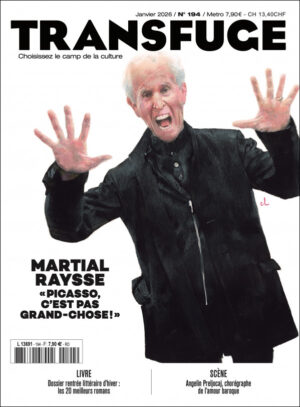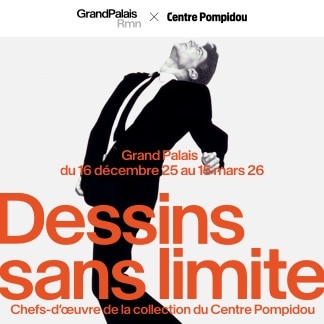Et si Cécile Guilbert, avec Emmanuel Carrère, avait signé le grand livre de la rentrée ?
Ce récit, livre d’une vie, livre de sa vie, Feux sacrés, édité chez Grasset, est avant tout élan ; un élan considérable, une vitalité hors norme, une flèche tirée tant à l’horizontale qu’à la verticale, mondaine et cosmique à la fois. Oui, ce feu sacré est feu d’artifice tant Cécile Guilbert, simplement, aime la vie, sous toutes ses facettes, érotique, intellectuelle, spirituelle, amoureuse, amicale, familiale… Une dévoreuse.
La vie est tentacules chez elle, grande vivante à l’inverse d’une littérature française contemporaine petite bourgeoise ; hier celle qui veut « venger sa race », aujourd’hui celle qui cherche, catéchisme en main, son cœur dans la nuit. Oublions. Donc oui, une grande vivante, Cécile Guilbert, pour qui l’existence est aventure ou rien, une épopée. Donc oui, une grande vivante, Cécile Guilbert, par son appétit sexuel pour les femmes et les hommes, des Chinois, des Américains, des juifs, des arabes, des Noirs : peu manque au tableau de chasse international. Notons que Guilbert en des pages savoureuses ne se définit pas comme femme, toute restriction identitaire l’agace. « Il est noble d’être à rebours » écrivait Sylvain Tesson ; anoblissons Guilbert ! Dans ce livre comme dans la vie, Guilbert augmente la réalité au lieu de l’appauvrir, déploie au lieu de retrancher, et il n’y a pas lieu d’en être étonné car on la sait lectrice fervente des Chants de Maldoror, feu d’artifice qui lui aussi galvanise plus qu’il n’assomme : un des romanciers les plus rock de la littérature française ! Lautréamont, Artaud, Bataille, Sade, Casanova, voilà l’aventure intellectuelle dans laquelle elle se lance encore jeune, et Sollers, bien sûr. La rencontre qui influa sur sa trajectoire : l’énergie, le style, la liberté, le pas de côté, l’exception plus que la règle, la beauté, Nietzsche, la mort de Dieu et tout le tralala. A bonne école, Guilbert sait que le feu sacré doit être feu de joie, ce qui l’amène à partir jeune à New York, la ville où il faut être dans les années 80 (a-t-elle croisé Donald Trump ?), où elle fréquente Bret Easton Ellis et Jay McInerney, substance comprise ; excusez du peu ; la vie est amusement ou rien. Tout doit être aventure chez elle, et c’est l’aventure spirituelle qui finit par la séduire : l’hindouisme. Là, le feu sacré se fait feu de bengale ! A cette tentation, elle a résisté, longtemps, très longtemps. Sa tante Colette a tenté de la persuader de la beauté et de l’intelligence salvatrice de l’hindouisme : en vain ; la cartésienne ne veut pas en entendre parler ; ces illuminés ! Mais un voyage en Inde, dans un ashram, à Anandavadi, où elle assiste à l’agonie de son oncle,
Tito, changera tout pour elle. Elle y rencontre le guru Sri Adwayananda : « son regard-surgit d’un autre monde. Ma prosternation-corps aplati au sol de tout son long comme une crêpe. Mes larmes-incompréhensibles. » C’est le Darshan qui l’a traversée, ce « moment où l’on voit et où on est vu par le divin ». Rien que ça ! Quand le grand Om vous croque ! Conversion claudélienne !
Fini l’athéisme, fini le nihilisme, fini l’ironie parisienne ; avec son mari, David, juif athée et anciennement trotskyste (on voit le genre), railleur sur les bords mais aimant, ils s’entichent de l’Inde, la sillonnent du nord au sud, de l’ouest à l’est (rien à voir cependant avec les road trip de Jack Thieuloy), des dizaines de voyages s’enchaîneront, (occasion pour l’auteure de très belles descriptions, de Bénarès notamment) : la terre promise tient ses promesses. Guilbert, cet être métamorphique.
Une fois dit cela, cette pulsion de vie au cœur du livre, il faut ajouter que cet élan est sans cesse freiné, parfois simple ralentissement, parfois un arrêt net. C’est la grande force du récit, ce pourquoi on le dévore : il y a en effet là une tension permanente entre la vie et la mort, entre l’énergie déployée – du style : robuste, solide, percutant-, et la mort, souvent brutale chez Guilbert, parfois plus lente et douce. Le feu sacré est aussi brûlure. C’est sur la forme la grande réussite du livre : cette tension narrative nous happe jusqu’à la fin. L’un ne va pas sans l’autre chez Guilbert, tant de morts n’obligentils pas à un déploiement d’énergie hors norme ? Alors oui la vie de Guilbert est jonchée de cadavres, le suicide à 17 ans de son cousin bien-aimé ; la mort de la grand-mère adulée ; la mort de l’oncle Tito dans son ashram ; et surtout, la mort qu’on imagine par suicide, de son petit-frère, à l’âge de 40 ans. Des claques, des coups de massue, effondrement, cri, désespoir, mais aussi écrit-elle, à chaque fois, à chaque mort, une nouvelle voie empruntée. La bête blessée se relève, tant bien que mal, le cœur se remet à battre (sans tachycardie), la vie pleine et entière (ou presque) reprend. Du petit frère clochard celeste réapparaîtront dans l’esprit de Guilbert des frères en clochardise, René Daumal, Lewis Thomson, Kerouac cité en début de livre, autant dire une réactivation d’un monde ancien perçu de manière neuve 40 ans plus tard ; et le yoga, récemment, mais attention, pas le yoga pour gagas et gogos, pas le yoga développement personnel, le yoga enseigné par un grand maître !
On ne la lui fait pas, à celle qui connaît bien l’hindouisme…
Vous l’aurez compris, Feux sacrés est un grand livre incendiaire : des cendres, des larmes et des résurrections.