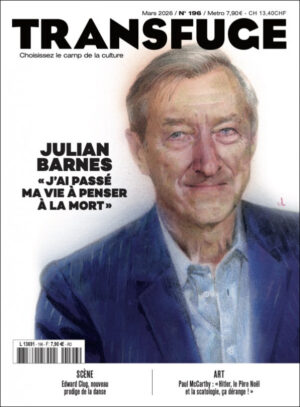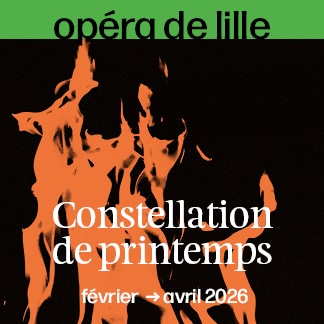Il est difficile de ne pas trahir certains livres, tant leur densité ne peut être rendue sur une simple page de journal. Le livre de Marc Weitzmann, La part sauvage, édité chez Grasset (Prix Transfuge et prix Femina) fait partie de cette catégorie où inévitable est la traîtrise. Qu’en dire ? Sinon que pour s’y déplacer avec équilibre, aisance, méthode pour ne pas s’y perdre, il faut d’emblée accepter l’idée toute pynchonienne de déhiérarchisation des informations, des pensées, des affects qu’on y trouve ; tout y est à peu près mis au même niveau : vie de Roth, vie de MW, vie américaine, vie française, géopolitique, littérature, philosophie, histoire, témoignages, biographie etc. La colonne vertébrale n’est pas comme l’annonce le bandeau de couverture, un livre sur le romancier Philip Roth, mais plutôt un livre sur un dialogue qui se noue autour des années quatre-vingt-dix, entre un lecteur-romancier-critique littéraire, MW, et le grand écrivain américain. Un dialogue fécond, bien réel, à travers une série d’entretiens menée à New York où MW finit par s’installer ; mais aussi, un dialogue de MW avec lui-même à travers la figure et l’œuvre de Roth, un long soliloque où, et c’est la grande force du livre selon moi, MW montre avec une force et une évidence rarement égalées, que la littérature produit des idées et des affects qui lui sont propres. Autrement dit, MW tire des enseignements, une sagesse pour parler comme Kundera, une profonde réflexion sur les êtres, sur la condition humaine, à partir d’une connaissance minutieuse de l’œuvre de Roth. Nul besoin des sociopathes pour éclairer le monde, nous disent les grands écrivains !
Ce dialogue permanent avec son œuvre, et c’est la deuxième grande force du livre, le lecteur y est entraîné malgré lui et noue à son tour un dialogue avec MW et Roth, et prouve par-là que ce livre est fort : de nombreuses questions (sans réponse) traversent cette part sauvage que le lecteur poursuivra en d’autres questions avec ferveur et en lui-même. Rares sont les œuvres avec lesquelles on peut entrer en dialogue ; c’est le cas ici.
Qu’en dire d’autre ? Pardon, encore un mot sur la forme. Là encore, MW se veut plus pynchonien que rothien : son rapport au temps est dingue. Il entremêle les temporalités ; des ellipses à foison, des allers et retours permanents entre les différents sujets abordés. Il faut se laisser prendre dans le flux, à parfois n’y rien comprendre mais au fond, sachant que des idées émergent, pertinentes et destructrices de pas mal de clichés (MW est flaubertien).
Sur le fond, l’essai nous explique entre mille autres choses, que le monde décrit par Roth, l’Amérique, n’existe
plus. Un monde, écrit-il, où baptiser une école Anne Franck en 2021 à Exleben en Allemagne, ne va pas de soi, « ce n’est plus adapté aux enfants d’aujourd’hui ». Un monde post-Shoah, post-juif, où le nom d’Anne Franck se retrouve dévitalisé. Un monde, continue MW, où Anne Franck a entraîné un débat vif sur les campus et dans le New York Times, pour savoir si elle n’était pas identifiable au camp des privilégiés blancs… MW pense que les jeunes lecteurs seraient bien incapables aujourd’hui de comprendre un livre de Roth, tant non seulement le monde a radicalement changé mais surtout, « le passé lui-même » a été changé. À force d’être réécrit, le monde de Roth, aussi réel fut-il, s’en trouverait une pure fiction déconnectée et donc sans fondement ni véracité.
On glanera au fil des pages une idée passionnante développée chez Roth, qui me confirme en cette rentrée qu’un livre comme celui de Nathacha Appanah, La nuit au coeur, succès du moment, passe comme beaucoup d’autres romans français, à côté de leur sujet, mais surtout à côté de la littérature. Écoutez Roth : « « si vous vous contentez de faire de vous, dans un livre, l’innocent indigné que vous êtes dans la réalité, eh bien, vous n’avez pas d’histoire. Et vous ne pouvez pas l’écrire. Pour que les choses deviennent intéressantes, vous devez vous compromettre. » Le narrateur Vierge Marie face aux monstres : ce n’est pas de la littérature !
On lira ailleurs une synthèse de ce qu’on peut trouver chez Roth : MW nous dit qu’un des axes majeurs de l’œuvre de Roth se trouve dans les pièges où ses différents personnages tombent irrémédiablement. Dit autrement : aussi édéniques soient leurs vies (on pense à « Swede » Levov, le père parfait dans son chef-d’œuvre La pastorale américaine), il y a toujours un moment où tout déraille : « Ce qui nous tombe dessus après la Victoire, l’inexplicable destruction des hommes solides ». Du Roth tout craché.
Aussi entrerons-nous dans la vie privée de Roth, par un MW qui l’a côtoyé de près. Pour y découvrir un hyperlucide sur lui-même et sur les autres, doublé d’un sentimental romantique prêt à se suicider pour un amour malheureux. Ou une autre dualité caractéristique : un bon garçon juif idéaliste qui adore Obama/Portnoy et sa masturbation, c’est-à-dire le mauvais fils.
Que dire enfin ? L’histoire des biographies successives de Philip Roth aurait mérité un livre entier, tant elle est rocambolesque, folle, signifiante ; une vraie épopée. Comme cette Part sauvage qui est une aventure littéraire et existentielle.