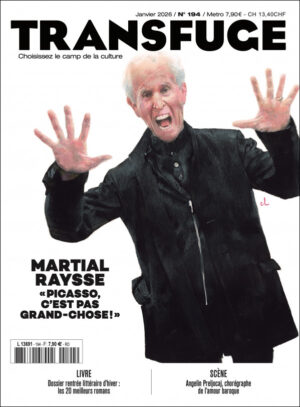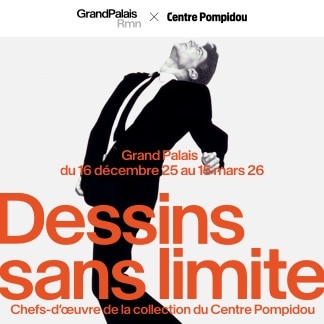La Damnation de Faust de Berlioz réinventé par Silvia Costa et porté par Benjamin Bernheim est à découvrir à Paris cette semaine : spectacle qui promet beaucoup, et ne donne pas toujours autant.
Hector Berlioz était un farceur. Depuis la création (catastrophique) de sa Damnation de Faust, en 1846, il a offert au monde musical le plus risqué des défis. Cette œuvre hybride n’est ni un opéra, ni un oratorio, mais une suite de tableaux étrangement sous-titrée « légende dramatique », ce qui veut tout dire et son contraire. Lors, de nombreux metteurs en scène ont tenté de trouver une logique dramatique à cette rêverie imitée de Goethe. Mais la Damnation n’est ni le Faust de Gounod, ni même le Mefistofele de Boito : toujours elle s’échappe et va se nicher dans les soupiraux de l’imaginaire théâtral, rétive à quiconque veut la museler. Lors, il faut une sacrée personnalité pour entendre apprivoiser le fauve ; certains y sont parvenus (Luca Ronconi, Olivier Py), d’autres non.
C’est au tour de l’Italienne Silvia Costa d’entrer dans l’arène. Artiste protéiforme, elle a travaillé aussi bien sur Shakespeare et Jules Renard que Stockhausen et Annie Ernaux. Et c’est elle qu’a choisie la toute nouvelle direction du Théâtre des Champs-Élysées pour son spectacle de rentrée. Las, le vieux Berlioz ne semble pas l’avoir beaucoup inspirée. L’idée de départ était pourtant bonne : Faust n’est pas un savant revenu de tout mais un « adulescent » reclus dans sa chambre et ses jouets d’enfance, incapable d’affronter le monde. Mais la scénographe reste prisonnière de cette unique intuition et il ne se passe pas grand-chose dans cette chambrette sordide, avec son lit une place et ses nounours décatis. Le chœur est derrière de grands rideaux, Méphisto jaillit sans emphase, Marguerite déboule comme un cheveu sur la soupe ; et le public pique du nez. Qu’une œuvre aussi touffue donne lieu à un spectacle aussi maigre, cela chagrine. On aurait toutefois tort de filer à l’entracte, car la (très brève) seconde partie, aux trois quarts de l’œuvre, offre une surprise de taille : tout à coup, l’orchestre est au centre de la scène, figurant un tribunal céleste. Et, retrouvant son dispositif primitif, la musique prend son envol, se remet à respirer. Comme si Silvia Costa avait cherché à nous prouver que Berlioz seul avait raison : sa Damnation n’est jamais plus gouleyante qu’en version de concert.
Sur scène, les artistes font ce qu’ils peuvent pour défendre leurs personnages. Le timbre séduisant de Christian Van Horn est parfait pour Méphistophélès, caverneux et expressif, mais il semble toujours en duel avec la prosodie (si ardue) du livret. Même remarque pour la superbe Marguerite de Victoria Karkacheva. La mezzo russe est vocalement magnifique mais elle pourrait aussi bien chanter en romanche : on ne le saurait pas.
Reste Benjamin Bernheim… Au départ engoncé (malade, il avait dû annuler la générale, deux jours plus tôt), il semble rétif à jouer ce personnage d’ado frénétique et son chant s’en ressent : plus tendu, moins souple. Mais vite le naturel revient au galop et Bernheim regarde Berlioz dans les yeux, conscient que tonton Hector est le seul interlocuteur digne de ce nom. Alors le ténor franco-suisse donne (comme souvent) une brillante leçon de chant français : avec cette articulation si parfaite qu’on comprend la moindre inflexion de ce rôle fleuve.
Par son caractère hétérogène, la Damnation demande une baguette de fer. Ce n’est hélas pas le cas du trop prosaïque Jacob Lehmann, à la tête de l’orchestre Les Siècles, qui se prend souvent les pieds dans le tapis d’une œuvre à maintes chausse-trappes : chœurs décalés, effets maniérés, sonorités criardes, tunnels. Il fait regretter l’absence de François Xavier Roth, fondateur des Siècles mais pour l’instant « au vert » après des histoires de mœurs. Redisons-le toutefois : la dernière demi-heure rattrape in extremis la morosité générale, comme un repas discutable est sauvé par son dessert.
La Damnation de Faust, Hector Berlioz, direction musicale. Jakob Lehmann, mise en scène Silvia Costa, au Théâtre des Champs-Elysées, jusqu’au 15 novembre