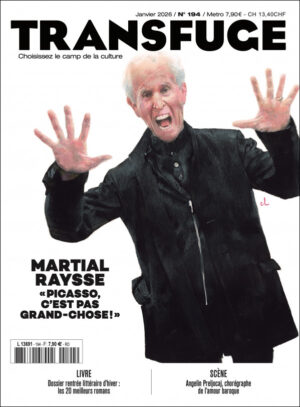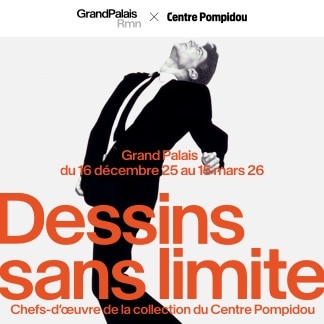Le livre commence mal. Comme souvent chez Carrère, sa machinerie romanesque peine à prendre de l’élan. Dans ce Kolkhoze, chez Pol, presque cent pages sont consacrées à la généalogie familiale, côté père, côté mère. C’est long quand on ne fait pas partie de la famille ! Mais une fois passée cette étape du roman, il faut bien dire que Carrère en resserrant son récit, à sa manière, sur l’histoire de sa mère- la célèbre Hélène Carrère d’Encausse, historienne et secrétaire perpétuelle de l’Académie française pendant plus de vingt ans (1999-2023)-, excelle ; nous emporte avec lui, de cette prose fluide qui fait son talent- une prose imperturbable, placide mais brutale par ses mises à nu- ; nous émeut, par cette mère qui était la personne la plus importante de sa vie, l’amour à l’enfance (« le petit Hélénou ») qui le liait à elle, les anicroches, les ruptures, les désamours et les réconciliations entre eux à l’âge adulte. Nous en saurons beaucoup à travers le regard de l’écrivain, du fils, sur cette mère née dans la pauvreté, russe blanche de la rue Daru, brillante intellectuelle de droite, froide, exigeante, intransigeante, mondaine, spécialiste incontestée de la Russie qui annonça en 1978 la fin de l’URSS dans son livre L’empire éclaté, mais qui commit l’erreur de penser que Poutine ne s’en prendrait pas à l’Ukraine.
Comme Albert Cohen dans le Livre de ma mère, il aurait pu écrire à l’économie, se concentrer sur elle, uniquement sur elle, sur elle et sur lui. Mais habilement, Carrère ne cesse de passer d’un ordre à l’ordre, de sa propre vie (ses amours, ses livres, sa maladie, ses amitiés), à la vie de son père (resté plus de 70 ans avec sa mère, dans une étrange non-relation), et l’Ukraine, essentiellement la guerre en Ukraine depuis 2022, pour laquelle il se passionne. 80 % de ce qu’il raconte et pense, nous intéresse, sinon nous passionne, mais pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à cela qui définissent la puissance de l’écrivain. À rebours d’une trop grande partie des écrivains français contemporains, d’un manichéisme progressiste pesant, dont les narrateurs ou narratrices, quels qu’ils soient, quelles que soient les situations, sont invariablement du bon côté du manche, Carrère a une approche du monde ambivalente. Il le dit lui-même, le plus souvent il ne sait pas vraiment quoi penser des uns et des autres, de tel ou tel évènement. Pour l’Ukraine, il est clair : antipoutine. Mais pour le reste, ses profonds doutes, s’ils ne doivent pas être toujours faciles à vivre, ni pour lui ni pour son entourage, sont une aubaine pour le grand écrivain qu’il est. Et à travers le portrait qu’il dresse de sa mère, l’on comprend vite qu’il y a un évènement matriciel qui l’explique. Sa mère est passée par l’extrême droite intellectuelle française d’après-guerre. J’ai failli écrire « droite intellectuelle », mais Maurice Bardèche dont elle a été proche dans sa jeunesse, choisit l’idéologie fasciste en 1945 ! Et tout Carrère est là : il lit l’autobiographie de Bardèche (grand ami de Brasillach), Suzanne et le taudis, pour en savoir plus sur sa mère, et trouve Bardèche, Boutang, Blondin (qu’il croisa plus tard) et les autres plein de charme (culture, humour, art de vivre, camaraderie, séduction)… Il ne les balaie pas d’un revers de main, sauf qu’il y a « l’angle mort », l’antisémitisme… qu’il trouve impardonnable. Voilà, au fond, comment il écrit ce livre génial sur Limonov, mélange de fascination et de rejet. Le romanesque d’abord, (c’est-à-dire ce qui trouble chez l’homme), la morale ensuite, et encore, en filigrane (un mot, une phrase).
Les personnes qui traversent son livre, là encore, dépareillent du roman petit bourgeois français, aux personnages aux petites vies, aux petites vues, aux petits enjeux. Il est l’anti Annie Ernaux et ses cent mille imitateurs ! Qu’on pense à l’un de ses grands amis Jean-Michel Cosnuau, libertarien qui fait fortune dans les années quatre-vingt-dix à Moscou, en ouvrant des boîtes de nuit, ô temples de la prostitution… qui finira pourchassé par le FSB puis dans les prisons russes, reviendra en France pour devenir une sorte de moine zen… Voilà les personnages qu’apprécie Carrère, et que tout bon lecteur cherchant du romanesque cherche à rencontrer. Bien sûr, si on avait le sens de la contradiction, on pourrait lui reprocher de camper exclusivement ou presque des personnages aux incroyables destins (sa grande cousine diplomate Salomé Zourabichvili deviendra évidemment présidente de la République géorgienne !). Mais l’on préférera goûter son plaisir de ces personnages plus grands que nature, que de se replonger dans un énième roman français incolore.
Comme toujours, il y a chez Carrère des intuitions fortes. Il va tout à trac trouver le mot juste, l’expression qui fait mouche. Par exemple quand il fait ce lien avec sa mère, dans son rapport à l’amour. Carrère explique qu’il a follement aimé des femmes, puis qu’il s’en est détaché à chaque fois subitement. C’est là qu’il remarque : « je suis le visage de ma mère qui se détourne sans appel ». Remarque remarquable, qui en dit long sur l’un et sur l’autre.
L’agonie de la mère des cent dernières pages est douloureuse, pour lui et pour le lecteur ; offrant à la littérature des pages inoubliables sur la mort, sur la mort d’une mère pas comme les autres, mais aussi semblable à toutes. « Elle comptait sur moi à l’heure de sa mort » ; l’académicienne aimait son fils. « J’aurais prié pour être prêt quand cette heure arriverait » ; lui aussi.
Je ne vois pas, cette rentrée, un livre à la hauteur de celui-ci : roman russe, roman français, roman ukrainien, roman du deuil de la mère- en cette rentrée littéraire. J’avais prédit l’année précédente la victoire de Kamel Daoud au Goncourt. Aurais-je raison une deuxième fois ?