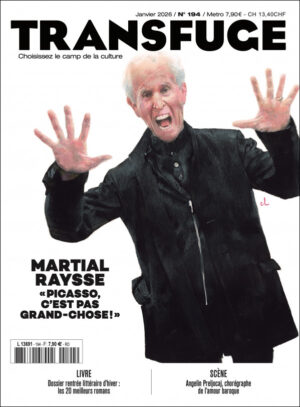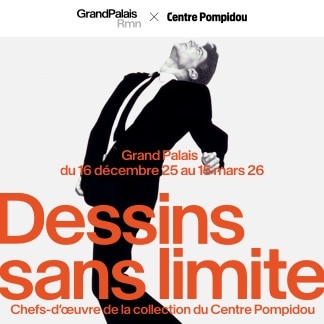L’été approche, lentement mais sûrement. Certains sortent leurs espadrilles, d’autres leurs livres ; parfois les deux.
Et l’on se demande ce que l’on va lire. Dans des genres très différents, mais plutôt côté essai, j’ai lu ce mois des livres très stimulants. J’ai commencé par la réédition aux Cahiers rouges des mémoires de Marlène Dietrich, un régal ! L’on découvre une femme au caractère trempé, brutal même, « têtue comme une Allemande » ; celle qui devait devenir violoniste (enfance dure, 8 heures de travail par jour), qui connaissait les textes de Goethe par cœur, lectrice de Kant aussi, allait devenir « la chose » du réalisateur Joseph Von Sternberg ; chose magnifiée dont Dietrich est si fière : « J’étais sous l’emprise divine et démoniaque de Von Sternberg » ! C’est un « génie » écrit Dietrich, que demander de plus. « Il était un confesseur, un critique, un maître, le pacificateur de mon être et de mon foyer, mon patron absolu… » Voilà qui est dit, pas tout à fait air du temps. Elle a failli ne pas avoir le rôle de L’ange bleu, la UFA ne croyait pas en elle, mais surtout, Emil Jannings, star du film et bientôt nazi, n’aimait que les femmes « aux grosses fesses », ce qui n’était pas le cas de l’actrice ! Le tournage se passa mal, Jannings ne cessa de lui dire qu’elle était une mauvaise comédienne. Elle ajoute qu’il lui a été difficile de jouer ce rôle de femme vulgaire, elle qui venait d’une famille bourgeoise et civilisée. Les acteurs qu’elle croisait ? « Des pois chiches à la place du cerveau ! ». Chaplin ? « Arrogant, mais ça me convenait, car c’est un géant ». Richard Burton ? « L’homme pour qui l’on a inventé le mot charisme, l’idéal dont toutes les filles et toutes les femmes rêvent. Hélas, je l’ai rencontré alors qu’il était très amoureux d’une autre femme ». Orson Welles avec lequel elle fit La soif du mal, une journée de tournage mais le coup de foudre et une amitié éternelle : « Des phrases éblouissantes ne cessaient de fuser de sa bouche ».
Lui aussi a du charisme, des idées et du style. C’est Philippe Val qui fait paraître à l’Observatoire l’ensemble de ses chroniques tenues sur Europe 1, La gauche et l’antisémitisme. Val mériterait le titre de Juste tant son combat acharné contre ceux qui n’aiment pas les juifs, est remarquable. Des formules et des idées : « Il nous reste à apprendre un tout petit mot, NON. Et à disqualifier systématiquement tout parti, tout organe d’information ou toute personne politique compatibles avec l’antisémitisme. Car il n’y a pas d’antisémitisme possible sans collaboration avec les antisémites. En 1943, Hitler a demandé aux Danois de lui livrer les juifs. Les Danois ont dit NON. Vous savez ce qui s’est passé ? Rien. Hitler a renoncé. A nous désormais d’avoir le courage de dire NON. » Val se demande ailleurs pourquoi Céline n’est pas cancellé par la gauche vertueuse, malgré un antisémitisme forcené ? Les Juifs auraient-ils un statut différent des autres minorités ? Ajoutons que Val est un ardent défenseur de ce qu’il appelle « l’esprit européen », à travers la « liste merveilleusement interminable » de grands noms, Homère, Montaigne, Shakespeare, Cervantès, Voltaire, Mozart, Nietzsche, Freud…tous ces noms pour combattre jadis le communisme et le nazisme, aujourd’hui, le dernier totalitarisme, l’Islam politique.
Direction maintenant l’Indonésie, pour un ouvrage passionnant, La java des Jésuites, une autre histoire des relations islamo-chrétiennes du XIX et XXIe siècle (Le cerf), de Rémy Madinier. Ou comment les Jésuites eurent des relations apaisées avec les musulmans pendant plus d’un siècle, jusqu’aux années 70 où l’Islam politique prit de l’ampleur dans ce pays. Ou comment certains jésuites tel François Van Lith à la fin du XIXe siècle, malgré une rivalité avec les protestants et les francs-maçons en termes d’influence, tenta de fondre dans un syncrétisme osé, le catholicisme dans le bouddhisme, l’animisme et l’islam. Il parlait le javanais, connaissait parfaitement la culture du pays, et jamais n’avançaiten civilisateur supérieur. D’autres jésuites manquèrent à leur tâche, comme Hoevenaars ou encore Joop Beek dans les années 60-80, tous deux très politiques, méprisant les populations locales, proche pour le premier du pouvoir colonial hollandais alors que les missions, le plus souvent, tentaient de garder leur distance avec celui-ci ; et proche pour le second du général Suerto, fondant un service secret très performant, notamment pour infiltrer le milieu communiste, au fond le grand ennemi des Jésuites tout au long du siècle.
D’Indonésie passons à la Chine, avec un extraordinaire essai de Romain Graziani. Les lois et les nombres, essai sur les ressorts de la culture politique chinoise, chez Gallimard. De manière fort habile, Graziani établit un continuum entre l’antiquité et la période contemporaine chinoise. Déjà sous l’antiquité, l’État chinois est total, prend entièrement sous sa coupe les individus, jusqu’à leur vie privée, « du ciel à la terre ; déjà, la bureaucratisation tentaculaire et tatillonne, déjà une pratique de l’évaluation, de la notation, du classement, si présente aujourd’hui en Chine, et dominante dans le monde entier ; déjà une obsession pour l’Unité du pays, à rebours de nos sociétés démocratiques diffractées ; déjà une révérence pour le chef ; déjà une société de la surveillance, « le ciel dont l’œil voit tout » disait-on sous l’antiquité ; déjà, à travers nombres et lois, une volonté de limiter l’arbitraire du chef par la mise en place d’une gouvernance impersonnelle, à travers des normes objectives, d’où une méfiance pour le charisme, ennemi de l’esprit chinois. Le Maoïsme qui est un césarisme, fut donc une entorse à la culture ancienne du pays. Grâce à Graziani, ce pays à nos yeux si mystérieux, et ainsi fascinant, lève un peu le voile.