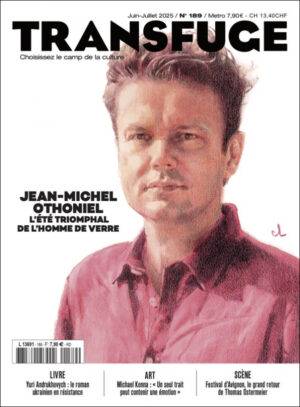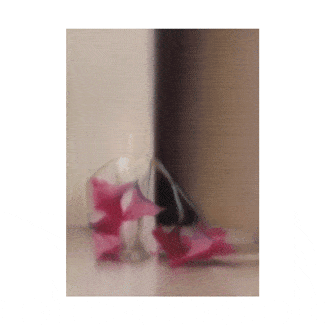Pour sa première incursion dans l’univers de l’opéra, le cinéaste et plasticien signe une mise en scène sensuelle et prenante de Tristan et Isolde de Richard Wagner.
Des corps féminins nus qui se caressent et s’enchevêtrent, qui se superposent ou s’enroulent incessamment les uns avec les autres comme mus par une force élémentaire irrépressible à la fois enveloppante et se déployant à l’infini, telle est la vision étrangement prenante qui saisit le spectateur face à la version singulière qu’offre Philippe Grandrieux de Tristan et Isolde. Ce cinéaste et plasticien ne s’était encore jamais aventuré dans l’univers de l’art lyrique avant que Jan Vandenhouwe, directeur de l’Opéra Ballet de Flandres à Gand en Belgique, lui propose de monter l’opéra de Wagner. Cette proposition n’était évidemment pas due au hasard, mais le fruit du choc éprouvé par Jan Vandenhouwe face à la performance White Epilepsy de Philippe Grandrieux, inspirée par l’essai, Homo Sacer, Le Pouvoir souverain et la vie nue de Giorgio Agamben.
Sans s’être particulièrement intéressé à l’opéra jusque-là, le cinéaste s’est immergé dans l’œuvre de Wagner dont l’intensité enivrante l’a littéralement happé non sans provoquer chez lui un certain trouble. « À l’écoute, j’ai tout de suite été impressionné par la présence des voix de femmes et par les figures de Brangäne et Isolde. » En analysant le livret quelque chose lui semble d’emblée évident, qui va orienter son interprétation. « Il n’y a pas d’amour, mais une illusion due aux effets du philtre qu’Isolde a bu par erreur. D’ailleurs quand Tristan la regarde pour la première fois, elle n’est pas complètement dupe. Elle comprend qu’il la jauge pour s’assurer de ce qu’elle convient bien au roi Marke à qui elle est destinée. » Malgré ce point de départ hésitant, un élan irrésistible ne tarde pas à emporter les deux protagonistes dans une passion dont la caractéristique principale est peut-être qu’elle les dépasse totalement.
Somnambules
Pour Philippe Grandrieux Tristan et Isolde sont comme des somnambules entraînés dans une dynamique sur laquelle ils n’ont aucune prise. « Que ce soit Isolde ou Tristan – mais surtout Isolde, à vrai dire – tous deux sont perdus, comme noyés dans un flux qui les soumet aux variations du désir. C’est pour ça que j’ai choisi de les immerger dans une image très grande dans laquelle ils sont comme perdus. Parfois on les discerne vaguement. Parfois on les voit mieux. L’idée étant d’offrir une mise scène rêvée de l’opéra. » L’image au sein de laquelle apparaissent ou disparaissent les chanteurs consiste en un film réalisé en amont par le cinéaste. Projeté sur un tulle tendu à l’avant-scène, on y voit évoluer des corps nus de danseuses. « L’idée c’est que le public soit envahi, par la musique, par les voix, par le son. Mais pour que cette immersion soit effective, il faut aussi travailler sur la qualité du visible, jouer sur des variations de points de vue, sur ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. À cet égard la question de la présence obsédante des corps, que j’ai déjà abordée dans des créations précédentes, est essentielle. »
Selon Philippe Grandrieux, l’image ne doit pas être plaquée sur la musique mais former un tout avec elle, fidèle en cela à la notion d’œuvre d’art totale chère à Wagner. Tout est question de rythme. Et pour cela il a fallu effectuer un travail de haute précision en montant le film. « C’est une opération particulièrement délicate qui nous a demandés beaucoup de temps. Il y a plusieurs couches d’images travaillées au montage. Mais à l’arrivée il n’y a qu’une seule image projetée qui fait trembler, vibrer. Il fallait saisir le rapport plus intime, plus souterrain, entre ce que l’on voit et la musique. Ce qui est exceptionnel chez Wagner, c’est la continuité de la mélodie ; comment clarinettes, hautbois, cordes s’interpénètrent les uns les autres. À l’écoute on ressent un aspect océanique de masse qui se déplace lentement comme une espèce de respiration. Cette sensation m’a beaucoup intéressé. Avec en même temps le sentiment d’une tension qui serait comme suspendue. »
Entre Schopenhauer et Freud
Quand il analyse après coup cette première incursion dans l’opéra Philippe Grandrieux la voit comme « une grande installation », insistant sur sa dimension plastique, mais sans oublier les caractéristiques qui rejoignent des préoccupations déjà abordées dans ses œuvres précédentes. « L’érotisme, c’est l’approbation de la vie jusque dans la mort », écrivait Georges Bataille. Pensait-il à Wagner ? Impossible en tout cas de ne pas voir dans Tristan et Isolde la tension permanente entre l’érotisme et la mort, tout comme entre le jour et la nuit. Philippe Grandrieux : « On se situe quelque part entre Schopenhauer et Freud avec le désir inassouvi qui fait la souffrance et le malheur et la pulsion qu’est l’élan vital. Cette énergie sexuelle, mais pas seulement, qui revient sans cesse, qui ne peut jamais s’arrêter, c’est ça qui fait qu’à la fin Isolde aspire à se dissoudre dans l’infinité de l’univers. » De ce mouvement en forme de va-et-vient, où le désir se nourrit en quelque sorte de son inassouvissement, le cinéaste donne une version profondément sensuelle.
Habitué à travailler sur ses tournages dans une grande proximité avec les acteurs, il a, de la même façon, géré au plus près le jeu des chanteurs. « J’ai beaucoup travaillé sur leurs mains. Les mains sont comme des planètes qui se déplacent, qui s’approchent, qui s’écartent. Les mains et le regard, c’est ce qui exprime le mieux la vérité des sentiments. Les chanteurs ont été surpris au début de ma façon de travailler, d’être si près d’eux et de laisser venir la nature de leur être. L’intériorité, la traversée intime, la voix, la dimension physique, matérielle du chant, c’est quelque chose contre quoi il ne faut pas aller. Prendre en compte le fait qu’il y a une sorte d’exténuation chez Tristan, quelque chose qui s’éteint dans la fatigue. De même chez Isolde, c’est si émouvant d’entendre comment elle creuse ses intensités musicales, l’éclat ou au contraire l’épuisement de la voix. Il y a toujours une idée de performance en ce qui concerne la voix à l’opéra. Or pourquoi ne pas prendre en compte aussi la possibilité que la voix ne soit pas seulement audible. Il y a là, me semble-t-il, une approche qui mériterait d’être explorée. »
Tristan et Isolde, de Richard Wagner, mise en scène, lumières, vidéo, scénographie, chorégraphie, Philippe Grandrieux, direction musicale Ben Glassberg. Du 15 au 22 juin à l’Opéra de Rouen.