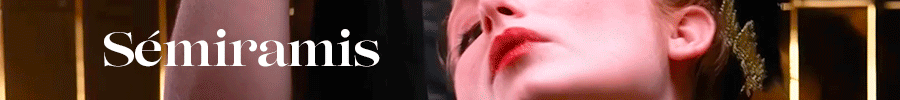Nous y sommes. Le nouveau Ellis, Bret Easton Ellis, tant attendu depuis Suite Impériale (2010), est arrivé. Ample, ambitieux, déraisonnable. Retour à Los Angeles, retour sur la ville de son adolescence, retour à Moins que zéro, Less than zero, son premier roman paru aux États-Unis en 1985 ; il a 21 ans. Le jeune prodige vient à Paris, est édité par la meilleure maison d’édition française de l’époque : Christian Bourgois. Dominique Bourgois me disait qu’elle se souvient de lui : insupportable. Arrogant, évidemment. 37 ans plus tard, Ellis a parcouru du chemin ; il revient à Los Angeles avec ce magnifique roman, Les Éclats. Mais l’écrivain n’est plus le même, l’homme non plus. Si Moins que zéro racontait la vie de jeunes ados huppés, dont sa vie à lui, Ellis, Les Éclats braque un projecteur à la lumière plus diffuse, cadré large, panoramique pourrait-on dire. Il s’agit bien d’un roman, d’un très grand roman, hyperréaliste, sur Los Angeles. Sur le Los Angeles des eighties. Voilà l’ambition d’Ellis ; le vrai sujet du livre. Pas comme je l’ai lu bêtement dans un article, un livre sur son outing homosexuel, qui n’est rien d’autre qu’une simple information biographique. Non, un incroyable portrait de LA.
Pas un nom de rue manque ; pas un nom de restaurant, de club, de cinéma, de mall qui manque ; pas un paysage qui n’est pas décrit. Comme West, Fante, Bukowski, Frey, Ellroy, Ellis nourrit, abreuve, redore le mythe : Los Angeles. La ville suce le sang de ceux qui y habitent et Ellis le lui rend bien. Un des grands plaisirs de lecture de ce roman tient aux images, aux histoires, aux personnages qui frappent à la porte de notre imaginaire : le coup de la Cassette Maxell, c’est Lynch ; le côté voyeur-sexuel-ludique, c’est Palma, l’aspect cool et musical, c’est Tarantino. Nous sommes tous américains.
J’ai lu ici et là dans les critiques du livre, qu’Ellis était un écrivain « efficace ». Il n’y a rien de plus faux que de dire ça. C’est la faiblesse d’Ellis. Le roman est très répétitif, construit sous forme de boucles. Il ne sait pas bien faire avancer son récit ; le roman, souvent, mériterait un bon coup de pied aux fesses. Ceci étant dit, c’est un faux problème ici, pour deux raisons. La première : l’adolescence se prête parfaitement à cette sensation de surplace ; ses personnages passent de villa en villa, sans autre objectif que le plaisir immédiat (drogue, sexe et rock’n’roll). La seconde : Ellis a une nouvelle fois trouvé une solution pour donner de l’élan à son roman : introduire au récit un serial killer. Ellis adore les tueurs en série, comme tout le monde. Quoi de plus fascinant que ces dingues à l’esprit maniaque ? C’est clairement l’histoire du Trawler qui donne l’impulsion au Éclats, et fait que nous tournons la page avec entrain et délice. L’artisan Ellis sait y faire.
J’ai lu aussi dans une critique qu’il s’agissait d’un roman nostalgique ; lui-même l’affirme dans l’entretien qu’il nous a donné. Mais étrangement, rien dans le roman indique la nostalgie. Aucune tristesse n’y transparaît, aucun propos désespéré sur le temps qui est passé entre le Ellis de 57 ans et le Ellis adolescent ; aucune déploration. C’est que le souffle du livre, les nombreux personnages, les nombreuses intrigues, les nombreuses scènes ne laissent aucune place à l’apitoiement. Aucune place à la détresse face à un temps destructeur. Le présent de l’action est le carburant du livre ; l’élan vital gagne haut la main son match contre la mort.
Un point politique. Le livre est une bombe. La fameuse scène de sexe du producteur Terry Schaffer qui abuse du jeune Bret, mineur, se conclut par un « Quel est le problème ? ». Ce « Quel est le problème ? » est un renversement absolu de l’idéologie #Metoo pour laquelle c’est précisément LE problème. La presse de gauche, si sourcilleuse habituellement, ferme les yeux. Il faut dire qu’elle a mis trente ans pour s’apercevoir que Michel Houellebecq était réactionnaire !
Autre chose. Il lui a été souvent reproché de ne pas approfondir ses personnages ; on lui reproche encore. C’est vrai que l’on n’est pas chez Proust. Mais il s’agit d’un mauvais procès, surtout lorsqu’on écrit sur l’adolescence. Ellis écrit de ses personnages qu’ils « flottent émotionnellement ». C’est bien ça : une des forces du roman est cette capacité à se tenir sur cette ligne de flottaison. Quelle plus belle définition de l’adolescence que le flottement ?
On dit par ailleurs, et on le répète encore ces derniers jours ad nauseam dans la presse, qu’Ellis serait cynique. Certes, dans Les Éclats, des personnages comme le producteur Terry Schaffer en sont une parfaite incarnation. Mais c’est oublier qu’Ellis dessine ici une très belle relation, sentimentale, désintéressée, fraternelle : Tom et Bret, lien qui est un des cœurs battant du roman. Il y a une loyauté entre eux qu’on n’avait jamais lue dans un roman d’Ellis. Une authenticité ; de l’amour, platonique. Cette relation donne un charme particulier au livre : le charme de l’innocence.
Mais Ellis reste Ellis, et c’est bien le mensonge qui traverse tout son roman. La note dominante. Il nous le fait voir de près, le mensonge : la perversion de celui qui le profère ; la petite prise de pouvoir mesquine du menteur sur le dupe ; sa perfidie destructrice et autodestructrice, sa duplicité, son hypocrisie menant au pourrissement sinon au meurtre. Il y a des trouées de vérité, bien sûr, dans ce roman ; des éléments autobiographiques réels. Ellis est un magicien distillant du vrai dans le faux et du faux dans le vrai. Mais ces trouées de vérité ne font pas un roman. Ellis le sait mieux que quiconque : le mensonge est une aubaine pour un romancier. Car il entraîne la paranoïa, et la paranoïa la fiction, et la fiction une distorsion du réel, et la distorsion la folie.
Toute l’histoire du livre est l’histoire d’une paranoïa qui détruit tout sur son passage ; une paranoïa qui entraîne la terreur, qui, cagoule de ski et couteau à la main, crève « la bulle » de bonheur de ces hyperriches. Le bain de jouvence s’est mu en toile d’araignées. Toi qui entres ici, abandonne tout espoir. Ellis s’est bien amusé.