Une délicieuse dérive romanesque – tel est le roman de Sigrún Pálsdóttir, vivifiant comme un frais vent islandais !
Suffisamment mince pour pouvoir se glisser dans une enveloppe (de taille honorable toutefois), le roman de l’Islandaise Sigrún Pálsdóttir n’a pourtant nul besoin d’un écrin timbré de papier kraft. Car, dans ses intentions formelles, rigoureuses et pourtant libres, dans son esprit à la fois songeur et nerveux, fantasque et résolu, dans son art de concentrer en de prestes raccourcis les nécessités et les attentes du roman historique (peinture physionomique des milieux et des cultures, des taudis du New York de l’industrie textile de la fin du XIXe siècle au Metropolitan Museum, sans oublier cette « lointaine périphérie » qu’est, pour l’héroïne, Sigurlina, son Islande) – tout est gouverné selon le principe de l’enveloppement.
Le roman commence-t-il dans la Reykjavík de la fin du XIXe siècle ? Sigrún Pálsdóttir conçoit pour cette époque la doublure d’un passé ancien, là où les mythes se fondent à l’horizon de l’Histoire – un domaine que le père de Sigurlina explore comme l’ont fait tant de ses contemporains penchés sur les passés nationaux. Sigrún Pálsdóttir évoque-t-elle la menue monnaie des tâches domestiques de Sigurlina ? Comme dans une bourse tissée d’une étoffe inconnue, ce prosaïsme quotidien est niché dans un monde qui est rêvé autant que vécu – car Sigurlina a la pensée capricieuse, la conscience volatile, une puissante propension à la rêverie : « L’esprit subitement vagabond, elle se retrouva ailleurs un long moment. À la fois partout et dans un lieu précis ».
Si le livre ne cesse d’être régi par un mode alternatif aussi familier qu’efficacement employé où l’idéal et le réel se mêlent et se heurtent, la méthode de Sigrún Pálsdóttir ne s’y réduit pas. Les recouvrements et les enveloppements affectent la géographie : à l’Islande du premier chapitre succède New York ; au père de Sigurlina se substitue alors un autre érudit, bibliophile et nanti, dont elle sera désormais l’assistante – jusqu’à ce que des cinquante pièces de la demeure de son nouvel hôte, les circonstances ne jettent la jeune femme dans l’âpreté du New York ouvrier… Tout se plie, se replie et se superpose sans relâche, et au centre de toutes ces couches il y a un prétexte, qui finit par tenir du talisman, ou d’on ne sait quel objet maudit, qui est comme le premier moteur de toute cette prodigieuse activité et que je m’interdirai de nommer ici. Non que Sigrún Pálsdóttir en fasse mystère, mais pourquoi s’attarder ici pointilleusement, sérieusement à en parler alors que tout le roman est porté par l’espèce de griserie communicative qui tient au roman populaire ? C’est à celui-ci que Sigrún Pálsdóttir emprunte les heureuses désinvoltures de son récit ; car Un coup de tête vit dans cette atmosphère tonique et rêveuse, facétieuse et déroutante qui est celle de la littérature, des textes et des imaginations, qui emmaillotent tout. Ou, selon, Sigurlina, « Parfois, elle avait l’impression de ne plus vraiment exister, l’impression qu’il n’y avait plus aucune réalité en dehors de celle du texte. »
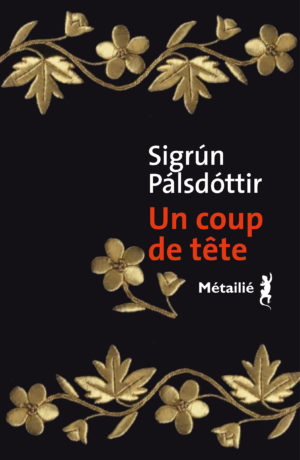
Sigrún Pálsdóttir, Un coup de tête, traduit de l’islandais par Éric Boury, Métailié, 192 p., 19 €












