Hantée par l’exil et la nostalgie, l’auteure des Séparés et de L’autre Joseph revient sur la vie déchirante des Géorgiens émigrés en France avant la chute du mur de Berlin.
Une décennie avant le démantèlement du bloc soviétique, une famille de Géorgiens émigrés à Paris entretient un lien douloureux avec leur pays d’origine. Daredjane, la mère, a renoncé à sa carrière de danseuse pour épouser Tamaz dont les parents s’étaient établis en France ; ils ont deux filles, Kessané et Tina : nous découvrons leur vie au point de vue de l’aînée et de Daredjane, en alternance. À la suite de la mort prématurée du père, un deuil impossible, exacerbé par l’exil et la nostalgie, ronge les trois femmes. Autrefois indéfectiblement complices, les voici à couteaux tirés. Les deux sœurs se brouillent en accumulant des malentendus sur une rivalité qu’avive leur mère, laquelle veut qu’on la « laisse tranquille avec son chagrin ». La hantise délétère d’un passé dont elles n’arrivent pas à se délester les éloigne davantage.
La guerre d’Abkhazie, qui déchira la Géorgie au début des années 1990, est la toile de fond de ce roman intimiste. Les séparatistes abkhazes, soutenus par les soviétiques puis par l’armée fédérale russe, firent sécession pour constituer une république autonome. C’est là que se trouvait la maison des parents de Daredjane, « paradis perdu » où les trois femmes reviennent inlassablement par le souvenir sans parvenir à s’y retrouver. Depuis lors, la Géorgie leur paraît amputée. « Le mal de l’Abkhazie poursuivra Kessané, comme il poursuivra sa mère et sa sœur, incapables de se consoler mutuellement. » La jeune femme se défend contre leurs remarques acerbes : « Le gel s’était installé, la meurtrissait, mais lui servait d’armure. »
Kessané se rappelle cette époque tragique où elles étaient victimes des brimades du régime soviétique chaque fois qu’elles faisaient escale à Moscou, entre Paris et Tbilissi (le premier chapitre du roman décrit leurs humiliations, assorties de menaces, aux postes de contrôle). L’image récurrente de la vaisselle de la grand-mère qui diminue à mesure que les femmes en brisent les précieuses pièces souligne l’irréversibilité de la blessure. Au début de leur relation, Tamaz essayait d’appeler Daredjane de Paris au téléphone, et « le son de sa voix était une fenêtre ouverte sur un jardin inaccessible ». La France dont elle rêvait, comme tant de Géorgiens, à la manière de Romain Gary pendant son enfance en Lituanie et en Pologne, n’est pas exactement un pays d’Oz.
Le style minimaliste de Kéthévane Davrichewy évoque la devise d’une célèbre entreprise suédoise de mobilier en kit : FFF, « forme, facilité, fonctionnalité ». La tristesse de son propos contraste avec la blanche vivacité de la narration, mais une idée de son lointain pays se forge au fil des pages. La romancière est l’une des plus fières ambassadrices de la Géorgie, comme la pulpeuse pianiste Khatia Buniatishvili, l’ancien directeur de la Bibliothèque nationale Levan Berdzenishvili et les trois jolies fées bucoliques du Trio Mandili. Il est d’ailleurs dommage qu’elle ne signe pas ses livres de son patronyme in extenso, Kéthévane Davrichewy Davrichachvili.
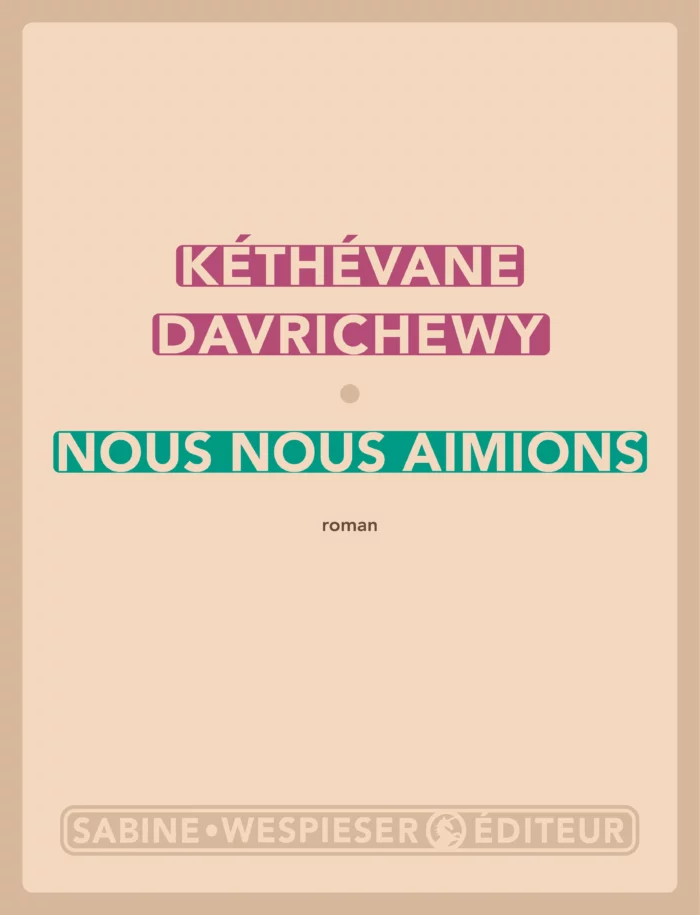
Nous nous aimions. Kéthévane Davrichewy. Éditions Sabine Wespieser. 152 p., 19 €










