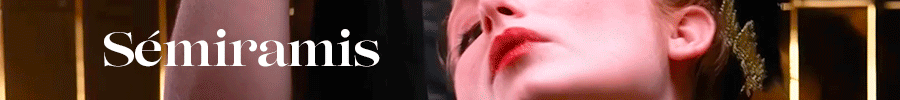Retour de César Aira avec un petit livre étourdissant d’intelligence et de style.
Les dimensions du petit volume de César Aira, qui paraît ces jours-ci chez Christian Bourgois, sont inversement proportionnelles à l’impression abyssale, de vertige, qu’il suscite. C’est le tour de passe-passe d’un prestidigitateur suprêmement doué. Débonnaire et prévenant, certes, s’empressant toujours de donner les mille détails que cet affamé d’illusion réaliste qu’est le lecteur réclame pour s’en rassasier. Aussi, de la bourgade argentine de Coronel Pringles, connaîtra-t-on tout. Le titre de l’unique feuille de chou subsistante, El Orden, et sa politique, ou plutôt son incurie, éditoriale. Le Melody, ce dancing anachronique, et ses soirées, ces « Esquisses Musicales », qui donnent son titre au livre. Les rives du Pillahuinco, son paysage de pastorale, le nuancier de lumière qui l’habille, le jeu des saisons, les clochards plus ou moins philosophes qui le hantent. Sans oublier le Palais – pompeux sobriquet de l’hôtel de ville – qui occasionne à lui seul un de ces morceaux de bravoure descriptive que, mine de rien, les phrases fluides, en perpétuel mouvement, d’Aira, enchaînent avec une constance qu’on croyait réservée aux plus obèses des romans. Et la grande Histoire (un bombardement, lors du putsch de 1955, qui met sens dessus dessous la forêt aux abords de la ville) vient compléter le tableau.
Au centre de cette petite scène de la vie de province en Argentine, il y a un peintre. Qui n’a peut-être jamais peint. Même si, dit-on, on lui a confié la réalisation des fresques du « Palais ». Lesquelles « ne furent jamais réalisées ou […] ne furent rien d’autre qu’un épisode imaginaire dans la légende du peintre ». Légende que raconte un narrateur, double de papier d’Aira, qui confesse dès la première page que cette vie d’artiste – ou plutôt fin de vie, l’artiste en question étant commerçant à la retraite – relève de la littérature et de la « désinvolture ».
Ce Bartleby supposé (supposé, car à force de l’appeler « le peintre », Aira nous fait douter de notre doute sur sa créativité…), pratique, dans son cabanon au bord du Pillahuinco, comme un exercice spirituel, l’art de « se déconcentrer », afin d’« étendre son attention au-delà d’elle-même ». Une déconcentration qui affecte aussi l’écriture, sur un mode dont la nonchalance joyeuse ne doit pas occulter la redoutable puissance rhétorique. Aira, dont le romanesque est métaphysique, est l’écrivain du « peut-être » systématique, du balancement toujours irrésolu. Posant un épisode, une hypothèse, pour envisager aussitôt sa dissolution, comme si le rôle de la conscience n’était pas de se fixer sur les choses, mais de les percevoir de manière flottante. La substance bien matérielle du quotidien de Coronel Pringles s’effiloche. Tout le lest de faits, d’événements et d’individus n’est qu’un leurre. L’escamoteur Aira dérobe la réalité, comme on tirerait le tapis sous les pieds du lecteur, qui vacille. Le héros d’Aira est peut-être un peintre sans œuvre mais, plus troublant encore, un peintre qui n’a rien à peindre.
César Aira, Esquisses Musicales, traduit de l’espagnol (Argentine) par Christilla Vasserot, Christian Bourgois, 120 p., 15 €
À noter aussi, César Aira, Le Tilleul, traduit de l’espagnol (Argentine) par Christilla Vasserot, Christian Bourgois, 120 p., 15 €.