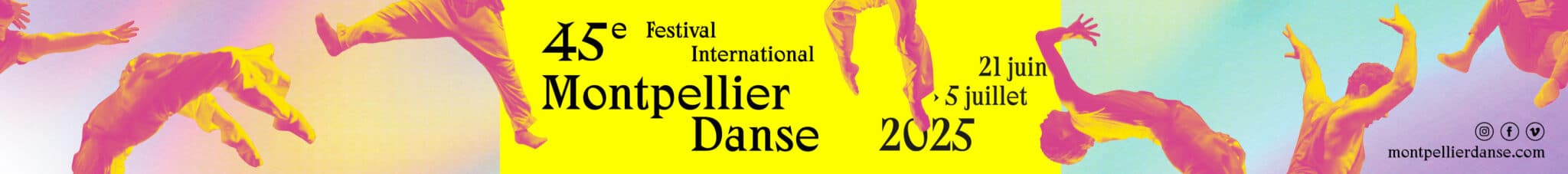Flash-back. Cannes 2015. Projection du Gus Van Sant. Une rumeur, d’abord discrète, enfle dans la salle : une polyphonie de ricanements gênés, de toux narquoises. Sans doute l’antipathie des ayatollahs de la Croisette tient-elle à ce que Gus Van Sant travaille sans filet son matériau de prédilection : le sentiment, dans ce qu’il a de plus brut. Ici, nul « grand sujet » qui ennoblirait la substance mélodramatique, comme l’énigme de la violence dans Elephant ; nulle figure mythique en voie d’apothéose vers le panthéon pop, comme le double de Kurt Cobain dans Last Days, seulement ça : l’affect, la douleur, les larmes.
Flash-back. Cannes 2015. Projection du Gus Van Sant. Une rumeur, d’abord discrète, enfle dans la salle : une polyphonie de ricanements gênés, de toux narquoises. Sans doute l’antipathie des ayatollahs de la Croisette tient-elle à ce que Gus Van Sant travaille sans filet son matériau de prédilection : le sentiment, dans ce qu’il a de plus brut. Ici, nul « grand sujet » qui ennoblirait la substance mélodramatique, comme l’énigme de la violence dans Elephant ; nulle figure mythique en voie d’apothéose vers le panthéon pop, comme le double de Kurt Cobain dans Last Days, seulement ça : l’affect, la douleur, les larmes.
Celles d’Arthur (Mat thew McConaughey, parfait en quadra en pleine dérive existentielle), qui prend un aller simple pour le Japon. Destination : la forêt d’Aokigahara, ses frondaisons bruissantes sous la houle du vent, cet océan de verdure où les éclopés de la vie viennent des quatre coins du monde mettre un terme à leurs jours. Une vraie forêt des contes qui exerce un inexplicable attrait sur les suicidaires, qui disparaissent dans le dédale de ses futaies, derrière les murailles minérales de ses rocs. Arthur a perdu sa femme, Joan (Naomi Watts, parfaite égalementen descendante d’héroïnes sirkiennes,avec ses oscillations pendulaires demal-être et d’alcoolisme), Arthur veut mourir, il franchit la lisière de la forêt, silhouette incongrue dans son imper, s’assoit et, comme un samouraï au bord du seppuku, sort un flacon de petites pilules. GVS prouve en quelques mouvements qu’il est un immense metteur en scène : gros plans sur une fourmi en vadrouille sur les chaussures d’Arthur, sur une libellule. C’est la vision de quelqu’un qui veut mourir, et autour de qui le monde se réduit à presque rien. Mais voilà qu’un autre homme fait irruption : titubant, hagard, maculé de terre et de sang, Takumi (Ken Watanabe) entre dans le champ. Arthur fait taire sa douleur, la compassion prend le pas sur la délectation morose, et les deux hommes tentent de trouver la sortie de cette étrange forêt qui, comme un cauchemar, les tient captifs. Au fil d’une errance chaotique, Arthur raconte l’histoire de son couple via d’amples flash-backs. L’inquiétante étrangeté des premiers plans laisse la place à de vrais moments de survival, avec des corps martyrisés par la nature hostile, comme un Délivrance sans les ploucs bestiaux. Une histoire scandée par une alternance d’amour fou et de déchirements. Mélo, oui, mais qui s’affranchit de tout ce qu’il a d’anecdotique. Comme lors de cette scène où, autour d’un feu de camp de fortune qui se reflète dans le verre brisé de ses lunettes, Arthur se met à sangloter. Les larmes, le feu qui brûle dans ses yeux et, tout autour, la sombre forêt de la mort. Soit les ingrédients du mélo à l’état pur. Il y a quelque chose de platonicien dans Nos souvenirs. Une façon de toucher à l’essence de l’émotion sur grand écran.