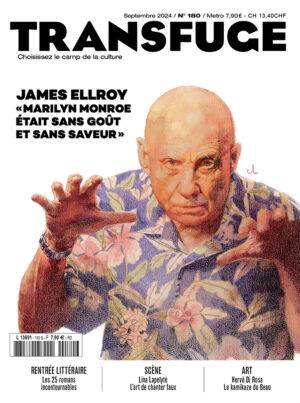Toutes les mines n’ont pas la même mine. Si, au Nord, ce sont les corons, le vitalisme fiévreux d’un Zola ou la truculence crapoteuse d’un Camille Lemonnier, plus au nord encore, au Danemark, c’est l’ère glaciaire. La mine de calcaire de Winter Brothers, où triment deux frères, Johan et Emil, semble en voie de pétrification. Le duo arrondit ses fins de mois en trafiquant leur alcool-maison, un redoutable tord-boyaux cent pour cent chimique. Jusqu’au jour où un de leurs clients ne résiste pas aux rasades de leur décapant éthylique. Pivot dramatique, point de bascule, dirait-on dans les écoles de scénario. Sauf que rien ne bouge vraiment, tout est toujours éternellement plombé.
Toutes les mines n’ont pas la même mine. Si, au Nord, ce sont les corons, le vitalisme fiévreux d’un Zola ou la truculence crapoteuse d’un Camille Lemonnier, plus au nord encore, au Danemark, c’est l’ère glaciaire. La mine de calcaire de Winter Brothers, où triment deux frères, Johan et Emil, semble en voie de pétrification. Le duo arrondit ses fins de mois en trafiquant leur alcool-maison, un redoutable tord-boyaux cent pour cent chimique. Jusqu’au jour où un de leurs clients ne résiste pas aux rasades de leur décapant éthylique. Pivot dramatique, point de bascule, dirait-on dans les écoles de scénario. Sauf que rien ne bouge vraiment, tout est toujours éternellement plombé.
Camaïeux de gris délavés, encore assourdis par les blancs éteints de l’hiver, par les emplâtres de poussière de calcaire qui tartinent les visages des mineurs. Ténèbres des boyaux en chiaroscuro que réchauffe à peine l’éclat éphémère des lampes frontales des travailleurs souterrains. Et à la surface, ces bâtiments industriels, blocs minéraux de béton livide, qui dressent leur brutalité géométrique, froide, comme les silos ou les usines des clichés dépouillés et frontaux de Bernd et Hilla Becher. Les hommes là-dedans ne sont que des émanations du paysage : des silhouettes atones, comme vidées de leur substance vitale. Hlynur Palmason, pour son premier long, semble lorgner sur l’installation vidéo : intransigeance et cohérence formelles (les couleurs, donc, les cadrages millimétrés) poussées jusqu’au formalisme, récit comme relégué à l’arrière-plan au profit des compositions visuelles. Comme une façon de décentrer notre regard de spectateur, de l’inciter à se détourner de l’histoire pour mieux s’abîmer dans les images, dans cette marée grise.
Mais Winter Brothers n’a rien du petit objet arty captif de sa bulle stérilisée. Tout au contraire, et c’est la force et le paradoxe du film, qui opère un nouveau décentrement. Emil, personnage-pantin, comme un Buster Keaton qui viendrait du froid, ne se réduit pourtant pas à la somme de ses actions et de ses gestes. Il faut voir au-delà, soulever le rideau du behaviorisme laconique, ne pas seulement se laisser prendre à ces moments de burlesque – un burlesque de la raideur qui évoque un Roy Andersson minimaliste. Voir au-delà du strictement visible. Car ce que le film creuse, c’est un autre univers de galeries et de recoins obscurs. La psyché d’Emil. Ou plus exactement, le manège des images qui l’habitent et l’obsèdent comme une inquiétante ritournelle. A commencer par cette vidéo anglaise d’une séance d’entraînement militaire au maniement d’un fusil qu’il regarde assidûment. Violence, virilité, voilà ce qui envahit le crâne d’Emil, au point que la vidéo n’est plus seulement un film dans le film, diffusé sur l’écran d’une télé nichée dans un coin du plan, mais que ses images occupent toute la surface de l’écran. Comme si elles phagocytaient Winter Brothers. Inutile de gloser, ce serait faire injure au film, qui fuit tout bavardage. Il suffit simplement de dire qu’une brèche est ouverte dans la surface froide, blanche et grise du film. Winter Brothers est comme la hache d’une fameuse formule de Kafka : il brise la mer gelée qui est en Emil.