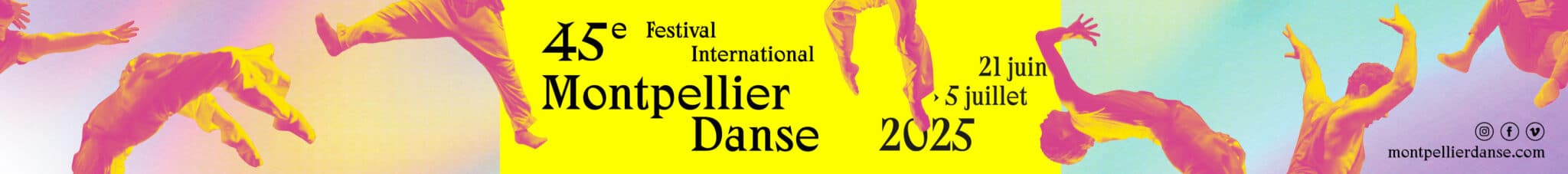Jean-Paul Sartre souhaitait écrire tranquillement son Flaubert, faire oeuvre de littérature, quand les militants communistes, qui avaient fait de lui un fer de lance, l’insultèrent. Sartre venait de commettre le pire des crimes : trahir son engagement politique pour s’occuper d’une affaire bourgeoise, la littérature.
Ce sectarisme insupportable, ennemi de la liberté de pensée, ennemi de la littérature, que je pensais depuis longtemps disparu, je l’ai malheureusement retrouvé il y a quelques semaines sous la plume d’une critique littéraire influente qui dirige les pages livres des Inrockuptibles, plus connue pour sa hargne et ses coups de mâchoires que pour la justesse de ses jugements littéraires. Il y a donc quelques semaines, je lis cet article sur l’essai de Milan Kundera, La Rencontre, et sans nuance, assure la nullité de celui-ci. Pourquoi ? Simplement car l’écrivain n’est plus politique : il a osé écrire que la recherche du beau était devenue son plaisir. Schönberg, la beauté de la phrase de Céline… Il avait commis le crime de lèse-majesté comme Sartre des décennies avant. D’être littéraire, simplement littéraire. C’était évidemment oublié que le beau s’il est subjectif, est aussi universel, qu’il nous permet de vivre ensemble, de communier…bref qu’il permet le politique. L’essentiel de l’essai de Kundera était oublié : les analyses littéraires brillantes, et les grandes interrogations existentielles que posent peut être le dernier immense écrivain vivant. Quand la politique s’empare de la littérature, on risque de s’aveugler.
Plus tard, la violence de gauche s’éveilla et gronda une nouvelle fois contre François Bégaudeau pour son dernier roman, Vers la douceur. Ce livre aussi était jugé nul. Ne demandez pas d’esprit dialectique, cette gauche n’en a pas : elle ne supporte pas les contradictions. Nul, donc, comme le livre de Kundera. La seule question, une nouvelle fois éminemment littéraire qu’elle se posait, était de savoir si l’auteur était-il de son bord. Non, assurément non. Il n’est plus de gauche. Imaginez un homme de gauche posait la question suivante : « Est-ce que tu ne perds pas ton temps à draguer une fille pendant douze heures pour finalement avoir une vague fellation de trente-trois secondes ? » Quand on est de gauche, monsieur, on ne parle pas de sexe. Le combat, camarade, le combat avant tout. En plus, vous qui n’êtes pas de la secte, vous auriez bien compris que le ton ici est celui de l’humour. Mais voyez-vous, l’humour, c’est qu’une critique politisée ne peut plus voir. On sait depuis La Plaisanterie de Kundera, que dans un monde où le politique prime, le rire est malvenu.
Cette gauche sectaire n’était pas morte, à ma grande stupéfaction, mais je confirmais aussi en lisant cet article une intuition que j’ai eue, il y a quelques années : que cette jeune gauche pouvait être réactionnaire. Lisez ceci : « ce côté bière-foot-cul, ce côté mec pour qui les filles ne se divisent qu’en deux camps : celles qui ont des seins et celles qui n’en ont pas, celles qui ont un gros cul et les autres… Ce côté terriblement beauf qui transparaît à travers son livre » Ça, elle ne supporte pas. Quel mépris pour les hommes qui aiment la bière, le foot et le cul. Ça m’a rappelé un billet d’humeur d’un autre critique du même magazine qui préferait encore Dominique de Villepin comme président de la République à Nicolas Sarkozy, trop bling bling, parvenu, disons-le, trop beauf. Préférer l’aristocrate au parvenu, voilà qui me semble clair : nous avons bien affaire à une gauche réactionnaire.
Revenons aux pages littéraires : il faut observer aussi comment l’approche de cette gauche peut aller jusqu’aux mensonges. Par omission d’abord : je me souviens d’une critique dans ces mêmes colonnes du roman de Tom Wolfe. Pas de chance, le critique apprécie l’auteur. Mais que fait-on dans ce cas-là quand on sait que Tom Wolfe est un ami des Bush, et qu’il a, on peut le deviner, voter pour eux ? On n’a plus qu’à mentir par omission, la question n’est pas abordée. Autre exemple : Bret Easton Ellis, que ces mêmes chroniqueurs, de mémoire, ont voulu faire passer dans leur entretien pour un écrivain engagé, parce que ça les arrangeait bien. Là on est dans le délire pur : qui connaît Ellis sait à quel point ce grand bourgeois (qui ferait passer Frédéric Beigbeder, ennemi juré du magazine, pour un SDF) se fout de la politique. On est là en plein mensonge littéraire, loin, bien loin de la recherche de la justesse.
Une grande erreur de méthode dans la critique m’est apparu par ailleurs, elle relève aussi du champ politique : c’est cette stratégie, cette volonté à tout prix de convaincre. Il n’y a jamais, dans ses articles, d’interrogations. La hache du jugement tombe, avec la certitude des imbéciles. La sagesse de l’incertitude, disait Kundera. Dans la culture talmudique, il y a une idée qui consiste à dire que toute réflexion ne s’arrête que quand on est fatigué de penser. Personne n’a jamais raison, on tâtonne. Ce tâtonnement, le doute permanent, est peut être la meilleur façon de réfléchir sur la culture. De réfléchir tout court. Utiliser des « peut-être ». Des conditionnels. Des hypothèses. Des « j’aurais pu croire que ». Le discours politique ne s’en encombre pas, la littérature si. Kant l’a dit clairement : « Je n’approuve pas la règle selon laquelle si l’usage de la raison pure a prouvé quelque chose, ce résultat ensuite ne devrait plus être mis en doute comme si c’était un axiome solide. (…) Je ne partage pas l’opinion (…) selon laquelle on ne devrait pas douter une fois qu’on s’est convaincu de quelque chose. » Le doute devrait être au centre de toute bonne critique littéraire.
PS : Ah, j’ai oublié de vous dire : cette critique littéraire de la gauche radicale pige aussi pour le magazine Vogue. Vous savez, ce magazine de la révolution prolétarienne…