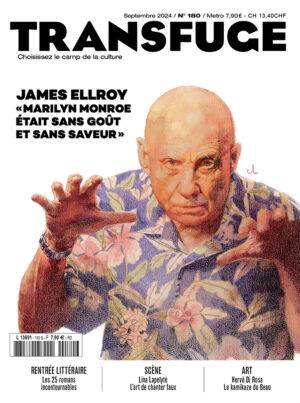Après une laborieuse première journée, Kelly Reichardt a vraiment lancé la compétition de cette soixante-dixième Berlinale. Mais il faut voir avec quelle douceur elle l’a fait ! Autant le dire, je crois que First Cow est son meilleur film, le plus émouvant peut-être depuis Old Joy (2006), une sorte de synthèse de tous ses précédents, une grâce de chaque instant. Il propose une fresque historique sur la naissance du capitalisme mais sans jamais chercher à intimider par sa forme ou à édifier par son scénario, tout en lignes de fuites et instants de vide. Point d’emphase, point de boursouflure, point de solennité mais une lenteur métronomique, une douceur absolue – qui irrigue chaque cadre, chaque ligne, chaque épisode, chaque geste – pour raconter à la manière d’un conte le destin de deux trappeurs au XIXe siècle. Ceux-ci vont tenter de prospérer avec de doux beignets sucrés fabriqués à base d’un lait qu’ils volent tous les soirs à une vache dont ils ne sont pas propriétaires. Comme à son habitude, Reichardt situe son action dans l’Oregon, cet état de l’ouest qu’elle documente depuis plus de vingt-cinq ans. Elle montre un melting-pot possible ou originel, un métissage de cultures dans des villages champignons reconstitués avec une précision qui atteste de sa capacité à savoir mêler utopie et ethnographie. Non seulement, First Cow est pour le moment ce que nous aurons vu de mieux mais c’est aussi un film-ami, attentif, drôle et profond, vers lequel on a déjà envie de revenir.
Après une laborieuse première journée, Kelly Reichardt a vraiment lancé la compétition de cette soixante-dixième Berlinale. Mais il faut voir avec quelle douceur elle l’a fait ! Autant le dire, je crois que First Cow est son meilleur film, le plus émouvant peut-être depuis Old Joy (2006), une sorte de synthèse de tous ses précédents, une grâce de chaque instant. Il propose une fresque historique sur la naissance du capitalisme mais sans jamais chercher à intimider par sa forme ou à édifier par son scénario, tout en lignes de fuites et instants de vide. Point d’emphase, point de boursouflure, point de solennité mais une lenteur métronomique, une douceur absolue – qui irrigue chaque cadre, chaque ligne, chaque épisode, chaque geste – pour raconter à la manière d’un conte le destin de deux trappeurs au XIXe siècle. Ceux-ci vont tenter de prospérer avec de doux beignets sucrés fabriqués à base d’un lait qu’ils volent tous les soirs à une vache dont ils ne sont pas propriétaires. Comme à son habitude, Reichardt situe son action dans l’Oregon, cet état de l’ouest qu’elle documente depuis plus de vingt-cinq ans. Elle montre un melting-pot possible ou originel, un métissage de cultures dans des villages champignons reconstitués avec une précision qui atteste de sa capacité à savoir mêler utopie et ethnographie. Non seulement, First Cow est pour le moment ce que nous aurons vu de mieux mais c’est aussi un film-ami, attentif, drôle et profond, vers lequel on a déjà envie de revenir.
On a beau se sentir bien du côté de Potsdamer Platz, voir les films dans d’excellentes conditions, compléter chaque séance d’une bière ou d’une saucisse entre amis, il n’était vraiment pas nécessaire de se rendre à Berlin pour découvrir Pinocchio de Matteo Garrone. D’abord, le film sort sur nos écrans français le 18 mars. Ensuite, c’est un échec quasi complet. Le film souffre principalement d’une coproduction trop onéreuse, trop luxueuse qui écrase les personnages dans des couleurs hideuses. Garrone effleure chaque thème sans en creuser la portée philosophique. Comme son personnage, Pinocchio est un film fabriqué, taillé sur mesure, mais qui ne parvient jamais à s’animer et à prendre vie.
Ondine de Christian Petzold (Barbara, Phoenix) puise aussi son inspiration dans le conte. Le film tente d’inscrire le mythe des naïades dans la contemporanéité berlinoise au travers des aventures sentimentales d’Undine (Paula Beer), une guide en architecture qui entretient des rapports mystérieux avec l’eau. Le pari est difficile : le film cherche à atteindre le sublime de l’amour fou en mêlant, à la manière des cinéastes surréalistes, la quotidienneté et la magie. Malheureusement la plupart des scènes réalistes sont trop hiératiques et les dialogues trop chargés. Pourtant Petzold a des idées fortes : ainsi, on se souviendra longtemps de la séquence où Undine récite à son amant une conférence entière sur la reconstruction du château de Berlin après la chute du mur. Bref, comme la plupart des films de Petzold, Undine déçoit mais intrigue.