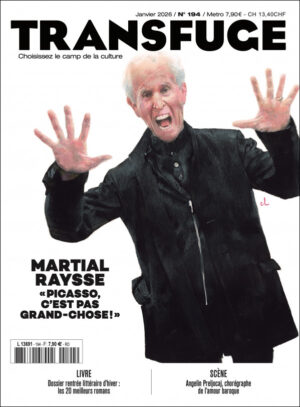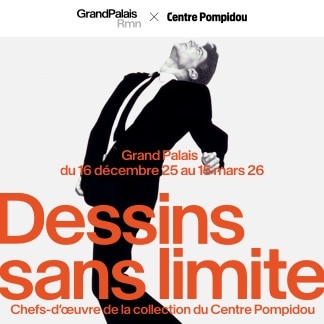David Hermann aborde Falstaff, l’unique incursion de Verdi dans la sphère bouffe, pour une création à l’Opéra Orchestre National de Montpellier. Rencontre avec le jeune metteur en scène franco-allemand multi-primé, qui est aussi un vrai musicien.
Qu’est-ce qui vous a conduit à la mise en scène ?
Enfant, je jouais du piano avec sérieux et faisais de la musique de chambre. J’aimais aussi aller à l’opéra, mais ce qui me passionnait le plus, c’était le théâtre. Vers dix ans, j’ai commencé à jouer sur scène à l’école, puis dans une troupe de lycée. Plus tard, toujours en amateur, j’ai mis en scène quelques opéras : ma pratique musicale m’a beaucoup aidé, car il fallait comprendre la dynamique sonore pour la traduire scéniquement. Je me souviens d’ailleurs avoir voulu, à dix-sept ans, interpréter le monologue de La Contrebasse de Patrick Süskind, alors que le personnage a cinquante ans ! Avec l’opéra, j’ai pu concilier musique et théâtre, mes deux passions.
Falstaff à Montpellier devait être créé en mars 2020 mais a été interrompu par la crise sanitaire…
Au moment de l’arrêt, le décor était construit et deux essais scéniques avaient eu lieu. Le concept général demeure valable, mais il a fallu procéder à des ajustements, notamment parce que la distribution n’est plus la même : chaque chanteur apporte son énergie, obligeant à repenser certains équilibres.
Pour cette production, avez-vous un fil conducteur ou un principe qui guide votre mise en scène ?
Pour moi, Falstaff est un être d’une liberté d’esprit rare : brillant, plein d’humour, sûr de lui, capable de rire de lui-même — qualités que les autres hommes n’ont pas dans cette œuvre. Ford, son adversaire, partage une tessiture proche (Falstaff basse-baryton, Ford baryton), ce qui en fait deux figures opposées d’un même archétype. Quant aux femmes, elles s’amusent aux dépens de Falstaff ; Alice surtout, ressentant un vide dans son couple, cherche un bref souffle d’aventure et finit par mettre le feu à sa propre maison.
Y a-t-il une scène qui vous tient particulièrement à cœur ?
Le monologue de Ford, après sa rencontre avec Falstaff, me frappe toujours : il bascule dans une obscurité totale. À Montpellier, j’ai choisi de rendre ce passage très coloré. Le contraste devient saisissant lorsque Falstaff se déguise pour son rendez-vous avec la femme de Ford : Ford perd pied, Falstaff revient ravi. Cette scène me plaît énormément.
Falstaff est le seul opéra-bouffe de Verdi. Comment l’abordez-vous par rapport aux autres ?
L’œuvre regorge de phrases très courtes, sans orchestre, que les chanteurs peuvent dire presque comme des acteurs. Cela crée une grande liberté entre les moments très écrits, notamment les finals complexes. Dans les nombreux récitatifs, l’orchestre reste discret : on peut alors jouer sur les couleurs de la lecture choisie. Alice et Meg, par exemple, peuvent prononcer ces phrases brèves de manière contrastée pour souligner leur rivalité.
Une anecdote personnelle liée à Falstaff ?
À Lucerne, il y a vingt ans, le chanteur incarnant Cajus est tombé malade en plein spectacle. Nous avions la même taille et j’étais dans la salle : j’ai repris son rôle sans annonce, en enfilant son costume encore chaud. C’est un rôle de caractère, il n’était donc pas nécessaire de chanter parfaitement. Je crois même que le public n’a rien vu. Les autres chanteurs, surpris puis amusés, ont bien ri. Une apparition presque hitchcockienne dans ma propre production !
Falstaff de Verdi, Opéra Orchestre National de Montpellier, du 7 au 13 janvier. Informations et réservation.