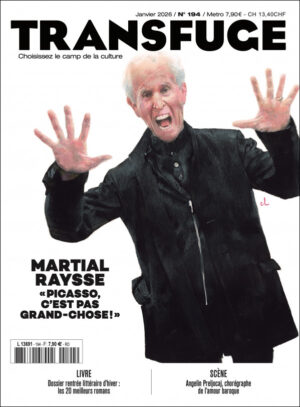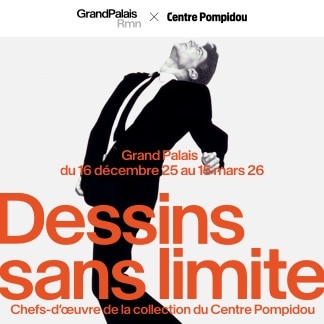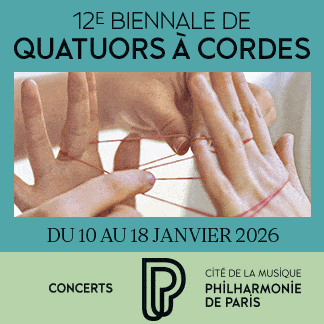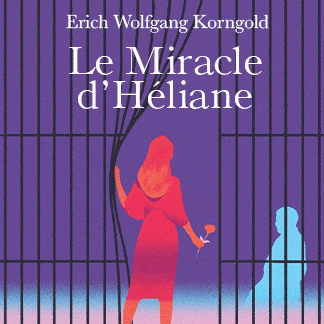A l’opéra national du Capitole, la metteure en scène nous offre un retour aux sources du choef d’œuvre de Mozart à la belle distribution.

« Vous n’avez jamais vu, et vous ne verrez probablement jamais un Don Giovanni comme à l’époque de sa création ! » s’exclame Christophe Ghristi, directeur artistique d’Opéra national du Capitole de Toulouse. Il est vrai que la mise en scène d’Agnès Jaoui n’a rien de plus classique. Elle situe l’action dans une Espagne imaginaire du XVIIᵉ siècle : murs massifs aux accents semi-gothiques, costumes et couvre-chefs somptueux, épées, lanternes, chaise à porteurs, guirlandes de fleurs, rideaux de velours aux motifs dorées… Ce retour assumé au classicisme frappe, surprend même, face à la prolifération de mises en scène qui cherchent coûte que coûte à se montrer modernes ou « réinventées ». Jaoui remonte à la source, à cette Espagne que Mozart et son librettiste Da Ponte pouvaient porter en eux.
Après un Tosca en plein air en 2019 et la recréation d’Uomo femina de Galuppi (1762) la saison dernière, cette passionnée d’opéra — elle-même formée au chant lyrique — s’impose désormais dans un milieu particulièrement exigeant. Pourtant, au début de l’acte I, les chanteurs demeurent relativement immobiles ; peu de mouvements animent la scène, même lors de la mise à mort du Commandeur par Don Giovanni. Les murs de la ruelle, imaginés par Eric Ruff, se déplacent à vue avec une fluidité étonnante (bravo aux techniciens !) mais leur massivité donne la sensation d’enserrer l’action, de tout étouffer entre leurs pierres et leurs briques… à moins que ce ne soit précisément l’effet recherché ?
Autre surprise, car devenue rare : chanteurs, choristes et figurants dansent un véritable menuet, accompagnés par des musiciens disposés sur scène. L’immobilité des premières minutes cède alors progressivement la place à des fêtes colorées, d’abord celles des paysans, puis celle donnée chez le séducteur, où la statue du Commandeur apparaît dans une niche, toujours imposante. Mais la vraie déflagration intervient à la toute fin. Après sa chute en enfer, le « prédateur », selon le mot d’Agnès Jaoui elle-même, revient, à la stupeur générale. Une conclusion qui résonne avec une réalité bien triste au prisme de notre société…
Pour Nicolas Courjal, le rêve de chanter ce rôle immense devient enfin réalité. Il façonne un séducteur cynique, moqueur, prétentieux, effronté, immoral — et l’on pourrait prolonger la liste ! — dont la douceur apparente du chant n’en souligne que mieux l’agressivité et l’arrogance. Vincenzo Taormina campe un Leporello solide et affirmé, visiblement excédé par son maître. Karine Deshaies offre une Donna Elvira sensible et naïve : la sincérité avec laquelle elle exprime son chagrin et l’espoir de retrouver son mari (en s’adressant, sans le savoir, à Leporello déguisé) émeut profondément. La voix droite d’Andreea Soare convient bien au rôle de Donna Anna. La distribution, équilibrée, devrait déployer pleinement ses atouts au fil des représentations ; l’on attend également beaucoup de la seconde distribution, portée par de jeunes chanteurs.
Le jeune chef italien de vingt-cinq ans, Riccardo Bisatti, remplace presque au pied levé le directeur musical de l’Orchestre du Capitole, Tarmo Peltokoski. L’orchestre sonne parfois épais, presque comme une symphonie du XXᵉ siècle ; mais malgré plusieurs micro-décalages, Bisatti tient fermement la baguette et conduit avec assurance cette production qui surprend, une fois de plus, par son classicisme visuel.
Don Giovanni de Mozart, en double distribution. Jusqu’au 30 novembre au Théâtre du Capitole de Toulouse. Infos : https://opera.toulouse.fr/don-giovanni-1598321/