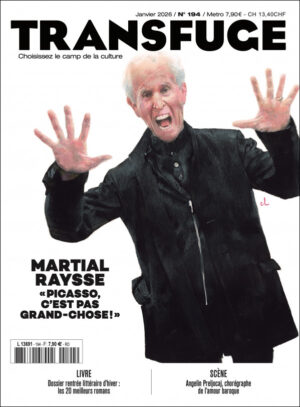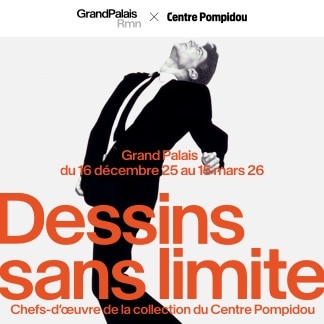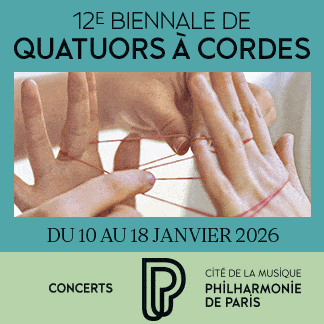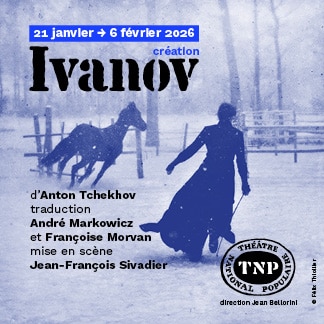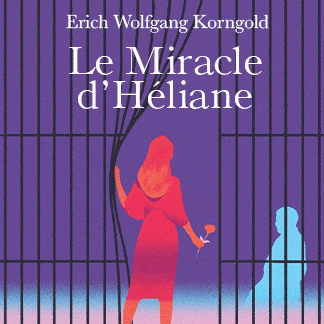Dans le cadre de l’exposition consacrée à John Singer Sargent, le musée d’Orsay propose un spectacle évoquant le milieu culturel autour du peintre américain qui a passé toute sa vie en Europe, à la charnière des XIXᵉ et XXᵉ siècles. Danièle Lebrun, sociétaire de la troupe de la Comédie-Française, a conçu un choix de textes avec Sandra Bernhard, directrice de l’Auditorium. Elle sera sur scène avec Serge Bagdassarian de la Comédie-Française et le pianiste Abdel Rahman El Bacha. Rencontre avec la doyenne de la troupe de la Comédie française.
Parlez-moi de votre spectacle autour de Sargent. Avez-vous vu l’exposition ?
J’y vais cet après-midi. J’avais déjà travaillé avec Sandra Bernhard sur Caillebotte, un spectacle avec Hervé Niquet. Pour Sargent, ceux qui viennent à l’exposition savent déjà qui est ce peintre. Nous avons donc décidé de parler de son monde à lui. Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on dit. La peinture, bien sûr, mais aussi la musique — il était aussi doué dans les deux ! Alors on a convoqué Liszt, Mendelssohn, Fauré, Granados… tous ceux qu’il aimait.
Le spectacle évoque aussi Edith Wharton et Henry James.
Oui. Je la connais bien, Wharton, j’ai joué ses pièces, lu presque tous ses romans. Elle me passionne. On parle toujours de James, moins d’elle parce que c’était une femme… Mais elle avait un vrai talent. Avez-vous lu Ethan Frome ? c’est prodigieux ! Dans le spectacle, je lirai une courte nouvelle, Le Portrait, où tout le monde reconnaît Sargent. Elle raconte l’histoire d’un peintre qui n’aime pas le portrait qu’il a peint. Après avoir écrit cette nouvelle, Wharton demande à Sargent d’accepter de peindre James pour son anniversaire. Mais ni lui ni Wharton n’aiment le résultat… alors que James le trouve très ressemblant. La nouvelle a devancé la réalité ! Et pour la petite histoire, le tableau a été massacré à la hache par une suffragette anglaise ! (rires) Dans le spectacle, une correspondance raconte cette histoire avec beaucoup d’humour : « On me répare en ce moment… on ne verra plus cette sauvage… » C’est délicieux !
Ce sera théâtralisé ?
Serge Bagdassarian lit le peintre, je suis Edith Wharton. Dans les lettres, lui est Henry James. Serge, qui est un ancien professeur d’anglais, adore tout ce qui est anglais, il est plus anglais que James, qui était américain ! (rires) Mais enfin… qui n’adore pas Henry James ?
Vous avez dit que vous aviez lu tous les Wharton.
Oui ! Et j’ai joué une pièce d’elle chez Renaud Barrault quand j’étais dans sa troupe. Elle n’a pas été reconnue à sa juste valeur au XXᵉ siècle, mais elle a été beaucoup éditée dans la dernière partie du XXe siècle et certains de ces œuvres sont adaptées au cinéma. Vous savez, elle détestait les nouveaux riches de New York. Elle a préféré vivre en Europe, en France. Elle est morte en France, d’ailleurs.
Le texte de présentation parle d’« une évocation sensible de l’élégance perdue dans l’intimité de la haute société et des mouvements souterrains de l’âme », qu’entendez-vous par là ?
Perdue, parce que tout s’est arrêté après 1914. Je vous ai cité Zweig, il a été brisé par la guerre de 14. Il a essayé de rattraper les choses, mais pour lui c’était beaucoup plus angoissant après, surtout parce qu’il était juif. Il parle très bien de cette coupure, de ces gens qui étaient les perdants, les vaincus. Donc oui, lui, il avait un peu de nostalgie de l’avant-guerre.
Sargent, James, Wharton, eux aussi racontent ce qu’ils ont vécu. Mais ça dépend de leur âge, de leur tempérament, de leur façon de rebondir après un drame. Ce n’est pas forcément nostalgique. Parce que quand on continue à créer, à écrire, on est dans le présent. C’est ça qui les faisait avancer.
Vous aimez ce genre de spectacle ?
En fait, je crois que les lectures, ce genre de spectacles, ça s’adresse souvent à des gens qui n’aiment pas trop lire. Moi, j’ai appris à lire grâce à mon frère, beaucoup plus âgé que moi, qui me jouait les histoires de la Comtesse de Ségur. C’était drôle parce que c’était plein de dialogues. J’avais cinq ans. Et à chaque fois, il s’arrêtait au moment où il y avait écrit « la suite ». J’étais folle de frustration, je voyais le mot, mais je ne pouvais pas lire. Ça m’énervait tellement que j’ai appris à lire très vite, juste pour savoir ce qui se passait après. Je crois que ces spectacles s’adressent à des gens comme moi enfant.
Vous avez joué récemment dans Le Soulier de satin de Claudel et vous jouerez Le Cid de Corneille à partir de la fin mars prochain, vous n’arrêtez jamais ?
Le soulier de satin… C’était un souvenir extraordinaire, vraiment extraordinaire ! Mais bon, avec l’âge que j’ai — je suis la doyenne au Français, quand même — il faudra bien que je m’arrête un jour. Enfin… Quand Podalydès vous demande de jouer la suivante de Chimène, qu’est-ce que vous voulez ? On ne résiste pas à Corneille, ni à Podalydès !
Et puis je l’ai relu… Ah ! C’est incroyable ! D’une telle jeunesse ! Ce n’est pas une tragédie, car ça finit bien. C’est un vrai coup de poing, c’est gai, plein d’humour, d’énergie. Franchement, c’est irrésistible !
Une soirée chez Sargent : 27 novembre à 20h, auditorium du Musée d’Orsay.