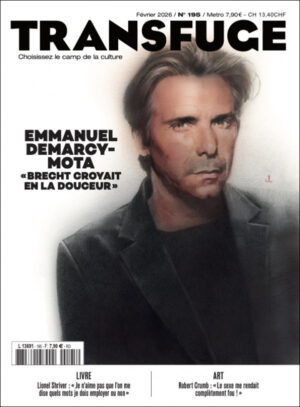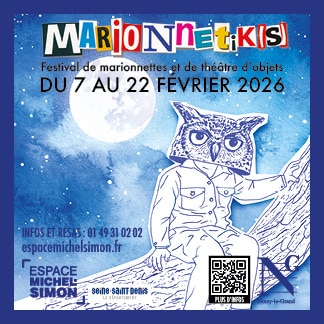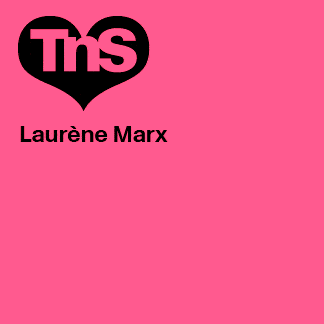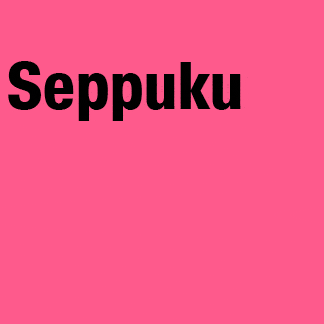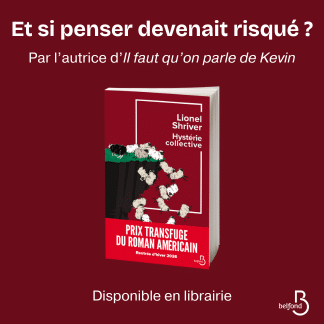C’est un des spectacles les plus fascinants de la rentrée, Hamlet Fantômes offre une vraie performance d’acteurs sur une musique de Blaise Ubaldini et une mise en scène hors-normes.
Un visage tuméfié et sanglant ouvre et clôt ce spectacle ; la face mourante du prince d’Elseneur, filmé en gros plan. Il meurt, et n’en finit pas de mourir. Comme souvent dans les pièces de Serebrennikov, le principe circulaire prévaut : les fantômes d’Hamlet offrent à Hamlet son immortalité. Le prince meurt, et meurt encore et meurt toujours. Il meurt pendant trois heures et quelques, sur la scène du Châtelet, de manière sublime et foutraque, en gros plan ou en ballet, en musique ou en chuchotant, nu ou en chantant, dédoublé par la caméra ou enfoui dans une tombe, il poursuit son chemin droit vers la mort en direct. Serebrennikov est un metteur en scène d’un monde à l’agonie, nous le savions depuis Leto, nous le redécouvrons dans cet Hamlet Fantômes, sa plus grande œuvre théâtrale présentée en France jusqu’à présent. Et pourtant, au départ, j’ai cru que j’allais quitter la salle. Parce que commencer par la mort d’Hamlet, c’est un outrage pour tous les Shakespeariens du monde. Commencer par la mort d’Hamlet, c’est tuer l’espoir, que nous avons tous à chaque nouveau début d’Hamlet, qu’il trouve un moyen, cette fois, de fuir l’injonction paternelle et le royaume pourri, pour sauver sa peau. Et celle d’Ophélie en passant, victime collatérale, ici irradiante Judith Chemla, de cette société infecte qui règne à Elseneur. Donc, les dix premières minutes, je me suis dit que j’allais tourner le dos à ce blasphème, les laisser patauger dans leur sang et leur insolence, et tant pis pour le duo qui prenait vie sur scène, Bertrand de Roffignac en mime glaçant et Odin Lund Biron en intellectuel dandy, couple improbable entre la force brute et silencieuse de l’un, et l’évanescence sombre de l’autre, discourant sur Hamlet. Jusqu’au moment où Lund Biron nous a pris à témoin, « savez-vous combien de fois Hamlet simule la folie dans la pièce ? 17 fois ». Et commence un moment de théâtre inouï : les deux acteurs vont inventer, in medias res, dix-sept manières d’être fou. De cet instant, j’ai su que j’allais rester. Si je savais que j’allais voir sur scène une distribution internationale d’exception, ajoutons à ceux que j’ai déjà cités, August Diehl, Filip Avdeev, Nikita Kukushkin, entre autres, j’ignorais comme le metteur en scène allait leur permettre de déployer un jeu physique et viscéral, notamment grâce aux différents rôles qu’ils assument au gré de la pièce. Car ces dix longues scènes inventent chacune à leur manière, parfois ultra-référencées, Hamlet et sa fin. Ainsi August Diehl est à la fois Hamlet et Antonin Artaud, Roffignac, peut-être le plus gâté de la distribution avec Judith Chemla, est Hamlet, de diverses manières, grotesques ou burlesques, Judith Chemla, elle, est Ophélie, Hamlet, Gertrude, Sarah Bernhardt, Kukushkin est Hamlet, Chostakovitch, un fossoyeur et Fortinbras. Autant de variations sur un même thème, qui se doublent de variations scéniques, puisqu’ils sont tour à tour filmés en gros plans, lancés dans des scènes de groupe, oscillant entre un théâtre de tréteaux, et parfois une pure chorégraphie. Ce qui fait de ce spectacle un opéra comme une pièce, frôlant parfois une sorte de Singspiel que la musique d’Ubaldini, expressive et souvent dramatique, épouse à la perfection. Car oui, l’on peut dire que l’une des forces de ce spectacle s’avère la rigoureuse coordination de l’Ensemble intercontemporain dans la fosse et des acteurs sur scène qui se répondent, s’entrecroisent, s’illustrent tour à tour. Ainsi la scène d’Ophélie qui voit Judith Chemla livrer sur scène son drame, tour à tour chantant et racontant sa vie pourrie, glissant d’un bord à l’autre du plateau, sans que personne ne la rejoigne, sinon derrière elle, un chœur d’hommes en impers noirs, mafieux d’Elseneur ricanant de sa détresse, au rythme d’une musique qui la condamne, nous plonge en un instant au plus profond du destin d’Ophélie. Et cette autre scène qui voit August Diehl se débattre dans une installation hitchcockienne entre les reflets de lui-même et de ce qu’il croit être le fantôme de son père nous rend l’emprisonnement intérieur du personnage palpable. Jusqu’à la fin qui laisse les fantômes errer sur scène, et nous prend à partie sur notre propre aliénation.
Alors, que nous dit Serebrennikov sur Hamlet ? Qu’il est le personnage de notre temps. Oui, mais ça nous le savions au moins depuis Heiner Müller dont le metteur en scène russe poursuit la voie. Serebrennikov fait un pas de plus, il nous suggère que la mort d’Hamlet est le fait de notre temps : que cette oscillation entre l’action et l’intellect, et le refus de ce monde pourri qui s’installe, n’a plus lieu d’être, qu’il faut, peut-être, non plus penser à partir d’Hamlet, mais à partir d’un monde où Hamlet, et l’ultime quête de justice, ne sont plus. Du chant d’impuissance d’Hamlet au bras triomphant de Fortinbras, une seule et même note se déploie sur la scène du Châtelet : la quête d’une renaissance après la mort du prince.
Hamlet/ Fantômes, conception et mise en scène Kirill Serebrennikov, musique Blaise Ubaldini, direction musicale Pierre Bleuse/ Yalda Zamani, Théâtre du Châtelet, jusqu’au 19 octobre. Plus d’infos sur www. chatelet.com