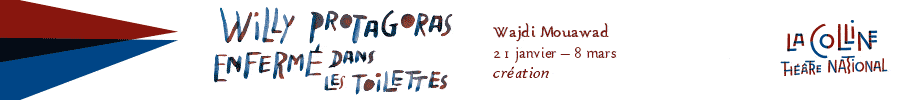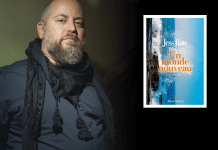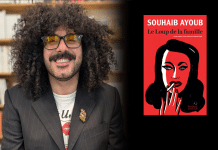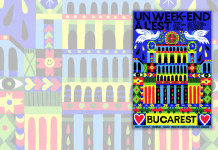Bienvenue à El Alto, dans les Andes boliviennes, pour ce premier roman rythmé et attachant sur fond de désarroi existentiel.
« Je divague beaucoup. Je me perds tout le temps. » Le narrateur de ce premier roman bolivien a le verbe haut et cultive la digression. Normal : il se cherche. Lycéen à El Alto, un village à 4000 mètres d’altitude, il voit débarquer son cousin Tayson, qui a grandi à São Paulo, où migrants boliviens et coréens sont en rivalité pour fabriquer les meilleures contrefaçons. Tayson est contraint de revenir dans le pays natal de ses parents et d’y suivre son service militaire – obligatoire. Notre narrateur, qui décide bientôt de laisser le lycée derrière lui, observe le difficile retour aux sources de Tayson, à la fois amusé et fasciné. « Tayson a rapporté des choses intéressantes de São Paulo. Parmi elles, du porno brésilien, du sirop de fraise, un piercing à la lèvre, des baskets Olimpikus et un disque dur externe avec deux gigas de musique coréenne. » Quelle équipe de foot supporter désormais ? Dans ce monde nouveau pour lui, difficile pour Tayson de démêler qui il est…
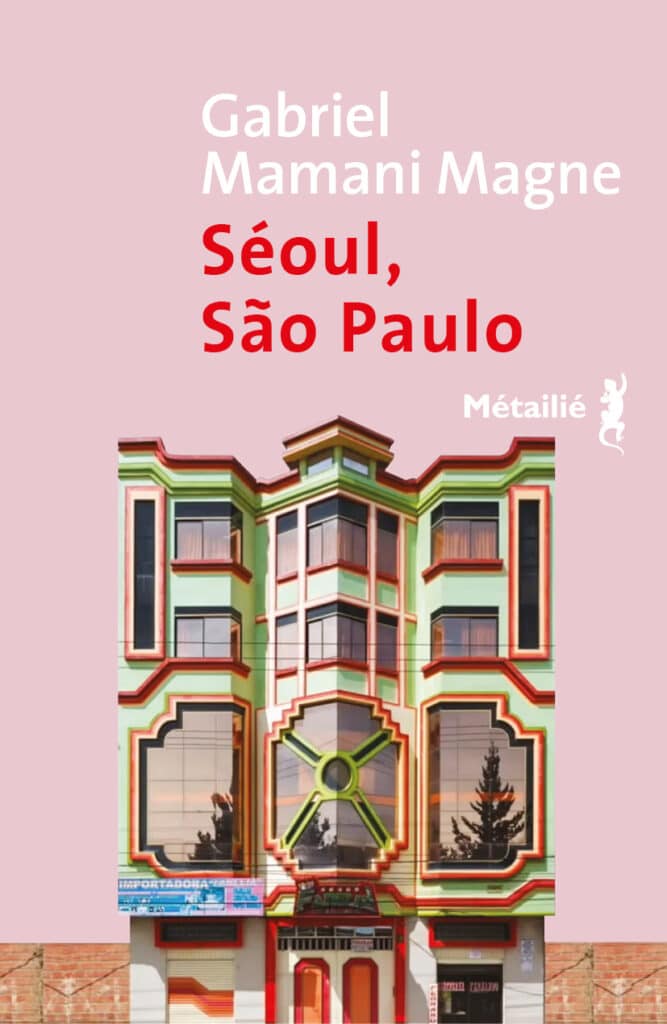
Mais pour son cousin aussi, qui ne sait guère quoi faire de lui-même ni de ses désirs. Faut-il rêver d’ailleurs, loin de « La Paz (…) où les montagnes, par centaines, te donnent la sensation d’être cerné et que s’enfuir est impossible. » ? Avide de sexe mais surtout d’une tendresse qui peine à dire son nom, notre narrateur est empêtré dans des émotions que nul ne semble vouloir entendre. « J’aimerais tout lui raconter, ouvrir la bouche et laisser tout ce qui bouillonne dans mon coeur sortir et s’éparpiller dans El Alto : ce serait comme vider les poubelles, le vent de la fin d’histoire balayerait mes sentiments-déchets, les éloignerait de moi, les laisserait à disposition de n’importe quel couillon avec de la chance à revendre. » Au passage, l’auteur interroge les discours qui façonnent (mal) les hommes – à commencer par le patriotisme martelé dans les stades, mais aussi, bien sûr, dans l’univers militaire. « La vie des soldats est une vie de subordination totale, quelque chose que j’aimerais éprouver (puisqu’on nous a dit que c’était la condition primordiale pour être de vrais patriotes, des hommes) mais qui en même temps me répugne : on dit qu’on rentre à la caserne petit garçon et qu’on en ressort devenu homme ; personnellement, je crois qu’on y rentre être humain et qu’on en ressort bête de somme. » Comment échapper à cette logique corrosive ?
Né à La Paz en 1987, Gabriel Mamani Magne signe un roman hautement singulier sur une trame qu’on aurait pu craindre attendue : celle d’un roman d’initiation sur fond de quête d’identité. Sans doute grâce à l’humour qui éclate à chaque page, combiné à une constante inventivité verbale. Joyeuse, ludique, sa langue crée son propre tempo, enlevé, avec de brusques embardées mais aussi des respirations où la mélancolie se fraye son chemin.
Séoul, São Paulo, Gabriel Mamani Magne, traduit de l’espagnol (Bolivie) par Margot Nguyen, Métailié, 158 p., 19€