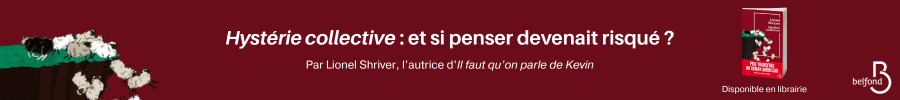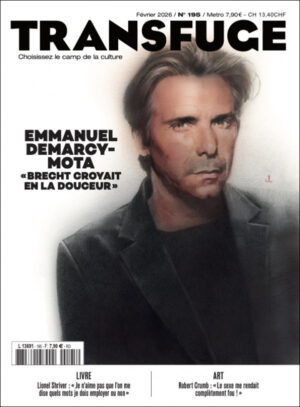Dans le cadre du Festival d’Automne, Simon Creuzevault signe une adaptation du violent chef d’œuvre de Pasolini, parfois bavarde, souvent captivante.

Il coule à flots tout au long du spectacle. Le liquide visqueux s’installe sur scène, déborde sur les corps, sur la caméra, arrose les uns et les autres, salit tous et toutes. Pétrole ? Oui. Sperme ? Assurément. Logorrhée ? Toute aussi présente. Ce Pétrole pasolinien signé Creuzevault est un long flux de ces trois substances au cours de trois heures trente de spectacle au cours desquelles le spectateur s’abandonne, ou pas, à cette hallucination politique, psychanalytique, et étrangement poétique. Car oui, Pasolini et Creuzevault se lancent à la recherche d’une forme qu’ils redéfinissent à chaque instant, et cet ovni littéraire donne lieu à un théâtre extrêmement vivant. Ainsi l’ouverture : un homme à terre, entre deux ailes d’un avion. Des voix off nous apprennent qu’il s’agit du personnage de Carlo Valetti. L’homme au centre du texte de Pasolini. Celui qui n’est plus, mais qui fut, et doublement. Car toute la pièce se fonde sur un dédoublement, sur l’existence de deux volontés parallèles : d’une part, le premier Carlo Valetti qui consacre sa vie à la sexualité, d’autre part, le second Carlo Valetti qui gravit un à un les échelons du pouvoir économico-politique au sein de l’Entreprise Nationale d’Hydrocarbures, tout en ne perdant jamais l’espoir de devenir un « saint ». Dans cette simple histoire de Mr Jekyll et Mr Hyde, se concentrent les trois obsessions fondamentales de Pasolini : le sexe, la politique, et la sainteté. Carlo Valetti, par son ascension et sa déchéance, qui sont bien sûr à l’inverse de celles que vous pourriez supputer, traduit, jusqu’au vertige, les racines nerveuses de l’écrivain, poète, cinéaste. Et ce, sous l’égide, annoncée d’emblée, de Laurence Sterne, du marquis de Sade, et du psychanalyste Ferenczi. Le danger évident d’adapter Pétrole, roman pensé contre toute forme de narration classique, une des œuvres les plus intimes de son auteur, aurait été de faire du Pasolini. On suggère la proximité de Creuzevault avec Pasolini, le risque devait donc être majeur. Mais, et c’est la grande forme du spectacle, le metteur en scène et les acteurs ne se laissent jamais complètement envoûter par la langue et l’univers si singuliers de Pasolini. Oui, ils sont ces créatures non psychologiques, traversées de discours, ivres même de ces analyses de l’Italie des années soixante, soixante-dix, de cet intellectualisme européen, de la pensée post-fasciste, des interrogations communistes de cette époque, mais ils sont aussi, des acteurs d’aujourd’hui. Oui, ils sont ces personnages pasoliniens qui, lorsqu’ils couchent avec leurs mères, ou de jeunes hommes dans ces quartiers de Rome « qui ressemblent à Beyrouth », rejettent toutes formes d’entraves pour atteindre, enfin, la libération, mais ils sont aussi ces acteurs qui s’amusent de leurs rôles et assument la distance ou le grotesque. Ainsi les scènes sexuelles, qui sont dans leurs débordements subversifs, parmi les meilleurs moments du spectacle. Mais aussi les soirées entre intellectuels italiens, qu’on regrette de ne suivre que sur le vaste écran et non sur plateau, qui jouent sur un fil de cynisme, d’ironie et d’impromptu qui tient jusqu’au bout. Ainsi des scènes qui voient les négociations pour le pétrole entre les représentants de l’Entreprise d’Hydrocarbures, et la famille Assad, en Syrie. Ou cette scène avant le final, dont je ne dirais rien, mais dont on ne saisit que les mains des hommes au pouvoir qui traduisent à elles-seules, l’enjeu de ce qui vient d’avoir lieu. Creuzevault et ses acteurs, qui sont tous portés par une énergie rare, savent passer de la franche comédie grotesque et trash ( dois-je parler de la scène de castration ?), à la satire politique la plus grinçante. Ce passage d’un registre à l’autre touche à son apogée lors de la très belle dernière scène, monologue tenu par Boutaïna El Fekkak, au milieu d’une soirée de l’Italie social-démocrate des années 70, sur le roman, et la forme romanesque. C’est le plus beau moment de la pièce. Car soudain, l’on échappe aux diatribes politiques très marquées par l’époque, et l’on rejoint un lieu fétiche chez Pasolini, celui des formes qui essaient de saisir la quête de l’individu vers l’apaisement, c’est-à-dire la sainteté, c’est-à-dire la mort heureuse.
Pétrole, d’après le roman de Pier Paolo Pasolini, adaptation et mise en scène Sylvain Creuzevault. Théâtre de l’Odéon, dans le cadre du Festival d’Automne, jusqu’au 21 décembre Et à la Commune, un Pavillon auteur consacré à Pasolini avec deux créations de Sylvain Creuzevault en accès libre, du 22 au 31 janvier .