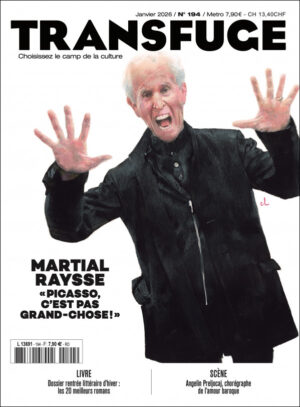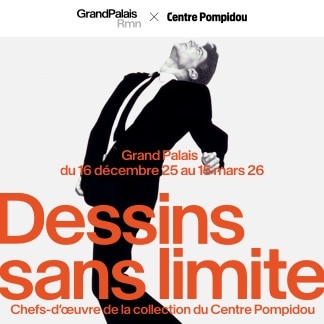Adapté du roman culte de Boris Vian, l’opéra L’écume des jours créé à l’Opéra-Comique en 1986, renaît aujourd’hui. Rencontre avec le chef et compositeur libanais Bassem Akiki passionné par cette œuvre visionnaire composée par un compositeur russe du siècle dernier, le prodigieux et trop méconnu Edison Denisov, et qu’il dirigera avec gourmandise à l’Opéra de Lille. Rencontre.

Edison Denisov se considérait comme « underground ». Que représente son travail par rapport à son époque, notamment avec L’écume des jours ?
Les années 1980 étaient une période presque magique. La musique de John Cage et d’autres compositeurs américains, fondée sur les systèmes tonals traditionnels, arrivait à son apogée. La question se posait alors : « Et maintenant, où va-t-on ? » Edison Denisov a cherché une nouvelle voie. Pour lui, la partition devait correspondre visuellement au son. Quand on la regarde, on voit littéralement la musique, les notes existent dans l’espace. Formé aux mathématiques, il pensait la musique en volume. Là où beaucoup de partitions d’aujourd’hui sont rigides en termes d’indications, Denisov laisse une grande liberté. Le temps peut bouger, les couleurs s’équilibrer autrement. Sa musique est vaste mais garde une intimité de musique de chambre.
Par ailleurs, il ne rejette pas la tradition, mais la prolonge. Je vois un lien entre L’écume des jours et La Bohème, histoires d’amour et de jeunesse frappées par la maladie. Denisov exprime cela par des métaphores sonores : plusieurs tempos coexistent, le jazz continue pendant que les cordes annoncent la maladie… Puis tout ralentit, s’efface comme un souffle, en fade out, comme en musique électronique. C’était radicalement nouveau à l’époque.
Cette liberté rend-elle sa musique plus difficile à jouer ?
Oui, et c’est souvent ce qu’on lui reproche, en disant qu’il aurait pu écrire plus simplement. Mais cela aurait supprimé cette « troisième dimension » sonore. Une écriture classique impose souvent un seul point de vue. Chez Denisov, chacun peut aborder la partition différemment. Sa musique est analytique, mais jamais absolue. Elle invite à choisir son propre angle.
Comment transmettre la poésie du roman dans un univers sonore aussi varié ?
C’est une question que je me pose aussi comme compositeur : comment exprimer l’idée poétique ? Prenez la scène où Nicolas décrit sa recette : Denisov en fait une fugue, en respectant la forme tout en y introduisant le jazz et d’autres styles. Comme en cuisine, il mélange les saveurs pour créer une musique unique. Les lignes chantées suivent la prosodie du français parlé — on sent l’influence de Debussy — ce qui donne une fluidité poétique, fidèle à Boris Vian.
L’opéra n’a pas été rejoué en France depuis 1986, alors que le roman a été porté à maintes reprises au cinéma et au théâtre. Avez-vous été influencé par ces adaptations ?
Je vais peut-être vous surprendre : je n’aime pas regarder les films tirés d’œuvres littéraires, car le point de vue du réalisateur s’impose. Au théâtre, en revanche, chaque représentation est différente. Pour préparer cet opéra, je me suis directement plongé dans la partition, sans écouter d’enregistrements. Ce travail a aussi ravivé le bon souvenir de mon adolescence au Liban : au lycée français, nous lisions L’écume des jours et d’autres classiques comme Madame Bovary.