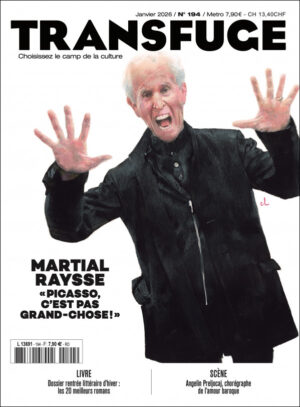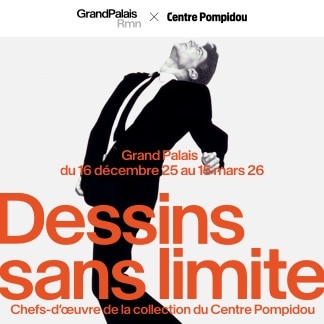Alors que le metteur en scène présente Iolanta à l’Opéra de Bordeaux, il revient sur les grandes lignes qui ont guidé sa vie.
Ma famille
Ma famille a contribué à faire de moi ce que je suis. Côté paternel, il y a mon arrière-grand-père, Marcel Braunschvig, éminent professeur de lettres, auteur d’un essai sur l’antisémitisme et à qui l’on doit aussi l’enseignement du latin pour les jeunes filles ; mon grand-père André Braunschweig, un magistrat important, président de cour d’assises, qui disait toujours que derrière chaque criminel il fallait avant tout voir l’homme. Enfin mon père, avocat, spécialiste de la déontologie. Voilà pour le côté juridique. Ma grand-mère paternelle était psychanalyste. Nous étions très proches et j’ai eu avec elle beaucoup de discussions sur l’art, la littérature, la philosophie et la psychanalyse. Ma mère vient, pour sa part, d’une famille ouvrière d’immigrés siciliens en Tunisie. Ma grand-mère maternelle était couturière et ma mère est devenue psychanalyste. Elle a perdu son père quand elle était encore enfant. J’ajoute que mon grand-père paternel a failli faire du théâtre quand il était jeune, donc il y avait un refoulé théâtral dans la famille. Il est évident en tout cas que cette configuration familiale a fait de moi quelqu’un qui est à la fois du côté de la loi et du côté de l’inconscient ; autrement dit, ce qui échappe à la loi. Je pense aussi que le fait de venir à la fois d’un milieu bourgeois intellectuel et d’un milieu ouvrier est pour beaucoup dans mon envie de faire un théâtre accessible à tous, qui s’adresse à la fois à un public cultivé et à un public qui n’a pas la même culture. De même, je crois que si j’ai beaucoup travaillé sur la question du trauma et de la résilience, c’est en relation avec le trauma vécu par ma mère enfant.
La philosophie
C’est par la philosophie que paradoxalement j’ai eu accès à la littérature. J’étais un adolescent plutôt matheux. C’est à travers des problématiques philosophiques que je me suis intéressé à l’art et aux romans. La philo m’a appris à toujours chercher des problématiques existentielles. Que ce soit la façon dont Merleau-Ponty parle de Cézanne ou Nietzsche de Wagner. J’avais une détestation de tous les philosophes qui produisaient des systèmes sur le monde. Parce que ce qui m’intéressait, c’est justement ce qui échappe au système. D’où mon goût pour Montaigne, Nietzsche, mais aussi Wittgenstein pour sa réflexion sur les limites du langage.
Kafka
J’ai écrit un mémoire de philosophie « Rapports entre l’éthique et l’écriture chez Kafka ». Ce qui est une façon de dire qu’il s’agit pour moi d’un auteur absolument fondamental. C’est un écrivain qui n’a rien à voir avec le théâtre, mais ce qui m’intéresse chez lui, c’est le rapport entre l’artiste et le monde extérieur. Il y a deux phrases de Kafka qui m’accompagnent depuis toujours dans mon travail. La première c’est : « Dans ton combat contre le monde, seconde le monde ». Et la deuxième c’est : « Seule est vraie la lumière sur le visage grimaçant qui recule ». Il y a dans toute l’œuvre de Kafka, dans son Journal, dans ses récits et particulièrement dans Le Terrier cette vision de l’écrivain sous la menace du monde extérieur ; la métaphore à la fois de la littérature et de son enfermement dans la littérature. Cette nécessité d’aller vers le dehors tout en étant sous la menace du monde du dehors est la matrice de nombreux spectacles que j’ai réalisés. Comment on survit à une réalité insupportable ? Comment l’imaginaire peut être un refuge ? J’ai beaucoup travaillé sur cette question.
Antoine Vitez
Impossible de ne pas l’évoquer. Il fut mon professeur. C’est un de mes maîtres de théâtre. Ce qui était très important chez Vitez, c’est qu’il considérait l’acteur comme un créateur à part entière, comme un rêveur, au même titre que le metteur en scène. Il nous enseignait le droit à la liberté et nous encourageait à jouer avec les conventions du théâtre. Il insistait sur la dimension ludique du jeu de l’acteur dans un théâtre qui ne consistait pas seulement à représenter le monde, mais à jouer avec les représentations du monde. Mais le plus important, je crois, chez lui, c’est que c’était quelqu’un pour qui il n’y avait pas d’opposition entre l’intellect et le sensible. Ce qui pour moi est quelque chose de fondamental.
Bernard Sobel
Il a été très important dans mon parcours. D’abord parce qu’il m’a énormément soutenu à mes débuts. Donc sans lui, je ne serais sans doute pas là. C’est quelqu’un avec qui j’ai eu beaucoup de discussions. On parlait des spectacles qu’on avait vus et il me faisait aussi des retours sur mes propres mises en scène. Il ne posait jamais la question : est-ce que c’est bien ou pas bien ? Est-ce que ça m’a plu ou est-ce que ça ne m’a pas plus ? Il demandait : est-ce que ça m’a été utile ? Et cette question de l’utilité est toujours restée. C’est-à-dire l’idée que ce qu’on fait serve à quelque chose dans le tissu social.
Krystian Lupa
Un des chocs artistiques déterminants de ma vie, c’est la découverte du théâtre de Krystian Lupa et de son rapport à l’acteur. Je me souviens d’avoir été fasciné en assistant à son adaptation des Frères Karamazov, par la façon dont les acteurs portaient en eux un continent caché, celui du roman de Dostoïevski. Sous les yeux on n’a que la partie émergée de l’iceberg, mais en même temps on ressent profondément quelque chose qui n’est pas directement apparent. Cela a modifié ma façon d’aborder la mise en scène. À partir de là, j’ai commencé à chercher une dimension incorporant plus de mystère et d’opacité dans le jeu de l’acteur.
Ibsen
L’auteur qui a joué un rôle particulièrement important dans mon parcours, c’est Ibsen. C’est celui que j’ai le plus mis en scène. À commencer par Peer Gynt dont le héros vit dans l’imaginaire. Soit par refus d’affronter la réalité. Soit parce que c’est sa façon de l’affronter. Dans ses pièces on voit aussi des personnages qui tentent de plier la réalité à leur volonté comme dans Brandt. Et elle finit par les détruire. Le théâtre d’Ibsen conjugue plusieurs aspects, sociologiques, psychologique, philosophique. Comme dans Le canard sauvage avec cette question : faut-il dire toute la vérité ? Une question philosophique.
Paul Klee
Sa peinture m’inspire énormément parce qu’elle a cette dimension qui est reliée au dessin d’enfant et donc à un imaginaire enfantin. Et puis il y a souvent dans ses tableaux des petites flèches, une rouge ici, une jaune là… Quand j’ai commencé à faire ce métier, je me disais que je faisais des mises en scène comme des tableaux de Paul Klee. De temps à autre, je mettais des petites flèches, ce qui est une manière d’orienter le regard. Mais comme il n’y a que quelques petites flèches, on guide le regard, on ne le contraint pas.
Iolanta à l’Opéra de Bordeaux, du 12 au 18 novembre. Infos & réservations : opera-bordeaux.com