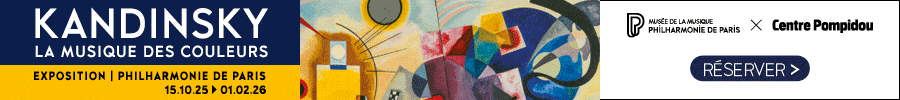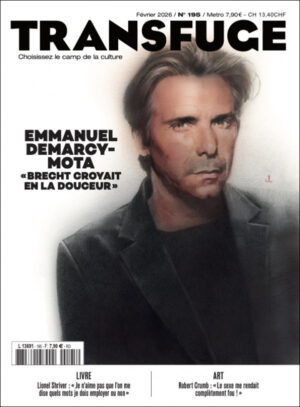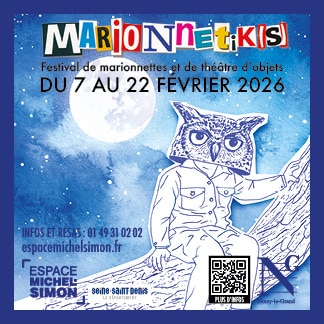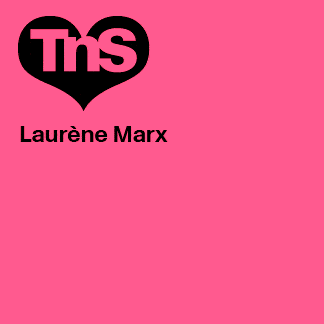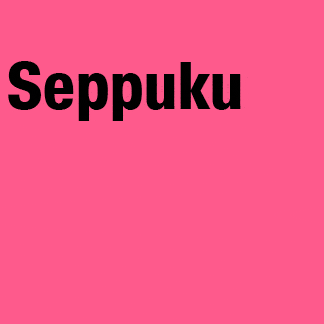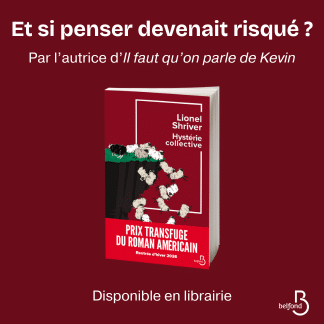Grâce à l’opéra fameux de Moussorgski, l’on découvre un jeune metteur en scène russe, Vassily Barkhatov, et une distribution éclatante.
Boris est une œuvre monstre. Un de ces opéras qui ont dévoré leur auteur, tant il s’est vu repensé, ravaudé, modifié, dénaturé, magnifié autant que trahi. Lorsqu’il en achève la composition, à trente ans, en 1869, Modeste Moussorgski ne se doute pas qu’il se lance dans un parcours du combattant. Aussitôt sa version de la pièce de Pouchkine est attaquée par les tenants de l’art officiel, qui lui reprochent son absence de personnage féminin, d’intrigue amoureuse et de chromo historique. Bonne pâte, le musicien va s’atteler à la refonte et on ne compte plus les moutures de Boris. Celles-ci se démultiplieront après la mort de Moussorgski, en 1881, puisque son ami (jaloux) Rimski-Korsakov, va réorchestrer l’œuvre, offrant une version coruscante et spectaculaire, qui sera le Boris officiel pendant des décennies. Depuis, on est revenu aux partitions primitives, et c est la toute première, la « urversion », que nous propose aujourd’hui l’Opéra de Lyon.

Intrigue plus courte, plus resserrée, elle est un véritable thriller politique dans la Russie tsariste du XVIIe siècle. Les états d’âme de Boris Godounov, souverain malgré lui hanté par la culpabilité du pouvoir, trouvent forcément des échos dans l’actualité la plus récente. On saura toutefois gré au metteur en scène russe Vasily Barkhatov de ne pas nous avoir resservi une énième métaphore des frasques poutiniennes et du drame ukrainien. Sa lecture de Boris est moins politique que psychiatrique. Partant du principe que le tsarévitch Feodor, fils de Godounov, est un jeune autiste, il situe l’ensemble de l’action dans un asile d’aliénés. La première moitié se déroule dans une vaste salle d’attente d’hôpital, la seconde dans un playground intérieur pour enfants à problèmes, avec toboggans et piscine à balles multicolores. Option radicale, mais qui se tient, d’autant que le metteur en scène a travaillé chaque rôle avec acuité, en authentique directeur d’acteur. Reste que la laideur des tableaux est parfois décourageante, atténuant la tension pourtant bouleversante de l’œuvre : ainsi, lorsqu’au terme d’un des monologues les plus fameux de l’histoire de la musique occidentale (la mort de Boris) le tsar s’effondre dans la « bubble pool », on souffre de coïtus interruptus. C’est d’autant plus dommage que Dmitry Ulyanov est un des meilleurs Boris de la scène actuelle. La basse moscovite possède la rudesse caverneuse qui sied au personnage, mais aussi sa douceur blessée, ses névroses, ses fantômes. Il domine très nettement la distribution, à parts égales avec le superbe Pimene de Maxim Kuzmin-Karavaev, double vocal et symbolique de Boris, qui crée cette dualité troublante et fait de cet opéra une œuvre abyssale où pouvoir et religion s’opposent et fusionnent. Mais l’ensemble du plateau est à saluer, qui brille par son homogénéité russophone et sa cohérence : le Chouiski de Serguey Polyakov, ou encore le pétulant Varlaam de David Leigh. Mention spéciale pour le Feodor seraphique du contre-ténor russe Lurii Lushkevich, tristement crédible en enfant autiste.
Dans la fosse, le jeune chef biélorusse Vitali Alekseenok livre un Boris humble, sans jeu de manche, presque timide au début (la scène du sacre, peu aidée par les décors si prosaïques, a paru bien fade), qui peu à peu se déploie et prend son envol. Il suit en cela la progression dramatique et l’intensité croissante de l’œuvre. Les chœurs, si importants dans Boris, ont subi la même évolution : secs, presque engoncés et imprécis au premier acte, ils se sont peu à peu « réveillés ». Qu’il nous soit cependant permis un aveu de mauvais goût : maintenant que le Boris originel est de mise, quand nous rendra-t-on la version si séduisante et clinquante de Rimski ? La rudesse est philologique mais la joliesse fait du bien à l’âme…