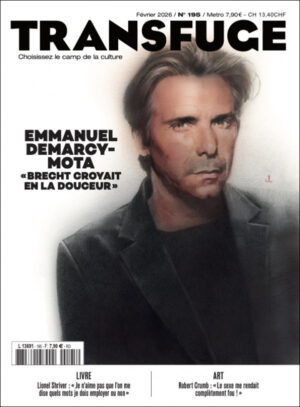Comment jouer une pièce devenue mythe ? Les comédiens, sous la direction de Jacques Osinski qui clôt là son grand-œuvre beckettienne, empruntent une voie approfondie et classique.

C’est sans doute la pièce qui résume le XXe siècle, En attendant Godot a offert à Vladimir et Estragon la possibilité d’incarner la posture privilégiée de notre humanité contemporaine : l’attente du vide. Denis Lavant et Jacques Bonnaffé trouvent là leur raison d’être, et sur la scène du Théâtre des Halles, ils incarnent on ne peut mieux ce lieu entre l’absurde et le désespoir, si soigneusement pensé par Beckett. Ainsi se rapprochent-ils tant au cours de la pièce, au gré d’un jeu si juste dans l’effet de miroir qu’il produit, que l’on se demande si Beckett n’a pas d’abord pensé ces deux figures en siamois. Lavant et Bonnaffé n’ont pourtant rien à voir : le jeu clownesque, à la lisière de l’enfance et de l’étrangeté du premier, se confronte à la haute stature, au jeu profond et rentré du second. A croire qu’ils ont toujours été Vladimir et Estragon, deux faces d’un même destin où l’on vieillit trop pour se donner la mort, et l’on ne vit pas assez pour comprendre à quoi se résume tout cela. Derrière eux, un vieil arbre, aux branches nues, le fameux « saule » qui n’accueillera aucune corde, bien que la tentation soit permanente chez nos deux protagonistes. Jacques Osinski, à son habitude, ne propose pas plus de décor, laissant la langue de Beckett, dont il maîtrise parfaitement le rythme, planter son propre paysage. Même chose pour les déplacements des acteurs qui sont rares, si ce n’est le tournoiement propre à l’attente et les brefs endormissements. En guise d’accessoires, les chapeaux melon voulus par Beckett font partie de la silhouette des vagabonds, les apparentant aussi bien à Chaplin qu’à la foule de l’exode pendant la Seconde Guerre Mondiale, dont furent Beckett et sa femme. Souvenons-nous que la pièce fut écrite dans l’immédiat après-guerre, en 48-49, et comment ne pas voir dans l’errance de ces personnages, le nomadisme contraint auquel sont soumis tant de peuples en Europe ? Dans sa note d’intention, Jacques Osinski émet même l’idée que l’un des deux protagonistes serait juif, et que Godot serait un passeur qui pourrait les emmener en zone libre. Difficile en tout cas de ne pas penser au contexte de la Seconde Guerre mondiale et à la menace de la Shoah, lors de l’arrivée de Lucky et Pozzo, l’un tenant l’autre en laisse, le déshumanisant sciemment. Couple inversé du premier, dans un jeu de symétrie qui compose la pièce, ces deux-là sont aussi baroques que les premiers sont en repli, aussi burlesques que les premiers sont pathétiques. En Lucky, Jean-François Lapalus élabore un jeu lent, excessif, difficile à saisir dans l’économie générale de la pièce, alors qu’Aurélien Recoing excelle dans la performance, unique, de Pozzo. Les quatre se tournent autour sans se rencontrer, tel que l’a voulu Beckett. A la fin de la pièce, alors que nous laissons Vladimir et Estragon sur ce plateau irrémédiablement nu, une question demeure : peut-on, doit-on repenser cette pièce qui a forgé notre rapport au théâtre, et pour beaucoup à l’existence, au XXIe siècle ? On connaît la fameuse réponse de Beckett : « Quant à vouloir trouver à tout cela un sens plus large et plus élevé, à emporter après le spectacle, avec le programme et les esquimaux, je suis incapable d’en voir l’intérêt. Mais ce doit être possible ». Au théâtre donc, de relancer les possibles.
En attendant Godot, Samuel Beckett, mise en scène de Jacques Osinski, Théâtre des Halles, Avignon, jusqu’au 26 juillet. Théâtre de l’Atelier, du 25 mars au 3 mai.