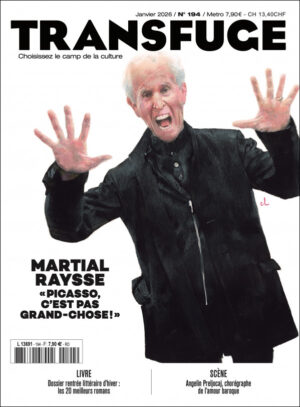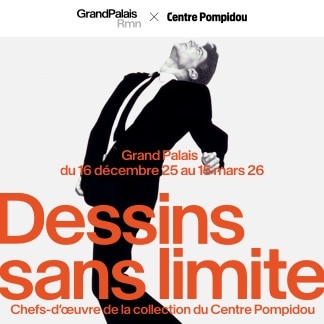Festival d’Avignon, semaine 1 : De Nôt de Marlene Montero Freitas dans la Cour d’Honneur, spectacle séduisant mais sans grande ampleur, au Canard Sauvage de Thomas Ostermeier, aux acteurs somptueux mais à la partition connue, ce Festival d’Avignon demeure pour le moment dans les clous.
C’est une image qui marquera l’édition 2025 : la gestuelle et le visage de Marie Albert, la danseuse de Nôt, grimaçant et robotique, sur la scène du Palais des Papes : elle se tient assise, entourée de danseurs qui allongés dans des lits d’hôpitaux tapent sur des casseroles, et de l’autre côté, de Mariana Tembe, puissante danseuse et actrice sans jambes masquée en héros de manga. Marlene Montero Freitas et ses interprètes hors du commun offrent un souffle délirant dans ce lieu qui en a tant vu, et l’on salue le geste. Découvrir dans la Cour d’Honneur un tel spectacle, qui emprunte autant au cinéma de Bunûel qu’à Angelica Liddell, au mauvais goût du carnaval qu’à une tradition gore du théâtre masquée, ne peut que réjouir le spectateur d’Avignon qui vient là pour qu’on le surprenne. Qu’on le « déplace » dirait-on ici, et nul doute que Marlene Montero Freitas qui n’a aucune envie de plaire, cherche bien à nous mener hors des sentiers battus. Seulement, la question est où ? Nôt est un spectacle d’une énergie constante, qui multiplie les références, et repose sur la virtuosité de ses interprètes. Mais le spectacle terminé, difficile de dire où nous sommes parvenus : sommes-nous dans un dadaïsme post-post-moderne, une fête grimaçante de l’apocalypse, où plus rien n’a de sens, puisque les guerres font rage et que les individus ne sont plus capables que de se dépecer ? Ou oserons-nous prendre Marlene Montero Freitas au pied de la lettre, et chercher les indices de ces Mille et une nuits qu’elle a promis de revisiter ? Ainsi de ces leitmotivs de personnages cherchant à parler, à raconter, mais n’y parvenant plus, ou cette déclinaison de femmes martyrisées, entourées d’hommes qui les guettent d’un œil menaçant, dans différents tableaux dansés. Les possibilités d’interprétation s’offrent, puis s’effritent, car si certaines scènes durent, l’ensemble ne forme aucune cohérence, aussi absurde soit-elle. On ressort de ce spectacle à la fois émerveillé et déçu. D’autant plus pour les spectateurs lointains qui n’ont pas pu tenter de déchiffrer les visages ou les masques des interprètes, et qui ressentent avec acuité ce sentiment d’un spectacle passé à côté de ce qu’il aurait pu être.

Milo Rau, incontournable
À l’inverse de celui qui est en train de devenir un « patron » du festival tant il est présent chaque année ou presque, Milo Rau poursuit sa réflexion in vivo sur le théâtre dans La Lettre, petite forme itinérante à deux acteurs, sans décor ou presque. Et l’on ne se plaint pas de cette récurrence, tant le théâtre de Rau se présente souvent comme le plus réflexif, et singulier, du festival. Ici deux jeunes acteurs, le flamand Arne de Tremeria, et la française Olga Mouak, qui croisent leurs histoires personnelles, mais aussi qui jouent leurs scènes fétiches de théâtre, issues de La Mouette pour le premier, de La Vie de Jeanne d’Arc, pour la seconde. On retrouve le jeu simple et naturaliste prôné par Rau, et ce théâtre au fil de l’eau, qui emprunte au documentaire, au récit de vie, comme à l’écriture théâtrale. Une écriture bien plus travaillée qu’elle en a l’air, notamment dans ses transitions qui permettent de passer de Tchekhov à l’histoire camerounaise des aïeux d’Olga, des références flamandes à la destinée de la Pucelle d’Orléans…Les deux acteurs ont adopté le principe du théâtre de Rau à merveille, l’un dans un jeu plus expansif, l’autre dans une très belle placidité, qui donnent envie de les revoir, au plus vite, sur une scène de théâtre.
Thomas Ostermeier, à la maison
Oui, il est chez lui, et alors ? Même les plus doués ont le droit de choisir le confort. Ostermeier monte un auteur qu’il adore, Ibsen, avec sa troupe, les acteurs de la Schaubühne de Berlin, dans un univers qu’il connaît bien, la petite classe moyenne de la fin du XXe siècle, et tire la pièce vers une question qui l’intéresse, le déclassement. S’il n’a pas pris grand risque en montant Le Canard sauvage, la bonne nouvelle c’est qu’il y soit parvenu. Les amateurs de la pièce retrouveront cette cruauté tenue sans responsable, ni criminel, qui en fait une des pièces les plus intelligentes d’Ibsen. La violence est constante, mais elle n’est pas le fruit d’un homme, ( en partie du du vieux Werle, si ce n’est qu’il apparaît presqu’aveugle, ), mais d’un mouvement que l’on pourrait appeler « mensonge ». Oui, ici la tragédie est psychologique est morale, proche du Festen de Vinterberg, fruit de non-dits assemblés les uns aux autres qui ont fini par construire une réalité tenable, et factice. Et le plateau tournant qu’a choisi le metteur en scène, passant du salon bourgeois des Werle, au décor prolétaire des Ekdal, pour terminer dans le grenier où se cache le canard sauvage, que l’on ne verra pas, en dit assez long sur la facticité de ce monde.Et, pour que la vérité arrive, comme dans les tragédies grecques, il faut un messager : ici Gregor Werle, haut Marcel Kohler qui va imposer sa silhouette de croque-mort, et sa présence de maître de cérémonie dans cette réalité fragile. Il est de bout en bout inquiétant et fascinant, comme ces acteurs de Tarantino qui semblent toujours sur le point de tuer. Dans sa ligne de mire, Stefan Stern. L’ami d’enfance de Gregor, Hjalmar, celui qui a tout perdu : le statut social, l’éducation, et bientôt, sa fille. Dès qu’il se présente sur scène, il pulvérise toute possibilité de théâtre routinier : que ce soit par l’expressivité de son visage, la pesanteur travaillée de son corps, les intonations gémissantes de son jeu, il devient l’incarnation du saccage de cette histoire. Face à lui, la jeune Magdalena Lermer, avec une grâce constante, incarne la jeune Hedvig qui va se faire broyer par les adultes qui l’entourent. Elle traverse la pièce comme une comète, dans sa vaine indignation, face aux discours et aux gémissements qui l’entourent. Seul hiatus sur cette pièce, le « moment avec le public ». Reprenant là une habitude de son théâtre qu’il avait notamment expérimenté dans L’Ennemi du peuple, déjà Ibsen, et déjà Avignon, il y a plus de dix ans, Thomas Ostermeier essaie de créer un débat avec le public, autour de la question du mensonge. Seulement, ça ne prend pas. Et ce pour une raison simple, à mon sens : la question de la vérité et du mensonge se discute mal, en dehors d’un contexte intime, théologique ou moral. Tout ne peut pas être une affaire collective, tout n’est peut-être pas politique. Vaste et éternelle question du théâtre qui sera sans nul doute reposée lors de la prochaine semaine du festival.
Nôt, de Marlene Montero Freitas, Cour d’Honneur du Palais des Papes, jusqu’au 11 juillet
La Lettre, texte et mise en scène Milo Rau, spectacle itinérant, jusqu’au 12 juillet
Le Canard sauvage, d’Ibsen, mise en scène Thomas Ostermeier, jusqu’au 16 juillet