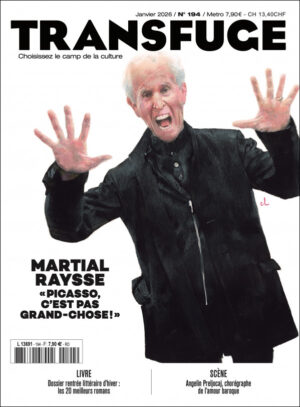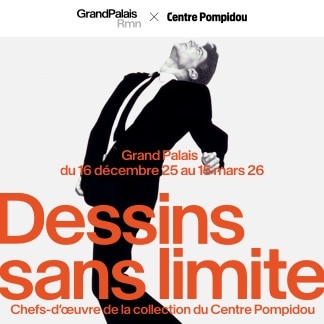Certains metteurs en scène d’opéra font frémir. De rage ou d’excitation. Apprenant qu’ils vont poser leurs pattes sur une œuvre du répertoire, on redoute le traitement qu’ils vont lui faire subir. C’est donc avec une circonspection (gourmande) qu’on s’est rendu au Théâtre des Champs-Élysées, pour découvrir le Chevalier à la rose mis en scène par Krzysztof Warlikowski. A la fois adulé et honni du public parisien, il propose depuis vingt ans ses lectures décapantes de Gluck, Verdi, Wagner ou Janacek, avec des bonheurs divers mais un constant souci de plonger au cœur même d’une œuvre, pour la retourner comme un gant et nous en montrer les viscères. Et c’est bien à une relecture du Rosenkavalier que nous convie « Warliko » aujourd’hui.
De prime abord, on peut être irrité par la laideur (proverbiale) des décors et costumes conçus par la fidèle scénographe Malgorzata Szczesniak, qui restitue la salle du studio des Champs-Élysées et habille les personnages en tenues criardes, hétéroclites, rappelant une esthétique fassbinderienne. C’est qu’on est aux antipodes de la Vienne crémeuse et moussue, pensée par Richard Strauss et son librettiste Hofmannstahl. Warliko nous plonge dans un monde de décadents toxiques et de harceleurs impénitents. Surtout, il pousse à bout la dimension androgyne d’Octavian (ce jeune homme, chanté par une mezzo, qui se déguise en femme) et propose une réflexion contemporaine sur la genderfluidité. De même, en donnant vie à des personnages habituellement évincés (le majordome noir, le fils du baron Ochs), la mise en scène offre une sombre profondeur à l’intrigue et nous force à repenser notre vision même de l’œuvre, quitte à en être perturbé. Bref : Warliko nous fait lire entre les lignes du Chevalier ; il nous en montre la doublure, les chausse-trappes, les oubliettes. Et ça, c’est vraiment du théâtre.
Pour l’épauler dans sa démarche, il est entouré d’un plateau d’un grand équilibre. Si certains ensembles sont parfois confus (disons que Warliko a tant d’idées qu’il faudrait voir le spectacle plusieurs fois pour tout repérer) chaque personnage est creusé, y compris les plus petits rôles. Jean-Sébastien Bou (Faninal), et Eléonore Pancrazi (Annina) sont au cordeau. La Sophie de Régula Mühlemann possède le timbre séraphique qui sied à la fameuse « présentation de la rose » (qu’on suit doublement, puisqu’il nous projette -riche idée !- la version muette de Robert Wiene, en 1925). On était curieux de découvrir la Maréchale de Véronique Gens, qu’on n’attendait pas dans ce répertoire. Avec son port altier, son allure aristocratique, la soprano offre une incarnation toute en nuance, ne forçant aucun trait, bouleversante de retenue. Face à elle, le baron Ochs de Peter Rose est un ogre matois, roublard, manipulateur, et l’on sent que le metteur en scène a pris plaisir à exacerber son côté tristement burlesque. Mais le vainqueur de la soirée est l’Octavian de Niamh O’Sullivan : la mezzo irlandaise explore toutes les facettes de ce personnage ambivalent, mi-homme mi-femme, tiraillé et étincelant.
On l’a dit, ce spectacle tourne le dos aux coutumières viennoiseries et Henrik Nnasi est en phase avec cet esprit abrasif. A la tête de l’Orchestre National de France, le chef hongrois dirige lui aussi en homme de théâtre, avant tout soucieux de lisibilité, ce qui ne va pas sans une certaine sécheresse. Disons qu’il nous propose un Strauss anguleux, presque expressionniste, qui se souvient plus d’Elektra et de Salomé qu’il n’annonce Arabella ou Daphné. Malgré son refus de toute séduction immédiate (le public très conservateur du TCE a copieusement hué le metteur en scène, ce qui est toujours signe de bonne santé) voici l’un des spectacles les plus cohérents vus depuis bien longtemps.
Le Chevalier à la rose, de Richard Strauss, direction musicale Henrik Nanasi, mise en scène K.Warlikowski, Théâtre des Champs-Elysées, jusqu’au 5 juin.