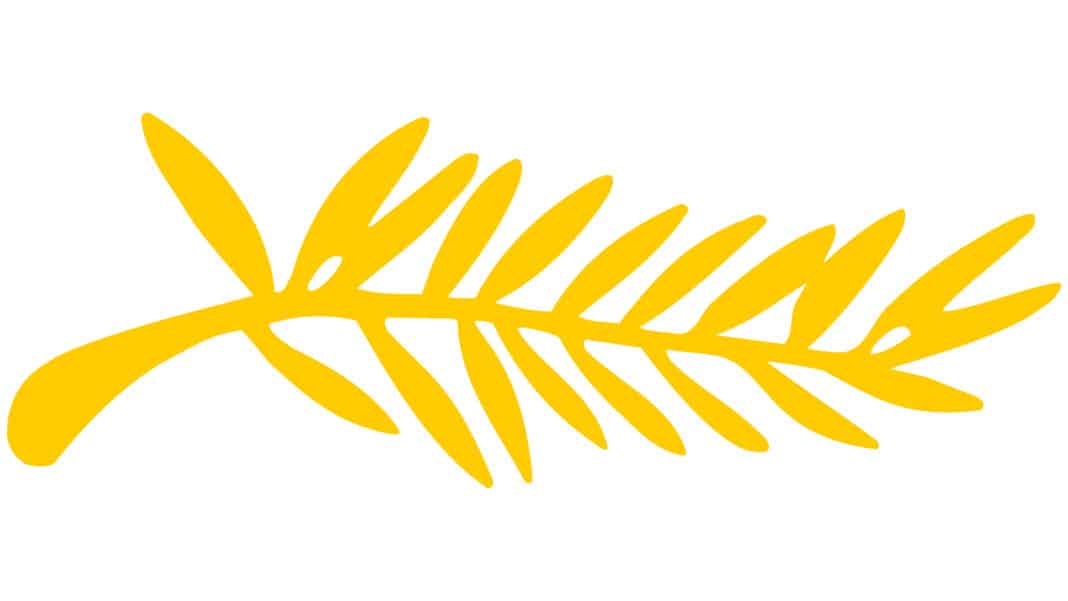On adore le film de Sean Baker mais c’est celui de Rasoulof qui aurait dû avoir la Palme !
Grand Baker, Petite Palme d’Or.
En fin de compte, ce Palmarès ressemble à cette 74ème édition cannoise. Il nous divise comme ces 22 films souvent aberrants, à force d’outrance et de démesure mais jamais pleinement satisfaisants. Plaisir de voir tous les meilleurs films récompensés d’une manière parfois tordue, plaisir de savoir que la Palme a été attribuée à Anora du cinéaste américain Sean Baker – c’est à dire une vraie grande comédie américaine, quand on songe que la dernière (Mash de Robert Altman) remonte à 1970. Malgré cette joie, malgré ce beau Palmarès (il faut le dire quand le Palmarès est beau), la déception et un état de scandale intérieur finissent par l’effacer tant Les graines du figuier sauvage de Rasoulof est extraordinaire, le meilleur film de cette édition, à tous points de vue. Surtout, il méritait autre chose qu’un lot de consolation, insultant et restrictif.
Anora de Sean Baker : Palme d’Or
Comme nous l’écrivions mardi dernier, Anora maille avec une haute science comique tous les fils de la comédie américaine, de Hawks à Wilder, Edwards et Apatow. Greta Gerwig justifiait d’ailleurs son choix en citant Lubitsch et Hawks ! Au-delà de ces qualités d’écriture et surtout de direction prodigieuse d’acteurs comme de spectateurs, le formidable cinéaste indépendant américain Sean Baker (Tangerine ; Florida Project ; Red Rocket) sait inventer des personnages de jeunes marginaux d’aujourd’hui pour narrer cette fausse romance entre une strip-teaseuse et le fils d’un oligarque russe. Ses héros comme l’orageuse Enora (Mickey Madison) sont animés d’une énergie sans commune mesure qui insuffle à chaque scène une vélocité furieuse, hystérique, souvent épuisante. Ce sont des jeunes marginaux mal aimables, sauvages, solitaires, méfiants mais néanmoins attachants. Au gré de dialogues triviaux répétés ou hurlés dans des situations extrêmes où s’affrontent des gamins capricieux et des sbires pas très adroits, Baker réussit à plonger dans leurs failles, explorer leurs contradictions sans jamais oublier les structures économiques, néo-libérales, qui les contraint dans leurs corps et leur âme et façonnent leurs rêves matérialistes. Comme Wilder, Baker tire sa satire sentimentale et désillusionnée d’un vérisme historique, à la fois frondeur, trivial et sans œillères. Comme Wilder avant lui, on a pu ici et là lui reprocher sa manière de filmer et d’exhiber sans fard le corps féminin dans des poses pornographiques et sous des angles peu flatteurs. Mais Baker montre exactement ce que fait Enora, travailleuse du sexe, et la façon exacte dont elle est regardée, objectivée par un ado biberonné au porno et dont les parents absents le laissent seul passer ses journées sur ses multiples écrans. Baker n’est pas là pour dissimuler (c’est contraire à son art !), ni pour rassurer ou amadouer avec des pirouettes de scénariste. Il n’a que faire du conte ou de la fable et en signale les mensonges. En bon comique, il regarde droit en face ce qu’il doit regarder et donne à voir le grand sujet de tous ses films : l’état d’enfance détruit peu à peu dans son corps et ses rêves par le néo-libéralisme (comme les gamins errants de Florida Project) ; l’enfance marquée dans sa chair par la violence décomplexée d’une économie ogre et aveugle. En fin de compte, sous ses allures de gaudriole potache, très drôle et libidinale, Anora est l’un des rares films adulte d’une Compétition si souvent infantile ou sénile. Il cumule surtout les meilleures qualités des meilleurs films esthétiques de Cannes (énergie brute du dépassement, stratégie narrative de l’accumulation, alliance de matérialité et souci de l’abstraction, espace laissé aux acteurs, inventions sur la fragmentation et le collage) sans se vautrer dans aucun des défauts vus à peu près partout, chez Paolo Sorrentino (Parthenope), Paul Schrader (Oh Canada), Gilles Lellouche (L’Amour Ouf), Andrea Arnold (Bird), Christophe Honoré (Marcello Mio), Kirill Serebrennikov (Limonov, une balade) : lyrisme aveugle, sans contrôle, coups de force gratuits, auto-apitoiement complaisant, auto-nostalgie et romantisme larmoyant, soliloque en vase clos, allégorisme abstrait et replié sur soi et entre-soi. Tels Sean Baker, Yorgos Lanthimos et surtout Mohammad Rasoulof, les meilleurs films ont su mêler matérialité et abstraction pour dépasser la fable sans pour autant la nier.
Prix spécial du jury : Les graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulof
Immense schisme tout de même de savoir que le meilleur film -indiscutablement – de cette édition repart les mains quasi vides. Les graines du figuier sauvage du cinéaste iranien Mohammad Rasoulof a été simplement signalé comme « présent » en recevant un maigre et insultant lot de consolation, ce Prix Spécial qui n’existe même pas !
Insulte et aveuglement ou alors bêtise tant se devine dans cette stratégie l’envie d’arracher la Palme à toute suspicion politique. Or, c’est exactement le contraire qui se produit puisque ce grand film politique est d’abord un grand film de cinéma ! En lui remettant un prix fantôme, on ne fait que saluer le geste et l’engagement politique. Au-delà de la charge, de l’urgence, de sa colère, Les graines du figuier sauvage est admirable comme œuvre de cinéma. C’est un film qu’on reverra et étudiera encore longtemps, comme seuls les vrais chefs-d’œuvre, ce qu’il est à n’en point douter. Tant et si bien qu’en le découvrant vendredi, les 21 films vus auparavant ont paru soudain petits et maigres.
Tout débute par une promotion : après ce qu’on devine des années de bons et loyaux services, un père de famille devient juge d’instruction du régime des Mollahs en place. Peu à peu, ses trois femmes (son épouse et ses deux grandes filles, au sortir de l’adolescence) se réveillent et prennent conscience des crimes dont il est coupable, notamment après l’annonce de la mort de la jeune Mahsa Amini en septembre 2022. Alors qu’éclate la révolte menée par le mouvement Femmes, vie, liberté, la mère sort de son déni, s’arrache à sa position conservatrice tandis que ses filles réalisent chacune à sa manière et pour des raisons différentes qu’elles cohabitent avec leur ennemi. Celui qu’elle prenait pour Dieu est un bourreau comme tous ces travailleurs consciencieux de la mort qui hantent le cinéma du réalisateur de 52 ans. L’allégorie nationale est certes limpide dans chaque recoin de son scénario, chaque caractérisation mais Rasoulof n’a que faire du message didactique comme de l’abstraction s’il est délesté de tout poids de réel et de toute chair. Il joint ainsi par intermittences des vidéos Internet de répression qui ouvrent les fenêtres opaques de cet appartement asphyxiant sur un mur de violences grainé par quelques percées d’espoir.
Le film se renverse lorsque les femmes pansent et soignent en secret, dans cet appartement, une jeune femme blessée au visage au cours d’une rixe. Scène inoubliable et iconique, filmée en un très long plan, sous une lumière argentée qui tuméfie davantage chaque plaie. Le son accroît le bruit des ustensiles pour arracher à ses plaies les balles de chevrotine. Cette séquence rend compte matériellement et dans le plus grand dénuement de la souffrance de tout un peuple. A partir de ce moment où actrices, personnages et spectateurs ont pu saisir l’impact de la violence du régime, l’arme administrative du père, véritable sceptre de son pouvoir, disparaît. Dépossédé de cet objet, à la fois symbolique et tangible, il craint d’être à son tour disqualifié, arrêté, poursuivi. Se devine dans son obsession à retrouver cette arme, l’angoisse existentielle de tout perdre et devenir à son tour celui qu’il n’a cessé de renier, combattre, arrêter, torturer, abattre et assassiner.
Rasoulof a donc l’art de tendre vers l’abstraction sans jamais perdre de vue le réel et le matériel. Si bien qu’il peut s’aventurer dans les zones les plus troubles et les plus taboues. Les graines du figuier sauvage ose plonger au cœur des questions qui fâchent vraiment, regarder le bourreau au sein du foyer, mettre carte sur table à propos de ce qu’on cherche à préserver. A quel prix justifie-t-on l’intolérable au nom de la famille et du confort ? Pour une fois, et à l’inverse de la tendance actuelle à n’épouser qu’un seul et même point de vue (généralement celui de la victime), le film s’intéresse autant aux victimes qu’au bourreau et ose enfin les confronter. L’affrontement est total : intime, politique, existentiel et charnel. Au terme d’un festival si souvent sentimental, Rasoulof ose mettre en crise et à mal la sempiternelle fiction familialiste.
Beaucoup d’infantilisme : le cinéma-slime
A l’instar de Yorgos Lanthimos (récompensé d’un Prix d’interprétation masculine pour Jesse Plemons dans l’immense, complexe et si cruel Kind of Kindness qui sort en juin), Miguel Gomes (Prix de la mise en scène pour l’indigeste mais souvent magnifique Grand Tour) et la prodige indienne Payal Kapadia (récompensée d’un Grand Prix justifié pour son poème impressionniste et impressionnant sur les injonctions faites aux femmes dans son pays : All We Imagine as Light) , la plupart des cinéastes récompensés auront su faire preuve d’un ton adulte avec leurs spectateurs, se refusant à les prendre pour des enfants comme Lellouche et Coppola, notamment. Au moins avec son adaptation risquée de La plus précieuse des marchandises, le conte de Jean-Claude Grumberg, Michel Hazanavicius réussit à se montrer adulte pour conter avec sérieux la Shoah aux enfants en évitant tous les pièges en termes de représentation, de sentimentalisme et de simplification.
Plus infantile, plus adolescent surtout, avec ce que cela peut avoir de bravache, furieux, fun et simpliste, c’est à un grand manège que nous convie avec conviction la française Coralie Fargeat, récompensée d’un improbable prix du scénario pour le très amusant mais anecdotique The Substance. Le film a beau lui aussi chercher à mêler fable et matérialité organique, il demeure propre et prisonnier de sa fable morale sur l’âgisme. S’il paraît démesuré en termes plastiques avec ses torrents de chair molle et de sang, il reste en fin de compte assez sage et conventionnel ; si bien qu’il amuse et flatte le spectateur (qui s’interroge sur ses propres limites) plutôt que de provoquer une réelle et durable stupeur. Tout ça demeure à l’état de cinéma-slime, visqueux mais surtout marrant et inoffensif. Avec Emilia Perez, Jacques Audiard reçoit un mérité Prix Collégial d’Interprétation Féminine et un Prix du Jury. Si leurs films sont dans leurs genres respectifs (l’horreur et la comédie musicale) des réussites, ils demeurent un peu dérisoires au regard des grands films de cette Compétition. Animés de grandes interrogations, et malgré leurs indiscutables vertus de cinéma (surtout Audiard qui rayonne simplement par la richesse et la diversité de ses inventions, notamment en termes de comédie musicale), le dialogue avec les films se tarit vite, leur éclat de Carrousel géant se ternit sitôt les lumières rallumées.
Rejaillissent par flashs leurs éclats de lumières à pétales d’or, leurs protubérances de sang solaire, quelques échos de chansons pop mais rien d’autre… Quelques jours après leurs projections, ces films déjà implosaient sur eux-mêmes en bribes d’images floues, s’effaçaient de leur corporéité et dans leur totalité comme certaines séries avant d’être presque totalement balayés par le figuier sauvage de Rasoulof qui a pris racine en chacun de nous. Comme seuls les grands films, il n’en finira dorénavant plus jamais de pousser.