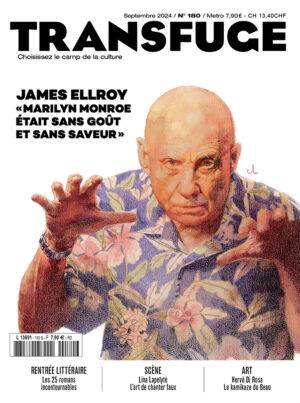Après ses passionnantes Mémoires parues en 2015, Serge Klarsfeld revient avec un texte, On pensait qu’il allait revenir, fruit d’un entretien mené dans le cadre de la collection « Mémoires de la Shoah ». Où il retrace toute sa vie.
Sa vie de combat, nous la connaissons bien. Les chasseurs de nazis, avec sa femme Beate, les coups médiatiques, les procès retentissants. Une vie aventureuse folle, efficace, intellectuelle, physique, sans tâche. Oeuvrant pour la mémoire juive, pour la mémoire occidentale. Grâce à eux, les salops ont eu des visages : Klaus Barbie, Maurice Papon, Paul Touvier et quelques autres. Ici, avec On pensait qu’il allait revenir, le récit se veut plus intime. Il s’étend de ses origines, de sa famille aisée juive en Roumanie et en Bessarabie, jusqu’à la création de son association des fils et filles de déportés, en 1979, « sa nouvelle famille ». Entre les deux, de longues pages sur la guerre, sur le père arrêté à Nice puis déporté, sur son destin d’enfant juif orphelin, l’école buissonnière, sa réconciliation avec l’Allemagne, et, le cœur de sa vie, la Shoah, les juifs, Israël, qui « impliquait de faire passer cela avant toute considération de carrière, de vie tranquille… »
J’ai rencontré Serge Klarsfeld à son bureau, rue de la Boétie. Un homme calme, aimant, serein, heureux du travail accompli, assurément. Beate, sa femme, élégante, discrète, passe de temps à autre. Un couple, un vrai.
Vous parlez beaucoup de votre père dans ce livre, est-ce qu’il reste des zones d’ombre dans la trajectoire de votre père ?
J’ai trouvé toutes les archives possibles, mais la période de novembre 1943 au moment où il a été sélectionné pour 9 mois, où il a travaillé dans une mine, il n’y a pas d’archive. Je ne peux que m’imaginer ce qu’il a subi. Les travailleurs en moyenne vivaient six semaines au plus, lui 9 mois. Il avait une volonté de vivre très forte. Après, il a été victime de son tempérament… À partir du moment où l’on entrait à Auschwitz, il ne fallait pas riposter. Il a riposté, il a assommé un kapo. S’il n’avait pas fait ça, il aurait probablement survécu. Il n’a pas respecté la règle des camps. Il était costaud, il avait une forte personnalité.
Dans votre combat pour la mémoire de la Shoah, quel a été le moment le plus fort, dont vous avez été le plus fier ?
Les moments les plus heureux, incontestablement, ce sont les moments de satisfaction de voir arrêter les grands criminels nazis qui ont organisé la Solution finale en France. Klaus Barbie, bien sûr, que nous avons mis dix ans pour parvenir à le faire expulser de Bolivie.
Vous savez, c’étaient de longues campagnes que nous organisions pour faire arrêter ces criminels, dix ans, parfois vingt ans de travail… il y a eu d’autres moments heureux, comme le jugement en RFA des responsables de l’appareil policier en France, Kurt Lischka, le chef de la Gestapo à Paris, Herbert Martin Hagen et Ernst Heinrichsohn. En plus d’être condamnés, la cour d’assises en Allemagne a décidé de les mettre en prison, alors qu’à l’époque, l’Allemagne ne mettait pas les Nazis en prison. J’ai presque eu pitié d’eux car la prison, c’est dur. On est séparé de sa famille. On l’a expérimentée avec ma femme suite à notre tentative d’enlèvement de Lischka, on s’ennuie au bout du moment, malgré la lecture de pléiades…
Vous êtes passé aussi par des moments de doutes, de difficultés ?
Oui, incontestablement, en 1973, quand j’étais désespéré parce que je pensais que la situation était bloquée, je suis allé avec un revolver pointé non chargé sur Lischka, dans la rue. J’ai risqué ma liberté… Mais je voulais montrer aux Allemands qu’on pouvait tuer ces nazis, au lieu de les faire juger. C’était difficile de ne pas le tuer, mais encore plus de le tuer, car c’était un acte de désespoir. Nous voulions faire pression sur le Parlement allemand pour qu’il ratifie la convention franco-allemande de 1971 qui permettait à la RFA de poursuivre les criminels de guerre nazie condamnés par contumace en France.
Vous avez des regrets dans votre combat, Alos Brunner par exemple, le bras droit d’Adolphe Eichmann, qui n’a jamais été arrêté.
Bien entendu, je regrette. Mais on l’a fait condamner par la cour d’assises de Paris en 2001. C’est d’ailleurs la seule occasion où ma fille, mon fils et moi avions plaidé comme avocats. Aujourd’hui, aucun de nous n’est encore avocat ! Je suis allé deux fois en Syrie et Beate trois fois, pour aller chercher. À chaque fois, on s’est fait expulser, en 1982, en 1987, en 1990. On savait où il était, mais Assad ne reconnaissait pas l’existence de Brunner en Syrie et en dépit des demandes d’extradition qu’on avait pu obtenir de la France et de l’Allemagne, aucun des deux pays n’a obtenu satisfaction. Le clan Assad était très fort, il l’est toujours d’ailleurs. Mais on a quand même changé le destin de Brunner. Il vivait dans une belle résidence avant qu’on ne vienne le chercher. Suite à mon passage là-bas, il a eu peur, a déménagé dans un sous-sol d’un hôtel avec des gardes du corps, dans de très mauvaises conditions. Sa fin de vie a été marquée par tout ce qu’il a fait pendant la guerre. Beate a manifesté à Damas devant le ministère de l’Intérieur, elle a été arrêtée. Moi aussi, mais plus aimablement, la police politique était moins dure qu’aujourd’hui. Avec les étrangers, ils étaient plus coulants, il faut le dire. Une fois, à Damas, j’étais dans un hôtel de luxe, je leur ai demandé de me louer un théâtre pour faire une conférence intitulée : les criminels nazis, de Klaus Barbie en Bolivie à Aloïs Brunner, en Syrie. Le lendemain, les policiers sont venus me chercher, m’ont mis dans le premier avion qui décollait, et chose amusante, cet avion allait à Vienne, la ville d’enfance d’Aloïs Brunner !
Avec Beate, avez-vous toujours été d’accord dans votre combat sur les méthodes et objectifs ?
Oui on a toujours beaucoup discuté. Et à partir du moment où mon fils a été adolescent, on a discuté tous les trois.
Vous dites d’ailleurs que votre fils dès trois ans, venait avec vous sur le terrain.
Oui, mais parce que nous n’avions pas le choix, personne pour le garder.
Il a toujours été clair pour vous que vos enfants reprendraient votre combat ?
Non, notre fille Lida a été avocate dans le procès Papon et dans le procès Barbie, mais on a été moins oppressif avec elle qu’avec Arno. Tout le monde me disait, « vous élevez mal vos enfants », « que vont-ils devenir, ils vous suivent partout… » Ma fille est devenue avocate sans problème, notre fils était avocat en Amérique, en France, et il est conseiller d’état depuis plus de 15 ans. Ils n’ont pas été si mal élevés, non ? Notre fille vit aujourd’hui à Rome, elle s’occupe de ses trois enfants. Elle n’est plus dans les combats, mais elle s’y intéresse beaucoup. Elle s’intéresse beaucoup au futur musée de l’holocauste à Rome. Elle est encore impliquée dans ces problèmes de mémoire. Notre fils est plus impliqué, certes. C’est lui qui reprendra le flambeau, même s’il est déjà très investi dans notre association des fils et filles de déportés.
Article complet à retrouver dans le N°178 mai 2024 – disponible en kiosque et en version numérique
On pensait qu’il allait revenir, de Serge Klarsfeld, éditions Flammarion 224p., 21€. À paraître le 29 mai