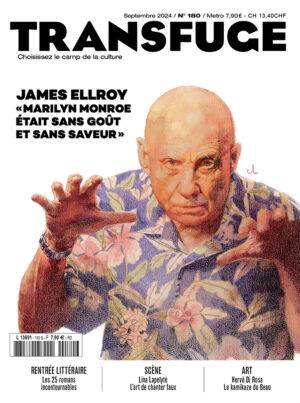Tension de tous les instants, rare puissance de concentration : le roman de Michal Ben-Naftali est un chef-d’œuvre de gravité et de densité.
Qu’est-ce qui, dans ce roman dense et tendu, brise ainsi le cœur ? Pourquoi a-t-on l’impression, chaque fois que les mille incidents de la lecture (une montre à consulter, un téléphone importun à réduire au silence) impriment au livre qu’on tient en mains un mouvement quelconque, saccade ou infime déplacement d’axe – pourquoi a-t-on le sentiment d’entendre s’entrechoquer les morceaux brisés d’un bel objet mal définissable ? Oui, quels sont ces tessons auxquels Ana s’écorche alors qu’elle retrace l’histoire de cette amitié tournée en liaison et en tragédie avec Liora, dans ce roman qui évoque parfois Yaël Neeman et son Elle était une fois ?
« Amitié », « liaison », « tragédie » : comme ces termes approximatifs, aux sonorités creuses, peinent à dire ce qui a eu lieu ! Et comme Ana, qui se souvient de cette période où elle était étudiante en histoire, à Jérusalem, peine à la dire cette histoire ! Mais non, elle ne « peine » pas – elle trouve les seuls vocables qui vaillent, la seule langue qu’appelait de toute nécessité cette histoire à la fois indéchiffrable et aveuglante d’évidence : une langue qui ménage l’ombre, le bizarre, les perspectives fuyantes et inélucidées tout en s’efforçant, sans afféterie aucune, de forcer le plus secret de ses rapports avec son aînée, cette Liora qui perd la vue. Ici, Ana examine une photo des parents de Liora et regarde « avec effroi une femme mince, droite, élégante, glaciale, royale, comme si je regardais une photo de paysage » ; là, Liora fait « une grimace de clown pitoyable qui a la nausée à force d’expédier des œufs dans sa gorge ». C’est un des grands talents de Michal Ben-Naftali : creuser ainsi des échappées d’étrangeté, laisser indécis et gros de cent possibilités le sens – qu’est-ce que regarder une femme sur une photo comme un paysage ? Le texte est ainsi semé d’éclats transperçants, le sens discrètement mais irrévocablement disloqué.
Mais, encore une fois, qu’est-ce qui s’est ainsi brisé, laissant ces traces stylistiques comme autant de témoins rompus ? Le mémoire d’Ana, étudiante, sur la sorcellerie ; Liora, étrangère à sa propre famille, étrangère aux impératifs sociaux dont sont tributaires les femmes, en l’occurrence la maternité : le couple d’Ana et Yohann qui se désagrège ; le passé aussi et les obstacles qui se dressent lorsqu’on tente de le restituer ; les espaces qu’il est tout un art d’habiter ; enfin et surtout, l’histoire déchirante, la déchirure qu’est l’histoire d’Ana et Liora : peu à peu, et comme indépendamment des facultés d’analyse du lecteur, dans cette zone de l’esprit où l’intellect le cède à d’autres modalités de la pensée, la nature de la destruction se précise. La sorcière, cette exilée des normes sociales, les couples désagrégés, le présent divorcé du passé : le livre est hanté par la séparation. Le vase précieux, le joyau inestimable qu’on appellera amour, unité, société, s’est brisé.
Michal Ben-Naftali, Ne vois-tu pas que je brûle ? Traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech, Actes Sud, 144p., 18,50€, plus d’informations