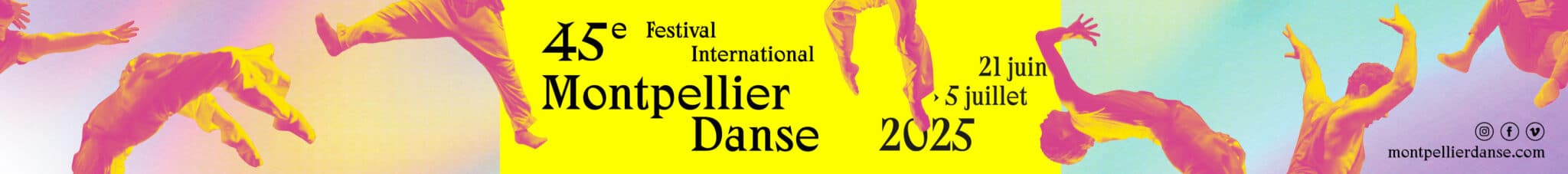François Xavier Roth et Cédric Klapisch présentent une Flûte enchantée revue à notre époque, un peu figée, mais musicalement merveilleuse.
Souvent on pense qu’un metteur en scène est un créateur tous terrains, pouvant passer d’un medium à un autre, sans jamais perdre sa fraîcheur, son acuité, son originalité. Opéras et cinéma n’obéissent pourtant ni aux mêmes règles ni à la même urgence dramaturgique. La grammaire d’un film et celle d’une œuvre d’art lyrique ont beau être fort différentes, nombre de cinéastes ont été tenté par le théâtre musical. Visconti, Tarkovski, Polanski, Terry Gilliam, Ken Russel, James Gray se sont, avec des bonheur divers, essayés à l’exercice. Récemment, l’une des plus incontestables réussites était le Don Giovanni de Mickael Haneke, à l’Opéra de Paris : une lecture au scalpel, glaçante, où le réalisateur autrichien démontre combien il sent la musique. Car c’est souvent là que le bât blesse : l’opéra est un univers, une culture, une sensibilité qui doit couler un tant soit peu dans les veines du scénographe. Penser qu’on est simplement au théâtre est une erreur que de nombreux cinéastes ont commise.
En apprenant que Cédric Klapisch allait mettre en scène La Flute enchantée au Théâtre des Champs-Élysées, on était évidemment curieux de voir comment l’auteur du Péril jeune allait affronter ce singspiel de 1791. Que ce très fin observateur de la société actuelle, aux films hyperréalistes, ait choisi l’œuvre la plus symbolique de Mozart était étrange, mais pourquoi pas ? D’emblée Klapisch opte pour la lisibilité, puisqu’il impose les textes parlés en langue française, ce qui est plutôt heureux. Les puristes seront en droit d’être irrités par sa récriture très contemporaines des dialogues de Schikaneder, truffés de clin d’œil au wokisme et autres débats du moment, mais il faut avouer que la greffe fonctionne et fait rire la salle. On est en revanche chagriné de constater que les moments où Klapisch est le plus inspiré, le plus lui-même, sont ces mêmes passages parlés. Dès qu’arrive la musique, tout se fige et les chanteurs se déplacent sans la moindre originalité, comme des pions sur un échiquier. La spontanéité fait place à une lecture propre mais scolaire, trop lisse pour qu’on y adhère. Que la Flûte enchantée soit un grand rite initiatique est indéniable, mais chez Klapisch cela empèse les mouvements, les gestes, au point d’être redondant et finalement bien fade.
La distribution a l’avantage d’être homogène en âge et en diction française. Personne ne démérite mais personne n’éblouit vraiment : Cyrille Dubois est un Tamino charmant, Regula Mühlemann une jolie Pamina, Florent Karrer un Papageno cocasse, Jean Teitgen un bon Sarastro et tout est à l’encan. Se dégagent toutefois, en mal et en bien, la reine de la nuit poussive d’Aleksandra Olczyk, dont les aigus cristallins rappellent moins Baccarat que Duralex ; et l’excellent Monostatos de Marc Mauillon, qui semble le seul à vraiment s’amuser (et à avoir inspiré Klapisch, lequel transforme ce maure bien peu politiquement correct en un tenancier de donjon SM lâche et rigolard).
Disons que si Mozart est vraiment présent, ce soir, c’est dans la fosse. On pourra être agacé par la lecture anguleuse, presque abrasive, à l’os de François Xavier Roth et son orchestre Les Siècles, mais voilà un chef qui n’enfonce pas les portes ouvertes et n’enchaîne pas les truismes. Sa Flûte bondit, chouine, couine, montrant qu’elle est bien plus vivante qu’une simple mise en image, et qu’il suffit de fermer les yeux pour la parer de couleurs, de relief, de magie. Quand on joue à cache-cache avec une œuvre, la musique est toujours gagnante.
La Flûte enchantée, de Mozart, direction musicale François-Xavier Roth, mise en scène Cédric Klapisch, Théâtre des Champs Elysées, jusqu’au 24 novembre, plus d’informations