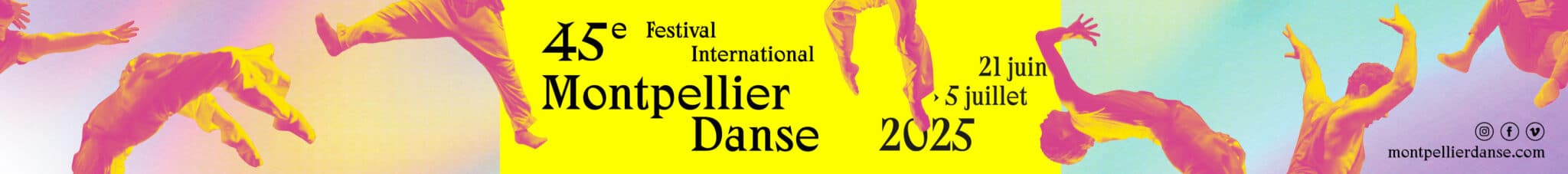Une cuvette dans une enceinte de montagnes. Première image, et déjà la patte de Kelly Reichardt : ce paysage, à l’instar de ceux de La Dernière Piste est signé : les grands espaces US, mais clos, bordés, comprimés. La terre, le ciel, pris dans un glacis de teintes froides, l’hiver est littéralement dans l’air, il l’infuse, le glace. Plan long, comme un tableau aux couleurs éteintes, passées à l’étouffoir, mais sublimement composé. Car voici qu’entre sur la diagonale des rails, à un rythme qui semble lui aussi contaminé par l’immobilité minérale des murailles rocheuses à l’arrière-plan, un train. Un bloc trapu, mouvant, de métal. Ce plan condense à lui seul tout le film, cette tension entre le figement dans l’espace et dans le temps et dessous, occultée mais sensible, une puissante énergie motrice à l’image de celle qui anime les bielles et les pistons du train. Car les trois vies de femmes qui se succèdent, puis s’entrecroisent, sont autant de tentatives pour capter l’intensité des passions, des émotions, des rêves dans un monde où tout semble ployer sous un ciel d’hiver qui ressemble au mélancolique couvercle du poème de Baudelaire. Il y a Laura (Laura Derns, qui semble échappée d’une variation de Todd Haynes sur les héroïnes de Douglas Sirk, l’embrasement coloriste en moins), l’avocate vieillissante et son client, brave type pris dans une spirale de mouise. Mais ce taedium vitae est trompeur : elle rayonne dans une relation adultère, il laisse éclater sa colère en se muant en preneur d’otages. Soit dit en passant, Kelly Reichardt prouve, dans ce qui n’est qu’un épisode parmi d’autres du film, qu’elle est une grande cinéaste, capable de réinventer les pires poncifs : on n’avait jamais vu de scène de prises d’otages ainsi filmée, comme un rêve cotonneux. Puis c’est l’histoire de Gina, son mari et sa fille, une famille dont Kelly Reichardt cartographie les fractures sans effets de manche : un plan sur le visage durci de Michelle Williams, un plan sur celui fermé de son ado de fille. Car la cinéaste sait que le meilleur capteur affectif, c’est le visage, qu’il suffit de le cadrer, de l’approcher, pour que, déconnectée de toute psychologie lourdement explicative, la richesse de la vie du coeur et des sentiments apparaissent. Kelly Reichardt s’intéresse moins aux hauts et aux bas de la psyché qu’elle ne cherche à en saisir, incarnées dans la peau, et dans la lumière que celle-ci retient ou diffuse, les intensités. Une science de la figure humaine qui touche sans doute à son point culminant dans le troisième récit, celui de cette employée de ranch (Lily Gladstone, prodigieuse, avec ce corps opaque dans sa robustesse, et cette transparence des sourires qui disent la tendresse) qui s’éprend d’une jeune avocate (Kristen Stewart), échouée dans les parages pour donner des cours du soir. Histoire vouée à l’échec, mais pas une once de pathos. Kelly Reichardt invente le mélo qui n’en fait pas trop.
Une cuvette dans une enceinte de montagnes. Première image, et déjà la patte de Kelly Reichardt : ce paysage, à l’instar de ceux de La Dernière Piste est signé : les grands espaces US, mais clos, bordés, comprimés. La terre, le ciel, pris dans un glacis de teintes froides, l’hiver est littéralement dans l’air, il l’infuse, le glace. Plan long, comme un tableau aux couleurs éteintes, passées à l’étouffoir, mais sublimement composé. Car voici qu’entre sur la diagonale des rails, à un rythme qui semble lui aussi contaminé par l’immobilité minérale des murailles rocheuses à l’arrière-plan, un train. Un bloc trapu, mouvant, de métal. Ce plan condense à lui seul tout le film, cette tension entre le figement dans l’espace et dans le temps et dessous, occultée mais sensible, une puissante énergie motrice à l’image de celle qui anime les bielles et les pistons du train. Car les trois vies de femmes qui se succèdent, puis s’entrecroisent, sont autant de tentatives pour capter l’intensité des passions, des émotions, des rêves dans un monde où tout semble ployer sous un ciel d’hiver qui ressemble au mélancolique couvercle du poème de Baudelaire. Il y a Laura (Laura Derns, qui semble échappée d’une variation de Todd Haynes sur les héroïnes de Douglas Sirk, l’embrasement coloriste en moins), l’avocate vieillissante et son client, brave type pris dans une spirale de mouise. Mais ce taedium vitae est trompeur : elle rayonne dans une relation adultère, il laisse éclater sa colère en se muant en preneur d’otages. Soit dit en passant, Kelly Reichardt prouve, dans ce qui n’est qu’un épisode parmi d’autres du film, qu’elle est une grande cinéaste, capable de réinventer les pires poncifs : on n’avait jamais vu de scène de prises d’otages ainsi filmée, comme un rêve cotonneux. Puis c’est l’histoire de Gina, son mari et sa fille, une famille dont Kelly Reichardt cartographie les fractures sans effets de manche : un plan sur le visage durci de Michelle Williams, un plan sur celui fermé de son ado de fille. Car la cinéaste sait que le meilleur capteur affectif, c’est le visage, qu’il suffit de le cadrer, de l’approcher, pour que, déconnectée de toute psychologie lourdement explicative, la richesse de la vie du coeur et des sentiments apparaissent. Kelly Reichardt s’intéresse moins aux hauts et aux bas de la psyché qu’elle ne cherche à en saisir, incarnées dans la peau, et dans la lumière que celle-ci retient ou diffuse, les intensités. Une science de la figure humaine qui touche sans doute à son point culminant dans le troisième récit, celui de cette employée de ranch (Lily Gladstone, prodigieuse, avec ce corps opaque dans sa robustesse, et cette transparence des sourires qui disent la tendresse) qui s’éprend d’une jeune avocate (Kristen Stewart), échouée dans les parages pour donner des cours du soir. Histoire vouée à l’échec, mais pas une once de pathos. Kelly Reichardt invente le mélo qui n’en fait pas trop.
Une saison froide et chaude
Avec Certaines femmes, Kelly Reichardt réalise un magnifique film, aussi passionné qu'élégiaque