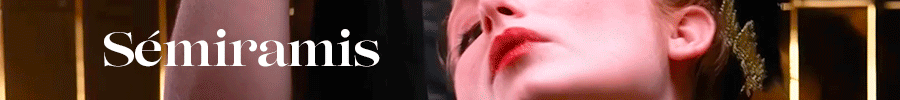Lire Richard Millet, dont l’opuscule fraîchement paru, Tuer, fonctionne comme un concentré d’éléments biographiques (le Limousin, le Liban, « la chiennerie du monde littéraire français » qui le persécuterait, lui, l’agneau sacrificiel des Lettres) et obsessionnels (la parole, le silence, la guerre), c’est d’abord, n’en déplaise aux tenants du style comme critère de qualité littéraire, se rendre compte qu’on peut faire de la mauvaise littérature avec de bonnes phrases. Millet n’est pas un manchot de la plume et hors ses algarades bilieuses contre l’état de déprédation de la langue, il sait enrouler ses mots, concilier des strates de temps composite dans des propositions fluidement enchaînées. On hasardera l’hypothèse suivante : Millet-l’écrivain tente de résister par ce qu’il fait de mieux – ses phrases – aux autres Millet.
Passons sur Richard-l’idéoloque, qui se contente de distiller la réactionnite, cette substance bilieuse faite d’opinions hâtives et de rancoeurs qui empoisonne l’air du temps et qui nous vaut des geignements sur «l’immigration islamisée dont le flux grandissant est autrement redoutable que les bombes » et autres joyeusetés de comptoir du même acabit. Ce Millet-là est l’équivalent, en plus chic, car « littéraire », du sinistre cirque médiatique des épiciers et des exploiteurs de la confusion des esprits.
Non, le plus singulier dans Tuer, récit, ou plutôt méditation-confession sur sa participation à la guerre du Liban, en 1975-1976, aux côtés des chrétiens, tient à sa vision faussée du mysticisme – contresens pour le moins intrigant chez quelqu’un qui clame à l’envi sa fidélité au catholicisme. Nous ne sommes pas historien, on laissera donc à Millet l’entière responsabilité de ses analyses sur le discrédit et le silence qui entourent les chrétiens libanais en Occident. Et ne discutera pas, non plus, ce que semble avoir de poussiéreux sa vision « épique » de la guerre, ses envolées sur l’héroïsme à la Achille, et la résurgence d’un fonds irrationnel-archaïque tout droit sorti de ses lectures de Jünger. On n’en discutera pas pour la bonne et simple raison que Millet clôt toute conversation sur ce chapitre en affirmant la primauté de l’expérience vécue, le petit critique littéraire qui n’a jamais tenu de Kalach étant donc infondé à remuer ces graves sujets. Soit – et peu importe. Car le point nodal de Tuer est ailleurs : dans la façon dont Millet-le catholique use, et abuse diraient d’aucuns, de tout le répertoire lexical et conceptuel de la pensée mystique (le lien paradoxal entre la vérité et le silence, la littérature comme expérience intérieure), tout en en proposant ce qui n’est qu’une parodie.
Le mouvement fondamental du mysticisme est d’ordre chimique, ou physique : c’est une dissolution de soi. Expansion, dilatation, anéantissement, qu’importe, ce qui compte c’est la fin du « je ». Bien sûr, Millet dissout – mais c’est l’autre (l’autre homme, l’autre femme) qu’il efface, soit qu’il plaque sur lui des catégories esthétiques (la grâce avec laquelle chute un combattant touché à mort), soit qu’il invoque un état d’indifférence supérieure. Mais justement, le coeur du livre n’est-il pas cet épisode de 1975 où, pressé de tuer un ennemi blessé, il suspend son geste, incapable d’appuyer sur la gâchette ? Un moment où, écrit-il, « j’étais plus humain que je ne l’avais jamais été. » Tuer raconterait ce moment où un jeune homme fait l’apprentissage de l’humanité. Sauf qu’il s’agit d’un leurre. Millet découvre moins autrui que la valeur de sa propre vie ; par une sorte de transfert, il échappe à l’« espoir insensé » de sa propre mort. On est loin de l’abolition mystique du Moi, qui est ici conservé, consolidé. On repense au passage sur la Kalachnikov, qui fait partie de ces instruments qui « donnent de l’aplomb » au jeune guerrier, lui donnent épaisseur et consistance. Richard Millet ou Narcisse faussement mystique, qui n’arrive pas à se défaire de lui-même.
Richard Millet, Tuer, Editions Léo Scheer, 120 pages, 15 euros