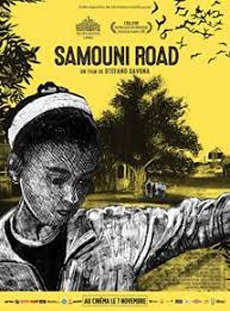 Sept ans après Tahrir, place de la Libérationl’archéologue et anthropologue Stefano Savona raconte dans Samouni Roadcomment une famille palestinienne fut, en 2009, victime d’un raid particulièrement meurtrier de l’aviation israélienne dans la bande de Gaza. Sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs, il a remporté l’Oeil d’or du meilleur documentaire. Il faut dire que le film est d’une puissance rare : en alternant des scènes prises sur le vif avec des séquences animées, Stefano Savona réussit à nous immerger dans une catastrophe dont, pourtant, il ne reste aucune image. Il parvient à restituer un fait réel avec une ampleur narrative et un foisonnement de détails propres à l’art du romancier. Surtout le film n’a rien de manichéen ou de monolithique : grâce au style très particulier des images animées de Simone Massi, Samouni Road réussit à faire coexister, dans un même souffle épique, la fureur de la guerre et la poésie bucolique des travaux agricoles. Nous tenions à nous entretenir avec l’auteur d’un tel ovni cinématographique. Nous avons rencontré Stefano Savona à la Fémis où il anime un atelier d’écriture documentaire.
Sept ans après Tahrir, place de la Libérationl’archéologue et anthropologue Stefano Savona raconte dans Samouni Roadcomment une famille palestinienne fut, en 2009, victime d’un raid particulièrement meurtrier de l’aviation israélienne dans la bande de Gaza. Sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs, il a remporté l’Oeil d’or du meilleur documentaire. Il faut dire que le film est d’une puissance rare : en alternant des scènes prises sur le vif avec des séquences animées, Stefano Savona réussit à nous immerger dans une catastrophe dont, pourtant, il ne reste aucune image. Il parvient à restituer un fait réel avec une ampleur narrative et un foisonnement de détails propres à l’art du romancier. Surtout le film n’a rien de manichéen ou de monolithique : grâce au style très particulier des images animées de Simone Massi, Samouni Road réussit à faire coexister, dans un même souffle épique, la fureur de la guerre et la poésie bucolique des travaux agricoles. Nous tenions à nous entretenir avec l’auteur d’un tel ovni cinématographique. Nous avons rencontré Stefano Savona à la Fémis où il anime un atelier d’écriture documentaire.
Au début Alma dit ne pas savoir comment raconter son histoire. Plus tard, quand il évoque la sourate sur la pluie, le père explique à ses enfants que la dignité humaine consiste à savoir raconter son histoire. Là est tout l’enjeu du film…
Oui, le but du film était de raconter cette histoire dans sa spécificité. D’isoler quelques personnages principaux, de les voir agir dans un moment où des choix s’offrent à eux, aussi minimes soient-ils. Mon devoir de metteur en scène était de raconter cette histoire avec les propres mots des protagonistes : les évènements relatés dans le film sont issus de témoignages, d’interviews, de conversations. Et ainsi de rendre hommage à leur manière de se dire car, en dernier ressort, notre humanité tient à notre capacité à nous raconter. Le père avait appris des poèmes et des sourates à ses enfants. Ils ont vraiment lu la sourate sur les éléphants juste avant le bombardement. Mais je me suis rendu compte que la parole filmée n’est pas aussi puissante et évocatrice que la parole vivante. Je devais donc retranscrire cette parole dans un autre médium : c’est pourquoi j’ai pensé à l’animation.
D’ailleurs pour se raconter, ils ont souvent recours au dessin. Alma dessine un sycomore sur le sol…
Absolument. Je voulais rendre compte du caractère imagé de leurs récits. Ces enfants passent leur temps à dessiner par terre. Je voulais qu’on sente que les images animées étaient imaginées par des enfants. Mais je n’aurais pas pu le faire en animant les images telles que les enfants les dessinaient car je voulais utiliser un dessin réaliste, compatible avec le documentaire. Or le pastel très gras évoque la boue, la terre mouillée. Simone Massi utilise la carte à gratter : il part d’une surface entièrement noire et fait apparaître la lumière par une succession de traits, comme le burin en gravure. Le processus du dessin ressemble donc beaucoup à celui du travail dans les champs ou à celui qui consiste à gratter la terre pour retrouver ce qui a été détruit après un éboulement ou des bombardements.
Le film, bien qu’il raconte un massacre, comporte un élément de poésie bucolique, presque virgilienne…
Effectivement, j’ai été frappé par la manière dont mes personnages font référence à la nature. Ils n’utilisent pas la traditionnelle rhétorique palestinienne de « la terre » mais parlent d’une terre bien spécifique avec ses salades, ses oliviers, ses amandiers, ses mauves, etc. Amal, par exemple, entretient un rapport très spécial avec les animaux. Ce lien au monde végétal peut paraître anecdotique par rapport à la tragédie. Pourtant au montage j’ai lutté pour conserver cette dimension car mon film est un abécédaire gazaoui. Je voulais rentrer dans leur univers, leur rythme, leur mythologie pour raconter un monde bucolique, hors du temps, impacté par la tragédie.
Cette caractérisation des personnages permet aussi de sortir le réfugié gazaoui de son statut de victime anonyme tel que le propagent les médias traditionnels…
Oui. Mon problème comme réalisateur était le suivant : comment raconter cette histoire du point de vue des enfants dans un temps court et dans une forme cinématographique puissante ? D’autant que lorsqu’ils évoquaient leurs souvenirs, c’était souvent sur le mode de la tristesse, de la déploration, ce que je tenais à éviter. En même temps, je ne voulais pas faire un film de fiction parce que je m’étais trop attaché à ces gens, à leurs visages. L’animation m’est apparue comme la seule solution. Avant même que je voie L’Image manquante, film dans lequel Rithy Panh utilise des marionnettes, je savais qu’il fallait faire des allers-retours continus entre le documentaire et l’animation. Le risque était que l’animation paraisse fausse par rapport à la situation tragique racontée dans le film. Qu’elle nous fasse sortir de l’histoire des protagonistes alors que je voulais précisément le contraire : que l’animation construise une couche d’intimité supplémentaire avec les personnages.
Comment avez-vous pensé à imaginer des plans de drone ?
Je voulais qu’on comprenne les raisons exactes qui avaient présidé à ce massacre. Sinon cela aurait empêché le spectateur de ressentir la spécificité de cette histoire. Il fallait donc trouver une manière de mettre en scène la mécanique du massacre. Or on ne pouvait pas utiliser la même technique d’animation que pour les autres images animées puisque celles-ci ont pour fonction de traduire le point de vue des enfants. Tout ce que j’ai mis en scène coïncide avec les résultats de la commission d’enquête : le refus d’un soldat de tirer sur des civils, la confusion entre un morceau de bois et un lance-roquettes, etc. On a d’ailleurs montré le film au festival de Jérusalem. C’est là-bas une histoire de notoriété politique. Une chose curieuse s’est passée : Amira Hass, la journaliste dont j’ai mis en scène le récit a crié d’effroi pendant la projection alors qu’elle connaît cette histoire par coeur. C’est la puissance du cinéma.
Comme si la fiction était parfois plus « vraie » que le réel….
Oui, je m’inscris dans le sillon d’un Truman Capote ou d’un Norman Mailer, qui utilisent les manières de raconter propres à la fiction pour documenter des faits réels. Truman Capote a mis six ans pour écrire De sang froidparce qu’il voulait être fidèle à la réalité tout en en exploitant le plus possible l’ampleur narrative. Truffaut disait que le cinéma c’est la réalité sans les moments d’ennui. On a l’habitude de penser que, au cinéma, c’est le documentaire qui prend en charge l’ennui. Je pense tout le contraire : ce n’est pas parce qu’on fait du documentaire qu’on doit être ennuyeux.
Avez-vous montré le film à Gaza ?
Non, je n’ai toujours pas réussi à le montrer là-bas. Mais Amal va se marier dans un mois et demi et je tiens absolument à organiser une projection à Gaza à ce moment-là.







