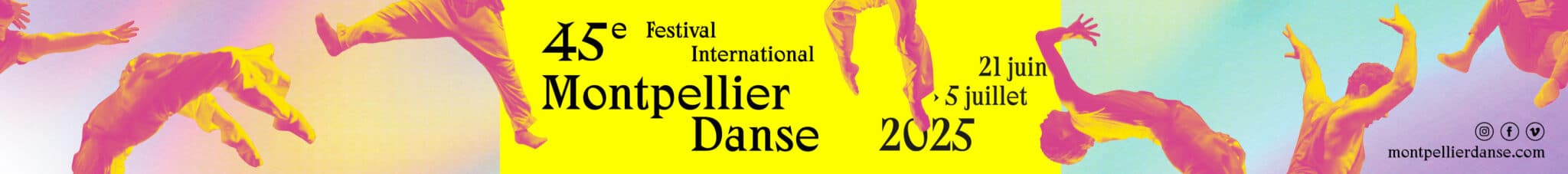Les Noces de Figaro mis en scène par James Gray au théâtre des Champs-Elysées. C’est peu de dire que l’événement nous intriguait. Certes cela fait longtemps que nous savons que l’oeuvre du réalisateur de Two Lovers est marquée par l’art lyrique. Et cela profondément. La référence à l’opéra n’est, dans ses films, jamais décorative : la fragilité des corps, les subtiles variations de couleurs dans un monde chromatiquement unifié et le legato du montage y accompagnent toujours la recherche d’une présence qui, échappant à l’espace et au temps, ferait – c’est le propre du lyrisme – entendre une voix sans origine ni destinataire. Non, ce qui nous intriguait, c’était ce choix : Les Noces de Figaro de Mozart. En effet, on aurait plutôt attendu que le choix du réalisateur de The Yards se porta sur une oeuvre de Bellini, de Donizetti ou de Puccini. Comment allait-il donc dialoguer avec la verve gaillarde, et parfois boulevardière, de cet opéra inspiré de Beaumarchais ?
Les Noces de Figaro mis en scène par James Gray au théâtre des Champs-Elysées. C’est peu de dire que l’événement nous intriguait. Certes cela fait longtemps que nous savons que l’oeuvre du réalisateur de Two Lovers est marquée par l’art lyrique. Et cela profondément. La référence à l’opéra n’est, dans ses films, jamais décorative : la fragilité des corps, les subtiles variations de couleurs dans un monde chromatiquement unifié et le legato du montage y accompagnent toujours la recherche d’une présence qui, échappant à l’espace et au temps, ferait – c’est le propre du lyrisme – entendre une voix sans origine ni destinataire. Non, ce qui nous intriguait, c’était ce choix : Les Noces de Figaro de Mozart. En effet, on aurait plutôt attendu que le choix du réalisateur de The Yards se porta sur une oeuvre de Bellini, de Donizetti ou de Puccini. Comment allait-il donc dialoguer avec la verve gaillarde, et parfois boulevardière, de cet opéra inspiré de Beaumarchais ?
Il faut avouer que, pendant le premier acte, on est plutôt surpris, voire décontenancé. Car Gray, au lieu de l’atténuer ou de le déplacer, insiste sur le folklore sévillan et accentue l’inspiration badine des Noces. Séduits par la probité et l’intelligence de la mise en scène, on en vient même à se dire que c’est précisément cela qui a intéressé le cinéaste : s’employer dans un registre éloigné du sien. Tout de même quelque chose peu à peu nous frappe : la mise en scène souligne systématiquement à quel point tous ces corps sont contraints et combien, dans la société et les lieux représentés, tous les mouvements et les gestes sont empêchés. Comme si ce qui, avant toute chose, intéressait Gray ici était l’énergie mise à surmonter cette contrainte et cette gêne. Ou, pour reprendre ses propres mots, « la lutte qu’être une personne implique ».
Puis commence le deuxième acte. Porgi, amor (« que l’amour apporte un réconfort à ma douleur »). La comtesse Almaviva rentre en scène. Elle chante – avec des accents dignes et blessés à la fois – le chagrin que l’amour ne puisse pas toujours brûler d’un feu égal. Puis l’action reprend et sa voix se mêle à celles des autres personnages. C’est un duo, puis un trio, puis un quatuor, puis un quintette, etc. La beauté des Noces – on le sait – est là : dans la manière dont Mozart additionne et entremêle les voix jusqu’au vertige pour créer un pur chant d’amour. Afin de faire entrer le spectateur dans cet espace abstrait, la mise en scène de Gray fait subtilement alterner les ambiances colorées. Ce qui est sans doute une manière de suggérer ceci : Les Noces de Figaro, au fond, ce sont peut-être moins les noces de… Figaro que celles – infiniment tendres et blessées – du comte et de la comtesse Almaviva ; des noces à jamais fragiles ; des noces à jamais ajournées ; des noces à jamais regrettées ; des noces dont personne, peut-être, n’est à la hauteur.
C’est dans ce ce double constat qu’est le Mozart de Gray : certes nous sommes condamnés à toujours manquer à la dignité de l’amour, mais rien ne saurait ternir en nous l’élan vers cet idéal. Cela a un nom : le sentiment du sublime.