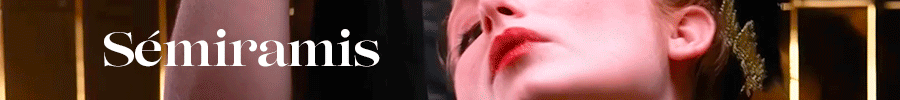Avec Inside Llewyn Davis, les frères Coen donnent leur version du rêve américain. Folk et sombre. Histoire d’un loser au son des guitares acoustiques.
Un matin d’hiver dans les rues de New York, Llewyn Davis (Oscar Isaac), un chanteur folk, tombe sur une affiche de L’Incroyable Randonnée, un film animalier Disney. Une aventure initiatique pour petits et grands, qui, comme le promet la publicité, se situe aux confins du wilderness. Après les grands espaces de True Grit, nulles grandes prairies, et nuls récits édifiants non plus, dans le dernier Coen mais une odyssée de l’échec dans une Amérique urbaine – celle de New York et Chicago – autrement plus sauvage : celle du début des années 1960 et de ses laissés-pour-compte.
Parmi eux, Llewyn Davis dont les mésaventures auraient de quoi faire perdre l’envie à quiconque de tenter sa chance dans l’industrie du spectacle. Davis est un chanteur folk dont le partenaire vient de se suicider en sautant du pont Washington. Llewyn a composé un disque en solo dont tout le monde se fout. Même son imprésario et sa secrétaire aussi sourdingue que sarcastique. Même une chanteuse pâlichonne (Carey Mulligan), peut-être enceinte de ses oeuvre et dont il est peut-être amoureux. Parfois, Llewyn chante dans une boîte folk minable de Greenwich Village où des artistes plus médiocres que lui viennent susurrer des vieux airs traditionnels. Au bout du rouleau, à la recherche d’un chat roux s’étant échappé d’un des innombrables appartements où il dort, Davis décide, un matin, de partir à Chicago tenter sa chance pour rencontrer un célèbre producteur.
Dans l’Amérique sauvage et hivernale de Davis, il y a donc des chats roux errants mais aussi des fillesmères, des enfants sans pères, des pères sans joie. Dans les rues grisâtres, filent des ombres noires et violentes, des couples de beatniks vieillissants, des profs de piano puritains, des boss harcelant leurs employés, des poètes imbuvables et imbitables (grandiose John Goodman). Il y a aussi, enfouis dans les recoins de ce monde, de la drogue, de la misère, des regrets et des échecs.
Au mythe de l’Ouest et du Wild, les Coen ont donc substitué celui des débuts du rock’n’roll et de la révolution folk. Une des dernières légendes modernes. Sauf que les Coen, lucides comme souvent, insistent : de ce conte de fées émergent seulement quelques noms. Les autres, comme celui de Llewyn Davis, sont oubliés. Impossible de savoir si les nombreux artistes que les Coen nous présentent (dont ils caricaturent avec bonheur les couvertures d’albums) ont ou non existé, si Inside Llewyn Davis est un film à clés ou pas. L’Amérique des années 1960 a mis au ban quantité d’artistes folks comme Llewyn Davis qui étaient peut-être, Dieu seul le sait, de grands musiciens. Certains changent la donne (Dylan que l’on entend à la fin du film et dont on distingue dans l’obscurité la tignasse), d’autres non. Certains font carrière, d’autres comme Davis n’émergeront jamais.
On reconnaît bien là le principe d’incertitude cher aux Coen, unique morale de ce faux biopic musical, scandé par quantité de morceaux folks. Avec Inside Llewyn Davis, les Coen fabriquent une contre success story dans une Amérique désenchantée (d’où la teinte grise du film), l’inverse d’un biopic hollywoodien haut en couleurs. Il n’est qu’à voir la structure de ce film, en forme d’anneau de Moebius, sans début ni fin, pour se rendre compte que rien d’édifiant ne peut émerger d’un tel récit. Le film s’ouvre sur Davis chantant dans son rade du Village. Le film s’achève de la même façon, sans qu’il soit possible de savoir si ce chanteur orgueilleux aura appris quelque chose de son périple raté.
Mais loin de n’être qu’un énième récit sceptique des Coen (on pense beaucoup à Barton Fink), cette structure fantastique fabrique autre chose : un filmmonde clos sur lui-même, comme une parenthèse, mi-comique (le film plein de visions expressionnistes avec ses personnages grotesques est très drôle) mi-amer pour rendre hommage à tous ces anonymes que la légende du folk a oubliés. La preuve : la façon dont les Coen prennent le temps de filmer chaque morceau dans leur durée. Sous la lumière d’un projecteur, assis sur sa chaise, cadré comme une icône, Llewyn Davis chante avec conviction sa belle et cruelle chanson. Sa petite ballade pour l’éternité.