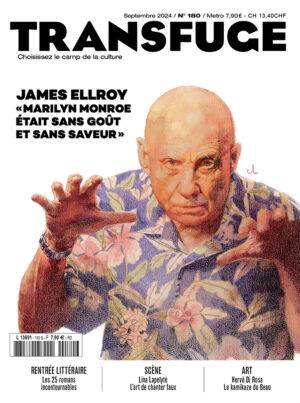C‘est l’une des plus formidables scènes de cinéma vues depuis longtemps. Des hommes s’affrontent en silence à poker ouvert dans un troquet enfumé et verdâtre. Un lieu intemporel et populaire, « plein de bières et de drame », que l’on croirait sorti d’un décor de Trauner dans les années 30. Avec les joueurs, on suit en silence les cartes tomber sur la table. L’un d’entre eux est en train de réaliser un full. Tandis que l’autre est en train, petit à petit, de faire une suite de la même couleur. Pas besoin de paroles, de dialogue superflu. Il suffit de se laisser conduire par la science du montage de Kaurismäki : un plan court sur le visage de l’un, puis beaucoup plus long sur l’autre qui est inquiet, puis sur les cartes elles mêmes et aussi sur les mises qui s’accumulent. La suite de couleurs sera finalement réalisée. Elle triomphe du full. Si l’un avait beau jeu et croyait l’emporter, l’autre a fini par gagner la manche.
C‘est l’une des plus formidables scènes de cinéma vues depuis longtemps. Des hommes s’affrontent en silence à poker ouvert dans un troquet enfumé et verdâtre. Un lieu intemporel et populaire, « plein de bières et de drame », que l’on croirait sorti d’un décor de Trauner dans les années 30. Avec les joueurs, on suit en silence les cartes tomber sur la table. L’un d’entre eux est en train de réaliser un full. Tandis que l’autre est en train, petit à petit, de faire une suite de la même couleur. Pas besoin de paroles, de dialogue superflu. Il suffit de se laisser conduire par la science du montage de Kaurismäki : un plan court sur le visage de l’un, puis beaucoup plus long sur l’autre qui est inquiet, puis sur les cartes elles mêmes et aussi sur les mises qui s’accumulent. La suite de couleurs sera finalement réalisée. Elle triomphe du full. Si l’un avait beau jeu et croyait l’emporter, l’autre a fini par gagner la manche.
Cette séquence muette contient tout l’art, toute l’éthique de Kaurismäki : musicalité du découpage, rythmé comme une partition, et surtout la croyance qu’il est toujours possible, en abattant ses cartes une à une, de venir à bout de plus fort que soi. Le film raconte cela à partir de deux histoires mises en parallèle : d’abord celle d’un émigré syrien échoué en Finlande et qui cherche désespérément sa soeur à travers toute l’Europe puis celle d’un vendeur de chemises qui s’improvise restaurateur avec une équipe de bras cassés. Ce sont des histoires de lutte pour la survie. Lutte d’abord pour rester sur le territoire tandis que surviennent brutalement dans le plan des policiers trop zélés, des bureaucrates hypocrites. Il suffit de les voir jaillir dans leurs uniformes respectifs et absurdes comme ceux des Dupond et Dupont pour sentir toute la violence exercée à l’encontre des migrants. Kaurismäki n’a pas besoin d’en faire des tonnes pour nous ouvrir les yeux sur un quotidien sécuritaire que l’on ne mesure pas toujours. Lutte enfin pour réinventer sa vie à cinquante ans dans le cas du restaurateur et de ses employés à la dérive. C’est la partie la plus drôle. Notamment quand ils essayent de trouver la solution miracle du succès et tentent de servir à des clients japonais des sushis de hareng saur. Les deux histoires avancent évidemment de concert jusqu’à une résolution heureuse, dans la mesure où elle donne l’impression qu’il est possible de construire et de réaliser ensemble une utopie fraternelle. Il ne faudrait pas croire pour autant que Kaurismäki est un optimiste béat. A l’image des décors, la manière dont le scénario de son meilleur film semble venir à bout aisément des différents obstacles qu’il sème, est en trompe-l’oeil. Si tout paraît trop simple, il suffit encore à son auteur d’intercaler une ombre, un plan long, un simple raccord, un gag pour instiller une durable inquiétude. C’est dans l’inquiétude, dans la vigilance permanente de ce qui peut surgir à tout moment que la lutte selon Kaurismäki peut en fin de compte triompher.